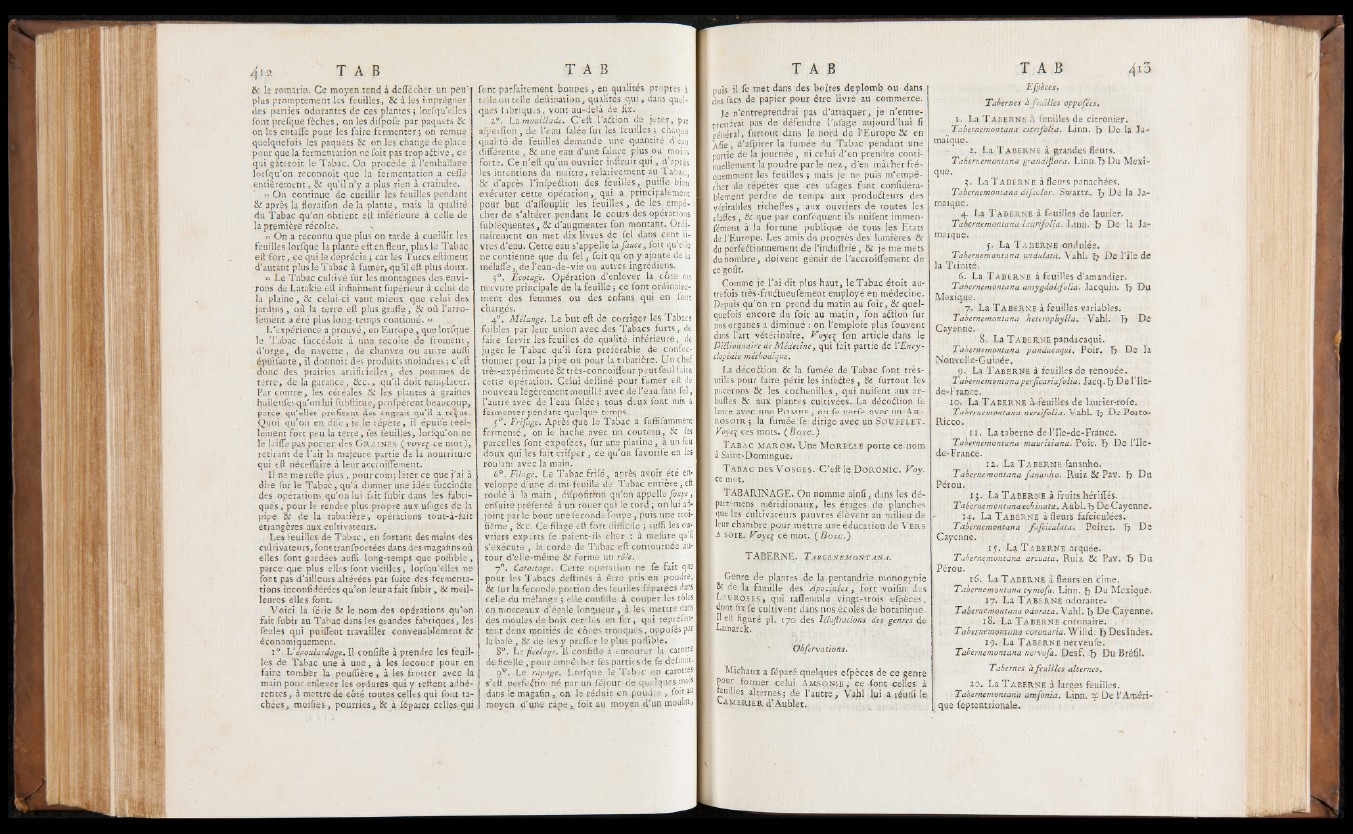
& le romarin. Ce moyen ten4 à defiecher un peu’
plus promptement les feuilles, & à les imprégner
des parties odorantes de ces plantes > lorsqu'elles
font prefque fèches, on les difpofe par paquets 8c
on les entafle pour les faire fermenter j on remue
quelquefois les paquets 6c on les change de place
pour que la fermentation ne foit pas trop aétive, ce
qui gâteroit le Tabac. On procède à l'emballage
lorsqu'on reconnoît que la fermentation a ceffé
entièrement, 8c qu'il n'y a plus rien à craindre.
» On continue de cueillir les feuilles pendant
8c après la floraifon de la plante, mais la qualité
du Tabac qu'on obtient eft inférieure à celle de
la première récolte.
*> On a reconnu que plus on tarde à cueillir les
feuilles lorfque la plante eft en fleur, plus le Tabac,
eft "fort, ce qui le déprécie ; car les Turcs eftiment
d'autant plus le Tabac à fumer, qu’il eft plus doux.
» Le Tabac cultivé fur les montagnes des environs
de Latakie eft infiniment fupérieur à celui de
la plaine j 8c celui-ci vaut mieux que celui des
jardins,~où la terre eft plus graffe, 8c où l'arro-
fèmènt a été plus long-temps continué. «
L ’expérience a prouvé, en Europe, que lorfque
le Tabac fùççédoït à une récolte de froment,
d'orge^ de navette, de chanvre ou autre aulfi
épuifante, il donnoit des produits moindres> c'eft
donc des prairies artificielles, des pommes de
terre, de la garance, & c . , qu'il doit remplacer.
Par contre, les. céréales & les plantes à graines
huilenfçs qu'on lui fuhititue, profpèrent beaucoup,
parce qu’ elles profitent des engrais qu'il a reçus.
Quoi qu'on en. dife , je le répète, il épuiferéellement
fort peu la terre, fes feuilles, lorfqu’on ne
le’ làilie pas porter des G r a in es (voye^ ce mot),
retirant de i’ air la majeure partie de la nourriture
qui eft néceffaire à leur accroiffement.
Il ne merefte plus, pour compléter ce que j'ai à
dire fur le Tabac, qu’ à donner une idée fuçcinéte
des opérations qu’on lui fait fubir dans les fabriques,
pour le rendre plus propre aux ufages de la
pipe & de la tabatière, opérations tout-à-fait
étrangères aux cultivateurs.
Les feuilles de Tab a c , en fortan-t des mains des
cultivateurs, font tranfportées dans des magafins où
elles font gardées auffi long-temps que poffible,
parce que plus elles font vieilles, lorfqu'eiles ne
font pas d’ailleurs altérées par fuite des fermentations
inconfîdérées qu'on leur a fait fubir, & meilleures
elles font.
V o ic i la férié 8c le nom des opérations qu’on
fait fubir au Tabac dans les grandes fabriques, les
feules qui puifient travailler convenablement 8c
économiquement.
i° . \J epoulardage. Il eonfïft-e à prendre les feuilles
de Tabac une à une, à les fecouer pour en
faire tombfer la pouflière , à les frotter avec la
main pour enlever les ordures qui, y reft^nc adhérentes,
à mettre de côté toutes celles qui font tachées,
moifteSj po,urri.es A 8c à féparer celles qui
font parfaitement bonnes, en qualités propres à
telle ou telle deftination, qualités qui, dans quelques
fabriques, vont au-delà de fix.
a9. La mouillade. C ’eft l'a&ion de jeter, par
afperfion, de l'eau falée (ur les feuilles ; chaque
qualité de feuilles demande une quantité d'eau
différente, 8c une eau d’une falure plus ou moins
foi te. C e n’eft qu'un ouvrier inffruit q u i, d’après
les intentions du maître, relativement au T a b a c ,
8c d'après l ’infpeétion des feuilles, puiffe bien
exécuter cette opération, qui a principalement
pour but d'aflouplir les feuilles, de les. empê- .
cher de s’ altérer pendant le cours des opérations
fubféquentes, 8c d'augmenter Con montant. Ordinairement
on met dix livres de fel dans cent livres
d’eau. Cette eau s’ appelle la fauce, foit qu’elle
ne contienne que du fe l, foit qu'on y ajoute de la
mélaffe ,, de l’eau-de-vie ou autres ipgrédiens.
3°. Ecotagè. Opération d'enlever la cote ou
nervure principale de la feuille ; ce font ordinairement
des femmes ou des enfans qui en font
chargés.
4°. Mélange. Le but eft de corriger les Tabacs
fuibles par leur union avec des Tabacs forts, de
faire fervir les feuilles de qualité inférieure, de
juger le Tabac qu'il fera préférable de confectionner
pour la pipe ou pour la tabatière. Un chef
très-expérimenté 8ctrès-connoiffeur peutfeul faire
i cette opération. Celui deftiné pour fumer eft de
nouveau légèrement mouillé avec de l'eau fans fel,
l’autre avec de l'eau Calée j tous deux font mis à
fermenter pendant quelque temps.
j ° . Frifage. Après çfue le Tabac a fuffifamment
fermenté, on le hacneavec un couteau, 6c fes
parcelles font expo fées, fur une platine, à un feu
doux qui les fait crifper, ce qu’on favorife en les
roulant avec la main.
6 °. Filage. Le Tabac frifé, après avoir été enveloppé
dune demi-feuille de Tabac entière,eft
roulé à la main, difpofitron qu'on appelle fouve,
erifuite préfenté à un rouet qui le tord ; on lui adjoint
par le bout une fécondé foupe ,'puis une troi-
fième, 8cc. Ce filage eft fort difficile j auffi les ou;
V tiers experts fe paient-ils cher : à mefure qu’il
s’exécute , la corde de Tabac eft contournée au-,
tour d’elie-même 8c forme un rôle.
7°. Carottage. Cette opération ne fe fait que
pour les Tabacs deftinés à être pris en p o u d re ,
& fur la fécondé portion des feuilles déparées dans
celle du mélange j elle confifte à couper les rôles
en morceaux d'égale longueur a à les mettre dans
des moules de bois cerclés en fe r , qui repréfen*
tant deux moitiés de cônes tronqués,, oppofés par
. la bafe , 8c de les y preffer le plus poffible.
8°. Le ficelage. Il confifte à entourer la carotte
de ficelle, pour empêcher fes parties de fe délunir.
9®. Le râpage. Lorfque le Tabac en carottes
s’ eft perfeélioi.né par un féjour de quelques mois
dans le magafin,, on le réduit en poudre , foit ait
moyen d'une r â p e fo i t au moyen d'un moulin*
puis il fe niet dans des boîtes de plomb ou dans
des facs de papier pour être livré au commerce.
Je n’entreprendrai pas d’ attaquer , je n'entreprendrai
pas de défendre l'ufage aujourd'hui fi
général, furtout dans le nord de l’Europe & en
Afie j d’afpirer la fumée du Tabac pendant une
partie de la journée, ni celui d’en prendre continuellement
la poudre par le ne z, d'en mâcher fréquemment
les feuilles ; mais je ne puis m'empêcher
de répéter que ces ufages font confidéra-
blement perdre de temps aux producteurs des
véritables richeffes, aux ouvriers de toutes les .
dalfes, 8c que par conféquent ils nuifent immen-
fémen^ à la fortune publique de tous les Etats
,de l’Europe. Les amis du progrès des lumières &
du perfectionnement de l'induftrie, 8c je me mets
du nombre, doivent gémir de l ’accroiftement dé ;
cegoûr.
Comme je l’ ai dit plus haut, le Tabac étoit autrefois
très-fruétueufement employé en médecine.
Depuis qu’on en prend du matin au foir , 8c quelquefois
encore du foir au matin, fon action fur
nos organes a diminué : on l’emploie plus fouvent
dans l'art vétérinaire. Voye{ fon article dans le
Diâlonnaire de Médecine, qui fait partie de YEncy-
\ clopédie méthodique.
La décoction 8c la fumée de Tabac font très-
utiles pour faire périr les infeÔes, 8c furtout les
pucerons 8c les cochenilles, qui nuifent aux ar-
buftes 8c aux plantes cultivées. La décoétion fe
! lance avec une Pqmpe , ou fe verfe avec un A r rosoir
j la, fumée fe dirige avec un S o u f f l e t .
Voye[ ces mots. ( Bo.s^ç.)
T a b a c m a r o n . Une Morelle porte ce nom
à Saint-Domingue,
| T a b a c des V o sg es. C'éft Iç D o r o n ic . Voy.
[ ce mot. •
j TABARINAGE. On nomme ainfi, dans |es dé-
[ partemens méridionaux, lès étages de planches
que les cultivateurs pauvres élèvent au milieu de
I leur chambre.pour mettre une éducation de V ers
r A soie. Voyer^ ce mot. (B o $ .c .)
TABERNE. T a b ç r x b m o & t a n a .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
J & de la- famille des Apocin,ées, fort voifin des
j L.auroseS) qui îafïemble vingt*-trois efpèces,
I ^ont fix fe cultivent dans nos écoles de botanique.
| Il eft figuré pl. 170 des lllufirations des genres de
Lamarck. . . ..
'Observations.
Michaux a féparé quelques efpèces de ce genre
I pour former celui A m,sq n ie ,’ ce font celles? à
I reuilles alternes 5 de l'autre 3 VaJft lui aréuni le:
> Lamerier d’Aublet.
Efpèces.
Tab ernes a feuilles oppofées.
1. La T aberne à feuille? de citronier.
Tab.çrn.empnpana: citrifolia. Linn. T? De la Jamaïque.
I. La T a b erne à grandes fleurs.
Tabèrnemontanagrandifiora. Linn. T? Du Mexique.
3. La T aberne à fleurs panachées.
Takernemontaaa difcolqr. Swartz.. T) De la Jamaïque.
4. La T aberne à feuilles de laurier.
Tabèrnemontana Laurifolia.. Uni), f? De la Jamaïque.
5. La T ab erne ondulée.
Tabèrnemontana undulata. Vahl. J? De Pile de
la Trinité.
<$. La T a b erne à feuilles d’amandier.
Tabèrnemontana amygdalifolia. Jacquin. U Du
Mexique.
7. La T a b erne à feuilles variables.
Tabèrnemontana heteropbqlla. 'Vahl. De
Cayenne.
8. La T ab erne pandacaqui.
Tabèrnemontana pandacaqui. Poir. T? Ue la
Nouyelle^Guinée.
. 9, La T a b erne à feuilles de renouée.
Tabernemontanç.perfiçari&folia. Jacq. T? De l'Ilede
France*
iq. La T a b er n e à-rfeuillès de laurier-rofe.
Tabèrnemontana ne.reifo.lia. Vahl. f> De Porto-
Ricço.
I I . La taberne de l'Ilerde-France.
'Tabèrnemontana maurïtiana. Poir. T? De l'Ilede
France.
12. La T ab erne fananhô.
Tabèrnemontana fananho.. Ruiz & Pav. f) Du
Pérou.
13. La T aberne .à fruit&hériffés.
Tabèrnemontana,echinata. Aubl. De Cayenne.
14. La T aberne à fleurs fafeiculées.
Tabèrnemontana fafciculata.. P’oïret. T? De
; Cayenne.
15. La T a b erne arquée.
Tabèrnemontana arcuata. Ruiz & Pav. T? Du
Pérou.
16. La T aberne à fleurs en cime.
Tabèrnemontana cymofa. Linn. Du Mexique.
17. La T aberne odorante.
Tabèrnemontana odorata. Vahl. D De Cayenne.
18. La T a b erne coronaire. ,
Tabèrnemontana coronaria.'WÏWà. "D Des Indes.
19. La T aberne nerveufe.
Tabèrnemontana nervofa. Desf. Du BréfiL
Tabernes a feuilles alternes.
20. La T aberne à larges feuilles.
Tabèrnemontana amfonùa. Linn. De FArnéri-
: que feptentrionale.