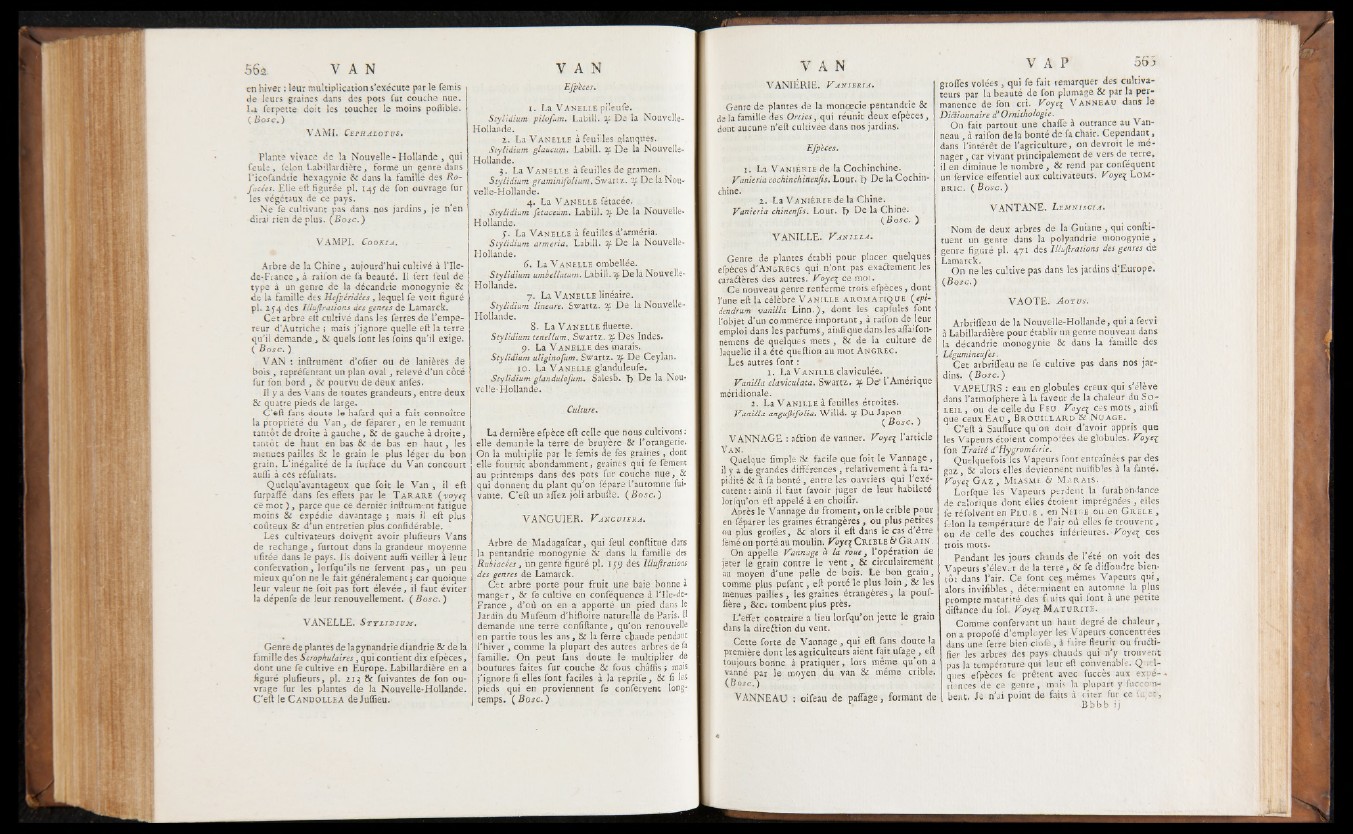
en hiver : leur multiplication s’exécute par le femis
de leurs graines dans des pots fur couche nue.
I.a ferpette doit les toucher le moins pofiible.
( Bosc. )
VAMI. Ce ph a lo tu s .
Plante vivace de la Nouvelle-Hollande, qui
feule, félon LabiHardière, forme un genre dans
l’icofandrie hexagynie & dans la famillé des R o~
f a c é e s . Elle eft figurée pl. 145 de fon ouvrage fur
les végétaux de ce pays.
Ne fe cultivant pas dans nos jardins , je n’en
dirai rien de plus. { B o s c . )
VA MPI. Co o k ia .
Arbre de la Chine , aujourd’hui cultivé à l’Ile-
de-France , à raifon de fa beauté. Il fert feul de
type à un genre de la décandrie monogynie &
de la famille des H e fp é r id é e s , lequel fe voit figuré
pl. 254 des I l lu f ir a t io n s d e s g en r e s de Lamarck.
Cet arbre elt cultivé dans les ferres de l’empereur
d'Autriche ; mais j’ignore quelle eft la terre
qu’il demande, & quels font les foins qu’il exige.
( B o s c . )
VAN : inftrument d’ofier ou de lanières de
bois , repréfentant un plan oval , relevé d’un côté
fur fon bord , & pourvu de deux anfes.
Il y a des Vans de toutes grandeurs3 entre deux
& quatre pieds de large.
Ç’eft fans doute le hafard qui a fait connoître
la propriété du Van, de féparer, en le remuant
tantôt de droite à gauche, & de gauche à droite,
tantôt de haut en bas & de bas en haut, les
menues pailles & le grain le plus léger du bon
grain. L’inégalité de la furface du Van concourt
aufti à ces réfultats.
Quelqu’avantageux que foit le Van , il eft
furpaffé dans fes effets par le T arare { v o y e \
ce mot ) , parce que ce dernier inftrument fatigue
moins & expédie davantage j mais il eft plus
coûteux & d’un entretien plus confidérable.
Les cultivateurs doivent avoir plufieurs Vans
de rechange , furtout dans la grandeur moyenne
ufitée dans le pays. Us doivent auffi veiller à leur
confervation, lorfqu’ils ne fervent pas, un peu
mieux qu’on ne le fait généralement 5 car quoique
leur valeur ne foit pas fort élevée, il faut éviter
la dépenfe de leur renouvellement. ( B o s c . )
VANELLE. S t y l i d i u m .
Genre de plantes de la gynandrie diandrie & de la
famille des S c r o p h u la ir e s 3 qui contient dix efpèces,
dont une fe cultive en Europe. LabiHardière en a
figuré plufieurs, pl. 213 & fui vantes de fon ouvrage
fur les plantes de la Nouvelle-Hollande.
C ’eft le C andollea de Juflieu.
E Jp h c es.
1. La V anelle piîeufe.
S t y l id iu m p i lo fu m . Labill. i f De la Nouvelle-
Hollande.
i . La V anelle à feuilles glauques.
S t y lid ium . glaucurp.. Labill. i f De la Nouvelle-
Hollande.
3. La V anelle à feuilles de gramen.
S t y l id iu m g r a m in ifp l iu m . Swartz. 2f De la Nouvelle
Hollande.
4. La V anelle fétacée.
. S t y l id iu m f e ta c e u m . Labill. i f De la Nouvelle-
Hollande.
y. La V anelle à feuilles d’arméria.
S t y l id iu m a rm e r ia . Labill. i f De la Nouvelle-
Hollande.
6 . La V anelle ombellée.
S t y l id iu m um b e lla tum . Labill. i f De la Nouvelle-
Hollande.
7. La V anelle linéaire.
S t y l id iu m l in e a r e . Swartz. 2f De la Nouvelle-
Hollande.
8. La V anelle fluette.
S t y l id iu m te n e l lum . Swartz. 2f Des Indes.
9. La V anelle des marais.,
S t y l id iu m u lig in o fum . Swartz. i f De Ceylan.
10. La V anelle glanduleufe.
S t y l id iu m g la n d u lo fum . Salesb. T? De la Nouvelle
Hollande.
C u ltu r e .
La dernière efpèce eft celle que nous cultivons:
elle demande la terre de bruyère & l’orangerie.
On la multiplie par le femis de fes graines , donc
elle fournit abondamment, graines qui fe fèmenc
au printemps dans des pots fur couche nue, &
qui donnent du plant qu’on fépare l’automne fui*
vante. C’eft un affez joli arbufte. { B o s c . )
VANGUIER. V A N G U 1ER A.
Arbre de Madagafcar, qui feul conftitue dans
la pentandrie monogynie & dans la famille des
R u b ia c é e s 3 un genre figuré pl. 159 des Illu fira tio n s
d e s g en r es de Lamarck.
Cet arbre porte pour fruit une baie bonne à
manger, & fe cultive en conféquence à l’Ile-de-
France, d’où on en a apporté un pied dans le
Jardin du Muféum d’hiftoire naturelle de Paris. H
demande une terre ccnfiftante, qu’on renouvelle
en partie tous les ans, & la ferre chaude pendant
l’hiver, comme la plupart des autres arbres de fa
famille. On peut fans doute le multiplier de
boutures- faites fur couche & fous châlfis} mais
j’ignore fi elles font faciles à la reprife, & fi les
pieds qui en proviennent fe confervent longtemps.
( B o s c . )
VANIÉRIE. V a x i b r ia .
Genre de plantes de la monoecie pentandrie &
de la famille des O r t i e s , qui réunit deux efpèces,
dont aucune n’eft cultivée dans nos jardins.
E fp e c e s .
il La V aniérie de la Cochinchine.
V a n ie r ia c o c h in c h in e n f is . Lour. T? De la Cochinchine.
2. La V aniérie de la Chine.
V a n ie r ia c h in e n f is . Lour. T? De la Chine.
( B o s c . )
VANILLE. V a n i l l a .
Genre de plantes établi pour placer quelques
efpèces d’ANGRECs qui m’ont pas exactement les
caraCtères des autres. V o y e i ce mot.
Ce nouveau genre renferme trois efpèces, dont
l’une eft la célèbre V anille aromatique (ep i-
dendrum v a n i lla Linn.), dont les^ capfules font
l’objet d’un commerce important, à raifon dé leur
emploi dans les parfums, ainfique dans les aflaifon-
nèmens de quelques mets, & de la culture de
laquelle il a été queftion au mot A ngrec.
Les autres font :
1. La V anille claviculée.
V a n i l la c la v i c u la ta . Swartz^ 'if De* l’Amérique
méridionale.
2. La V anillé à feuilles étroites.
V a n i l la a n g u f ii fo l ia . Willd. i f Du Japon.
( B o s c . )
VANNAGE : aCtion de vanner. V o y e ^ l’article
V an. Quelque fimple 8c facile que foit le Vannage,
il y a de grandes différences , relativement à la rapidité
& à fa bonté, entre les ouvriers qui l’exécutent
: ainfi il faut favoir juger de leur habileté
groffes volées , qui fe fait remarquer des cultivateurs
lorfqu’on eft appelé à en choifir.
Après le Vannage du froment, on le crible pour
en féparer les graines étrangères, ou plus petites
ou plus groffes, 8c alors il eft dans le cas d etre
femé ou porté.au moulin. V o y e ç C rible & Gr a in .
On appelle V a n n a g e à. la r o u e , l’opération de
jeter le grain contre le vent, & circulairement
au moyen d’une pelle de bois. Le bon grain, 1
comme plus pefant, eft porté le plus loin , 8c les
menues pailles , les graines étrangères, la pouf-
fière, 8c c . tombent plus près.
L’effet contraire a lieu lorfqu’on jette le grain
dans la direction du vent.
Cette forte de Vannage, qui eft fans doute la
première dont les agriculteurs aient fait ufage, eft
toujours bonne à pratiquer, lors même qu’on a
vanné par le moyen du van 8c même criblé.
( B o s c . )
VANNEAU : oifeau de paflage, formant de
par la beauté de fon plumage & pat la permanence
de fon cri. V o y e ^ Vanneau dans le
D i c t io n n a i r e d? O r n i th o lo g ie .
On fait partout une chaffe a outrance au Vanneau
, à raifon de la bonté de fa chair. Cependant,
dans l'intérêt de l'agriculture, on devroit le ménager,
car Vivant principalement de vers de terre,
il en diminue le nombre, & rend par conféquenr
un fervice effentiel aux cultivateurs. V o y e [ Lombric.
( B o s c . )
VANTANE. L z m x i s c i a .
Nom de deux arbres de la Guiane, qui confti-
tuenc un genre dans la polyandrie monogynie,
genre figuré pl. 471 des I l lu f i r a t io n s d e s g en r e s de
Lamarck.
On ne les cultive pas dans les jardins djEurope.
(Bosc.)
VAOTE. A otus .
Arbriffeau de la Nouvelle-Hollande, qui a fervi
à LabiHardière pour établir un genre nouveau dans
la décandrie monogynie & dans la famille des
L é g u tn în e u fe s .
Cet arbriffeau ne fe cultive pas dans nos jardins.
(Bosc.)
VAPEURS : eau en globules creux qui s'élève
dans l'atmofphère à la faveur de la chaleur du Sole
il , ou de celle du Feu V o y e ^ ces mors, ainfi
que ceux Eau , Brouillard & Nuage.
C'eft à Sauffure qu on doit d'avoir appris que
les Vapeurs étoient compofées de globules. H o y e^
fon T r a i t é d ’H y g r om é t r ie . Quelquefois les Vapeurs font entraînées par des
gaz, & alors elles deviennent nuiftbles à la fanté.
y o y e ç G a z , M i a s m e M a r a l s . .
Lorfque les Vapeurs perdent la furabondance
de Calorique dont elles étoient imprégnées, elles
fe réfolventen Plu;e , en Neiae ou en Gr ê le ,
félon la température de l'air où elles fe trouvent,
ou de.celle des couches inférieures. V o y e [ c e s
trois mots.
Pendant les jours chauds de l'été on voit des
Vapeurs s'élever dé la terre, & fe diffoudre bientôt
dans l'air. Ce font .cej mêmes Vapeurs qui,
alors invifibles, déterminent en automne la plus
prompte maturité des Luits qui font a une petite
difiance du fol. V o y e j Matur ité .
Comme confervant un haut degré de chaleur,
on a propofé d’employer les Vapeurs concentrées
dans une ferre bien ciofè, à faire fleurir ou fructifier
les arbres des pays chauds qui n’y trouvent
pas la température qui leur eft convenable. Quelques
efpèces fe prêtent avec fuccès aux expériences
de ce genre, mais la plupart y fticcom-
bent. Je n'ai point de faits à citer fur ce fu,et ,
Bbbb ij