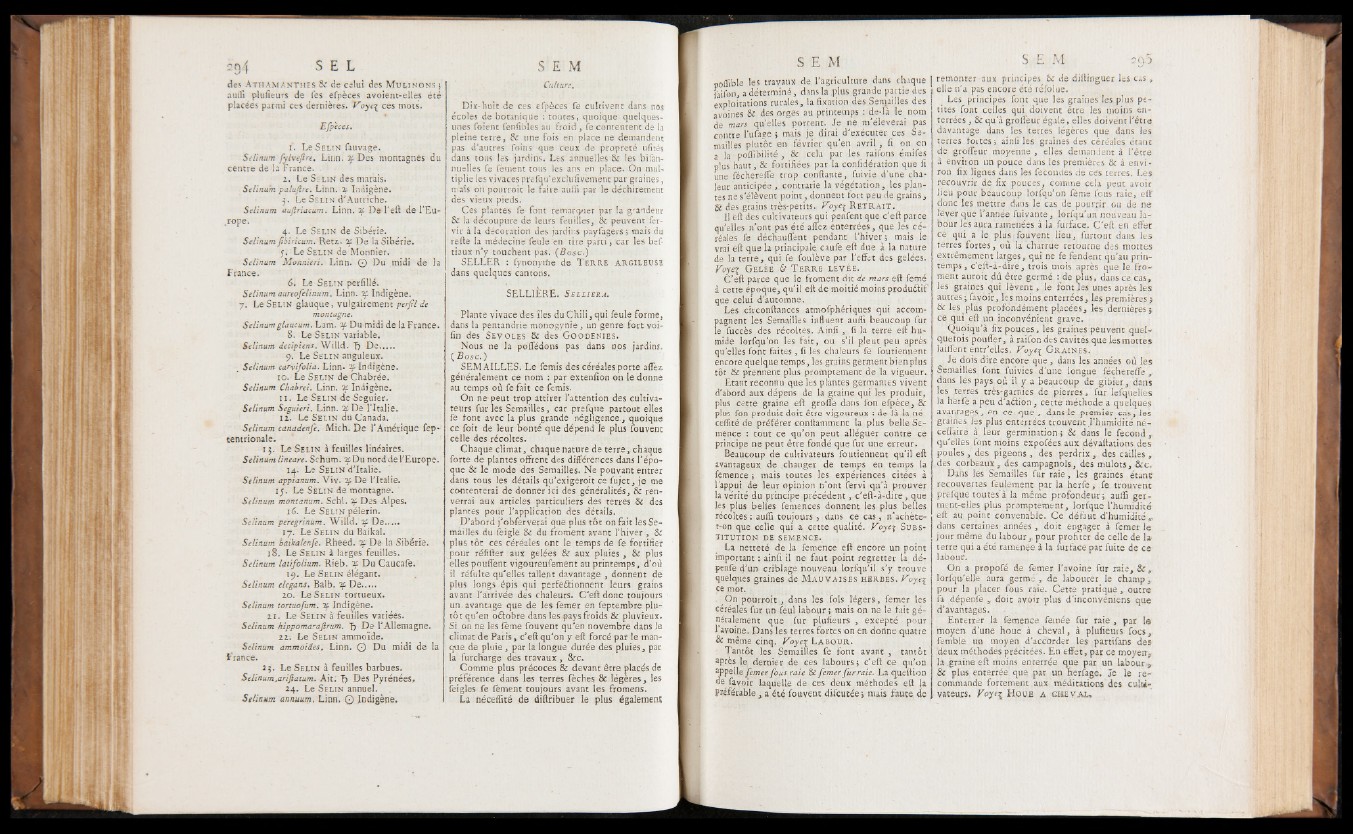
S E M
des Ath am an th e s & de celui des Mulinons $ Culture,
auffi plufieurs de Tes efpèces avoient-elles été
placées parmi ces dernières. Voyeç ces mots.
Efpèces,
r. Le Selin fauvage.
Selinum fylveftre. Linn. 2f Des montagnes du
centre de la France. .
2. Le Selin des marais.
Selinum palujlre. Linn. Indigène.
3. Le Selin d'Autriche.
Selinum aufiriacum. Linn. % De Left de l’Eu-
.rope.
4. Le Selin de Sibérie.
Selinum ftbiricum. Retz. 2f De la Sibérie.
y, Le Selin de Monnier.
Selinum Monnieri. Linn. © Du midi de la
France.
6i Le Selin perfillé.
Selinum aureofelinum. Linn. 2f. Indigène.
7. Le Selin glauque, vulgairement perfil de
montagne.
Selinumglaucum. Lam. 2f Du midi de la France.
8. Le Selin variable.
Selinum decipiens. Willd. "fj De......
9. Le Selin anguleux.
Selinum car-vifolia. Linn. %- Indigène.
10. Le Selin de Chabrée,
Selinum Chabrei. Linn. 2f Indigène.
u . Le Selin deSeguier.
Selinum Seguieri. Linn. 2f De l’ Italie.
12. Le Selin du Canada.
Selinum canadenfe. Mich. De l’Amérique fep-
tentrionaie.
13. Le Selin à feuilles linéaires.
Selinum lineare. Schum. 2fDu nord de l’Europe.
14. Le Selin d’ Italie.
Selinum appianum. V iv. 2 f De l’ Italie.
i j . Le Selin de montagne.
Selinum montanum. Schl. 2L Des Alpes.
16. Le Selin pèlerin.
Selinum peregrinum. Willd. 2f De.....
17. Le Selin du Baikal.
Selinum baikalenfe. Rheed. ^ De- la Sibérie.
18. Le Selin à larges feuilles.
Selinum latifolium. Rieb. 2L Du Caucafe.
19. Le Selin élégant.
Selinum elegans. Bal b. 2f De......
20. Le Selin tortueux.
Selinum tortuofum. if Indigène.
21. Le Selin à feuilles variées.
Selinum hippomaraftrum. I7 De l’Allemagne.
22. Le Selin ammoïde.
Selinum ammoides. Linn. 0 Du midi de la
France.
23. Le Selin à feuilles barbues.
SeLinum.ariftatum. Ait; T) Des Pyrénées,
24. Le Selin annuel.
Selinum annuum. Linn. Q Indigène.
Dix-huit de ces efpèces fe cultivent dans nos
écoles de botanique : toutes, quoique quelques-
unes foient fenfibles au froid, fe contentent de la
pleine terre, 8c. une fois en place ne demandent
pas d’autres foins que ceux de propreté ufités
dans tous les jardins. Les annuelles 8c les bifan-
nuelles fe fèment tous les ans en place. On multiplie
les vivaces prefqu’exclufivement par graines,
mais oh pourroit le faire aufli par le déchirement
des vieux pieds.
Ces plantes fe font remarquer par la grandeur
& la découpure de leurs feuilles, & peuvent fer-
vir à la décoration des. jardins payfagers ; mais du
refte la médecine feule en tire parti» car les bef-
tiaux n’y touchent pas. (Bosc,)
SELLER : fynonyrîie de T erre argileuse
dans quelques cantons.
SELLIÈRE. Selliera.
Plante vivace des îles du C hili, qui feule forme,
dans la pentandrie monogynie, un genre fort voi-
fin des Sevoles & des Goodenies.
Nous ne la poffédons pas dans nos jardins.
( B o sc.)
SEM AILLES. Le femis des céréales porte affez
généralement ce nom : par extenfion on le donne
au temps où fe fait ce femis.
On ne-peut trop attirer l’attention des cultivateurs
fur les Semailles, car prefque partout elles
fe font avec la plus grande négligence, quoique
ce foit de leur bonté que dépend le plus fouvent
celle des récoltes.
Chaque climat, chaque nature de terre, chaque
forte de plantes offrent des différences dans l’ époque
& le mode des Semailles. Ne pouvant entrer
dans tous les détails qu’exigeroit ce fujet, je me
contenterai de donner ici des généralités, & renverrai
aux articles particuliers des terres & des
plantes pour l’application des détails.
D’ abord j’ obferverai que plus tôt on fait les Semailles
du feigle & du froment avant l’hiv e r , &
plus tôt ces céréales ont le temps de fe fortifier
pour réfifter aux gelées &r aux pluies, 8 c plus
elles pouffent vigoureufement au printemps, d’où
il réfulte qu’elles tallent davantage , donnent de
plus longs épis qui perfectionnent leurs grains
avant l’arrivée des chaleurs. C ’eft donc toujours
un, avantage que de les femer en feptembre plutôt
qu’ en oCtobre dans Jes pays froids & pluvieux.
Si on ne les feme fouvent qu’en novembre dans le
climat de Paris, c’eft qu’on y eft forcé par le manque
de pluie, par la longue durée des pluies, par
la furcharge des travaux, & c .
Comme plus précoces & devant être placés de
préférence dans les terres fèches & légères, les
feigles fe fèment toujours avant les fromens.
La nécefïité de diftribuer le plus également
1 remonter aux principes 8c de diftinguer les c a s ,
elle n'a pas encore été réfolue.
poffible les trayaux de l’agriculture dans chaque |
faifon, a déterminé, dans la plus grande partie des
exploitations rurales, la fixation des Sern.ai.lles des
avoines & des orges au printemps : de-la le nom
de mars quelles portent. Je ne m’élèverai pas
contre l’ufage > mais je dirai d’exécuter ces Semailles
plutôt en février qu’en avril , fi on en
a la poflibilité, 8c cela par les raifons émifes
plus haut, & fortifiées par la confédération que fi
une féchereffe trop confiante, fuivie d’une chaleur
anticipée , contrarie la végétation, les plantes
ne s'élèvent point, donnent fort peu de grains,
8c des grains très-petits.: Voye^ Re tr a it .
fl ëft des cultivateurs qui penfentque c’eft parce
qu’elles n’ont pas été affez enterrées, que les céréales
fe déchauffent pendant l’hiver ; mais le
vrai eft que la principale caufe eft due à la nature
de la terre, qui fe foulève par l’effet des gelées.
Voyei Gelée & T erre levée.
C ’eft parce que le froment dit de mars eft femé
à cette époque, qu’il eft de moitié moins productif
que celui d’automne.
Les circonftances atmofphériques qui accompagnent
les Semailles influent aufli beaucoup fur
le fuccès des récoltes. Ainfi , fi la terre eft humide
lorfqu’on les fait, ou s’il pleut peu après
quelles font faites , fl les chaleurs fë foutiennent
encore quelque temps, les grains germent bien plus
tôt 8c prennent plus promptement de la vigueur.
Etant reconnu que les plantes germantes vivent
d’abord aux dépens de la graine qui les produit,
plus cette graine eft grofle dans fon efpèce, 8c
plus fon produit doit être vigoureux : de-là -la né-
ceffité de préférer conftamment la plus belle Semence
: tout ce qu’on peut alléguer contre ce
principe ne peut être fondé que fur une erreur.
Beaucoup de cultivateurs foutiennent qu’il eft
avantageux de .changer de temps en temps la
femence } mais toutes les expériences citées à
l ’appui de leur opinion n’ont fervi qu’ à prouver
la vérité du principe précédent, c’eft-à-dire, que
les plus belles femences donnent les plus belles
récoltes : aufli toujours > dans ce c a s , n’achète-
t-on que celle qui a cette qualité. Voye^ Substitution
DE SEMENCE.
La netteté de la femence eft encore un point
important : ainfi il ne faut point regretter la dé-
penfe d’un criblage nouveau lorfqu’il s’y trouve
quelques graines de Mauvaises herbes. Voye^
ce mot.
. On pourroit , dans les fols légers, femer les
céréales fur un feul labour ; mais on ne le fait généralement
que fur plufîeurs , excepté pour
l’avoine. Dans les terres fortes-on en dofrne quatre
& même cinq. Voyeç La b o u r .
Tantôt les Semailles fe font av an t, tantôt'
après le dernier de ces labours 5. c’eft ce qu’on
appelle femer fous raie 8c femer fur raie. La queftion J
ne favoir laquelle de ces deux méthodes eft |a
préférable ^ a été fouvent dificutée> mais faute: de
Les principes font que les graines les plus petites
font celles qui doivent être les moins enterrées
, 8c qu a grofleur égale, elles doivent l’être
davantage dans les terres légères que dans les
terres fortes 5 ainfi les graines des céréales étant
fle grofleur moyenne, elles demandent à l’être
à environ un pouce dans les premières 8c à environ
fix lignes dans les fécondés de ces terres. Les
recouvrir de fix pouces, comme cela peut avoir
lieu pour beaucoup lorfqu’on fème fous raie, eft
donc les mettre dans le cas de pourrir ou de ne
lever que l’année fuivante, lorfqu’ un nouveau labour
les aura ramenées à la furface. C ’eft en effet
ce qui a le plus fouvent lieu, furtout dans les
terres fortes, où la charrue retourne des mottes
extrêmement larges, qui ne fe fendent qu’au printemps,
c’eft-à-dire, trois mois après que le froment
auroic dû être germé : de plus, dans ce cas,
les graines qui lè ven t, le font les unes après les
autres ; favoir, les moins enterrées, les premières >
8c les plus profondément placées, les dernières 5
ce qui eft un inconvénient grave.
Quoiqu’à fix pouces, les graines peuvent quelquefois
pouffer, à raifon des cavités que les mottes
laiïfent entr’ elles. Voye^ G r a in e s .
Je dois dire encore que, dans les années où les
Semailles font fui vies d’une longue fécherelfe
dans les pays où il y a beaucoup de gibier, dans
les terres très-garnies de pierres, fur lefquelles
la herfe a peu d’a c t io n c e t te méthode a quelques
avantages , en ce que , dans le premier cas, les
graines les plus enterrées trouvent l’humidité né-
ceflairè à leur germination> 8c dans le fécond,:
qu’elles font moins expofées aux dévaftations des
poules , des pigeons , des perdrix , des cailles ,
des corbeaux, des campagnols, des mulots, & c .
Dans les Semailles fur raie , les graines étant
recouvertes feulement par la herfe, fe trouvent
prefque toutes à la même profondeur} aufli germent
elles plus promptement, lorfque l’humidité
eft au point convenable. Ce défaut d’humidité,,
dans certaines années, doit engager à femer le
jour même du labour pour profiter de celle de la-
terre qui a été ramenée à la furface par fuite de ce
labour.
On a propofé de femer l’avoine fur raie, & ,
lorfquelle aura germé,, de labourer le champ,
pour la placer fous raie. Cette pratique , outre
fa dépenfe,, doit avoir plus d'inconvéniens que
d’avantages.
Enterrer la femence femée fur raie , par I@
moyen d'une houe à cheval, à plufieurs foc s ,
femble un moyen d'accorder les partifans des
deux méthodes précitées. En effet, par ce moyen,
la .graine eft moins enterrée que par un labour >
8c plus enterrée que par un herfage. Je le recommande
fortement aux méditations des cultivateurs.
Voyei Houe a gh-e y a u