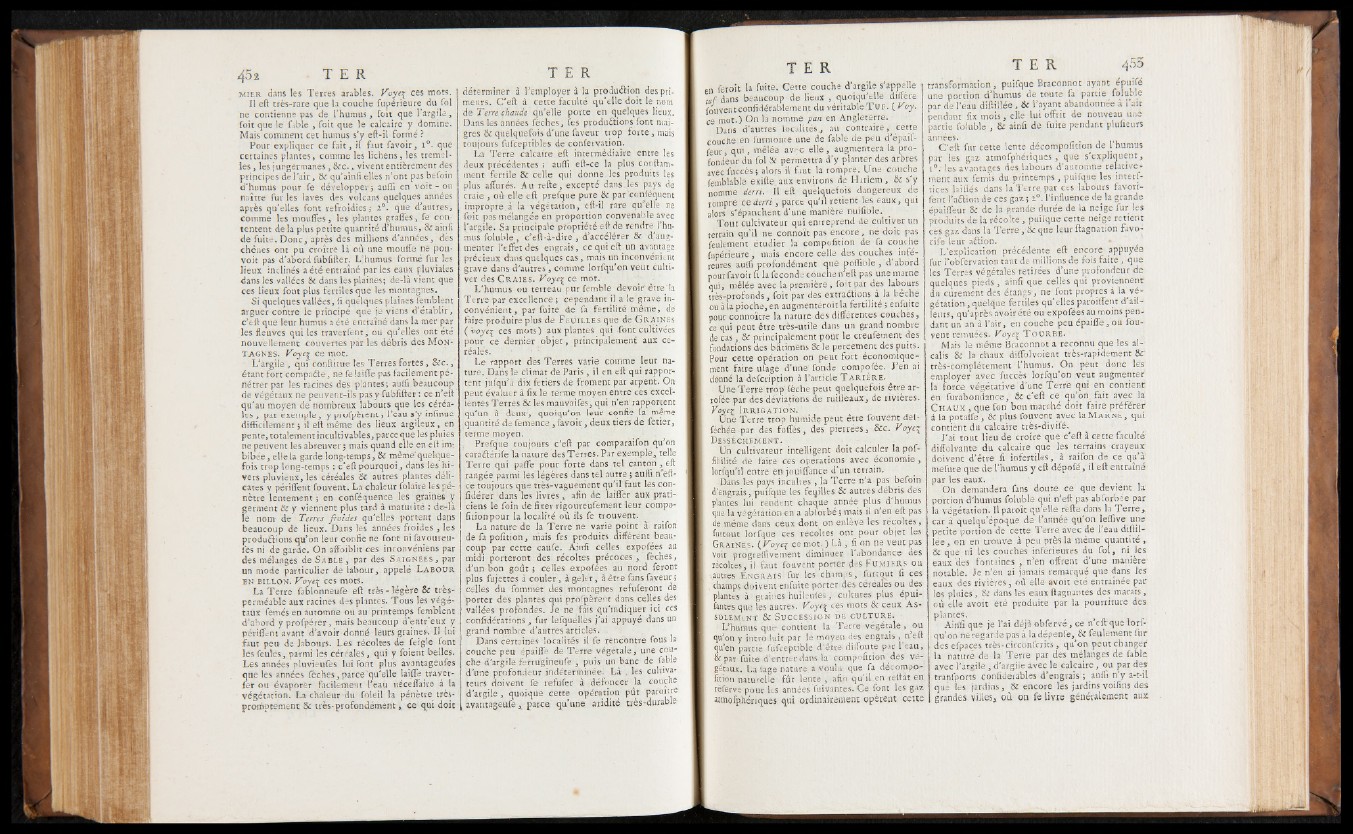
mier dans les Terres arables. Voye\ ces mots.
Il eft très-rare que la couche fupérieure du fol
ne contienne pas de l’humus, foit que l’argile,
foit que le fable , foit que le calcaire y domine.
Mais comment cet humus s’y eft-il formé ?
Pour expliquer ce fa it, il faut favoir, i° . que !
certaines plantes, comme les lichens, les tremel-
le s , les jungermanes, & c . , vivent entièrement des
principes de l ’a ir, 5c qu’ainfi elles n’ont pas befoin
d’humus pour fe développer; auffi en voit - on
naître fur les laves des volcans quelques années
après qu’elles font refroidies j 2°. que d’autres ,
comme les moufles, les plantes graffes, fe contentent
delà plus petite quantité d’humus, & ainfi
de fuite. Donc, après des millions d’années, dès
chênes ont pu croître là où une moufle ne pou-
voit pas d’abord fubfifter. L’ humus formé fur les
lieux inclinés a été entraîné par les eaux pluviales
dans les vallées & dans les plaines; de-là vient que
ces lieux font plus fertiles que les montagnes.
Si quelques vallées, fl quelques plaines femblent
arguer contre le principe que je viens d’établir,
c’eft que leur humus a été entraîné dans la mer par
les fleuves qui les traverfent, ou qu’elles ont été
nouvellement couvertes par les débris des Montagnes.
Voye^ ce mot.
L’ àrgile , qui conftitue les Terres fortes, 5 c c .,
étant fort compacté-, ne fe laiflé pas facilement pénétrer
par les racines des plantes; auffi.beaucoup
de végétaux ne peuvent-ils pas y fubfifter : ce n’eft
qu’ au moyen de nombreux labours que les céréales
, par exemple, y profpèrent > l’eau s’y infinue
difficilement; il eft même des lieux argileux, en
pente, totalement incultivables, parce que les pluies
ne peuvent les abreuver; mais quand elle en eft im:
bibé e, elle la garde long-temps, & même'quelquefois
trop long-temps : c’ eft pourquoi, dans les hivers
pluvieux, les céréales 6c autres plantes délicates
y périfleut fouvent. La chaleur folaire les pénètre
lentement ; en conféquence les graines y
germent & y viennent plus tard à maturité : de-là
le nom de Terres froides qu’elles portent dans
beaucoup de lieux. Dans les années froides, les
productions qu’ on leur confie ne font ni favoureu-
l'es ni de garde. On affoiblit ces inconvéniens par
des mélanges de Sa b l e , par des S a ig n é e s , par
un mode particulier de labour,, appelé L abour,
en billon. Voye^ ces mots.
La Terre fablonneufe eft très-légère & très-
perméable aux racines des plantes. Tous les végétaux
femés en automne ou au printemps femblent
d’abord y profpérer, mais beaucoup d’entr’eux y
périflent avant d’avoir donné leurs graine*. Il lui-
faut peu de labours. Les récoltes de feigle font
les feules, parmi les céréales, qui y fôient belles.
Les années pluvieufes lui font plus avantageufes
que les années fèches, parce qu'elle laifle traver-
fer ou évaporer facilement l’ eau néceflaire à la
végétation. La chaleur du foleil la pénètre tres-
promptement 5 c très-profondément,, ce qui doit
déterminer à l’employer à la production des primeurs.
C ’eft à cette faculté qu’ elle doit le nom
de Terre chaude qu’elle porte en quelques lieux.
Dans les années fèches, fes productions font maigres
& quelquefois d’ une faveur trop forte, mais
toujours fufceptibles de confervation.
La Terre calcaire eft intermédiaire entre les
deux précédentes ; auffi eft-ce la plus conftam-
ment fertile 5c celle qui donne les produits les
plus affurés. Au refte, excepté dans-les pays de
craie , ou elle eft prefque pure & par conséquent
impropre.à la végétation, eft-il rare qu’elle ne
foit pas mélangée en proportion convenable avec
l’argile. Sa principale propriété eft de rendre l’humus
foluble, c’eft-à-dire, d’accélérer & d’augmenter
l’effet des engrais, ce qui eft un avantage
précieux dans quelques cas, mais un inconvénient
grave dans d’autres, comme lorfqu’on veut cultiver
des C r a ie s . Voye% ce mot.
L’humus ou terreau pur Semble devoir'être la
Terre par excellence ; cependant il a le grave inconvénient,
par fuite de fa fertilité même, de
faire produire plus de F euilles que de G raines
( voye? ces mots) aux plantes qui -font cultivées
pour ce dernier o b je t, principalement aux céréales^
Le rapport des Terres varie comme leur nature.
Dans le climat de Paris, il en eft qui rapportent
jufqu’ à dix fetiers de froment par arpent. On
peut évaluer à fix le terme moyen entre ces excellentes
Terres 5c les mauvaifes, qui n’en’rapportent
qu’ un à deux, quoiqu’on leur confie la même
•quantité de femence,favoir, deux tiers de fetier,
terme moyen.
Prefque toujours c ’eft par comparaison qu’on
caraélérife la nature des Terres. Par exemple, telle
Terre qui pafie pour forte dans tel canton, eft
rangée parmi les légères dans tel autre ; aufli.n’eft-
ce toujours que très-vaguement qu’il faut les con-
I fldérer dans les livres, afin de laifîer aux praticiens
le foin dé fixer rigoureufément leur composition
pour la localité où ils fe trouvent.
La nature de la Terre ne varie point à raifon
de fa pofition, mais fes produits diffèrent beaucoup
par cette caufe. Ainfi celles expofées au
midi porteront des récoltes précoces, fèches,
d’un bon goût ; celles expofées au nord feront
plus fujettes à couler, à geler, à être fans fayeur ;
celles du fommet des montagnes refuferont de
porter des plantes qui profpèrent dans celles des
vallées profondes. Je ne fais qu’indiquer ici ces
confédérations, fur lesquelles j ’ai appuyé dans un
grand nombre d’autres articles.
Dans certaines localités il fe rencontre fous la
couche peu épaiffe de Terre végétale, une couche
d’argile ferrugineufe , puis un banc de fable
d’une profondeur indéterminée. Là , les cultivateurs
doivent fe refüfer à défoncer la couche
d ’argile, quoique cette opération pût paroiue
avantageufe 3j parce, qu’ une, aridité trè^-durableen
feroit la fuite. Cette couche d’argile s’appelle
tuf dans beaucoup de lieux , quoiqu’elle diffère
I fouventconsidérablement du véritable T u f . (K oy. I ce mot.) On la nomme pan en Angleterre.
Dans d'autres localités., au contraire, cette
couche en furmonte une de fable de peu d’épaif-
j feUr , q u i, mêlée avec e lle , augmentera la profondeur
du fol & permettra d’ y planter des arbres
avec fuccès; alors il faut la rompre. Une couche
| femblable exifte.aux environs de Harlem, 5c s’ y
nomme derri. Il eft quelquefois dangereux de
rompre ce derri, parce qu’ il retient les eaux, qui
I alors s’épanchent d’une manière nuifible. _
Tout cultivateur qui entreprend de cultiver un
terrain qu’il ne connoît pas encore, ne doit pas
[ feulement étudier la compofition de fa couche
Supérieure, mais encore celle des couches^ infé-
reures auffi profondément qué poflible, d’abord
pour favoir fi la fécondé couche n’eft pas une marne
qui, mêlée avec la première, foit par des labours
très-profonds, foit par des extractions à la beche
ou à la pioche, en augmentéroit la fertilité ; enfui te
pour connoître la nature des différentes couches,
[ ce qui peut être très-utile dans un grand nombre
I de cas, 5c principalement pour le creufement des
[ fondations des bâcimens 5c le percement des puits.
Pour cette opération on peut fort economique- I ment faire ufage d’une fonde compofée. J’en ai
donné la defeription à l’article T a r iè r e . |
Une Terre trop fèche peut quelquefois etre ar-
rofée par des déviations de ruifleaux, de rivières.
I Koyei Ir r ig a t io n .
Une Terre trop humide peut être fouvent def-
■ féchée par des fofles, des pierrées, & c . Voye%
I Dessèchement. ^ -
Un cultivateur intelligent doit calculer la pof-
■ jibilité de faire ces opérations avec économie,
I lorfqu’ il entre en jouiflance d’ un terrain.
Dans les pays incultes , la Terre n’ a pas befoin I d’engrais, puifque les feuilles & autres débris des I plantes lui rendent chaque année plus d’humus
I que la végétation en a abforbé > mais il n’ en eft pas I de même dans ceux dont on enlève les récoltes, I furtout lorfque ces récoltes ont pour objet les I Graines. ( Voye^ ce mot. ) Là , fi on ne veut pas
| voir progreffivement diminuer 1 abondance des
■ récoltes, il faut fouvent porter des Fum ie r s ou
I -..autres Engrais fur les champs, furtout fi ces
| champs doivent enfuite porter des céréales ou des I plantes à graines huileufes, cultures plus épui-
I fantes que les autres. Voye^ ces mots & ceux As- I solemlnt & Succession de culture.
L’humus que contient la Terre végétale, ou
1; qu’on y introduit par le moyen des engrais , n eft
I qu’en partie füfceptible d’être diifoute par 1 eau,
I & par fuite d’entrer dans la compofition des ve- I gétaux. La Sage nature, a voulu que fa dé.corppo- I fition naturelle fût lente , afin qu'il en reftât en 1 réferve pour les années fuivantes. Ce font les gaz
I atmofphériques qui ordinairement opèrent cette
transformation, puifque Braconnot ayant épuife
une portion d’ humus de toute fa partie foluble
par de l’eau diftillée, & l’ ayant abandonnée à l'air
pendant fix mois, elle lui offrit de nouveau une
partie foluble , 5 c ainfi de fuite pendant plufieurs
années. ,
C'ett fur cette lente décompofition de 1 humus
par les gaz atmofphériques, que s’expliquent,
i° ; les avantages des labours d’automne relativement
aux fe mi s du printemps, puifque les interf-
tices laides dans la Terre, par ces labours favori-
fent l’aêtion de ces gaz ; z°. l ’influence de la grande
épàifleur & de là grande durée de la neige fur les
produits de la récolte, puifque cette neigé retient
ces gaz dans la T e r re , & que leur ftagnation favo-
rife leur a&ion.
L ’explication précédente eft encore appuyee
fur l'obfervation tant de millions de fois, faite, que
les Terres végétales'retirées d’une profondeur de
quelques pieds, ainfi que celles qui proviennent
du curement des étangs, ne font propres à ^ v é gétation,
quelque fertiles qu’ elles paroiffent d’ ailleurs,
qu’après avoir été ou expofées au moins pendant
un an à l’air, en couche peu épaifle, ou fouvent
remuées. Voye\ T o u r b e .
Mais le même Braconnot a reconnu que les alcalis
& la chaux diffolvoienr très-rapidement 5 c
très-complètement l’humus. On peut donc les
employer avec fuccès lorfqu’on veut augmenter
la force végétative d’une Terré qui en contient
en furabondance, 8c c’eft ce qu’on, fait avec la
C h a u x , que fon bon marché doit faire préférer
à la potaffe, 8c plus fouvent avec la Ma r n e , qui
contiènt du calcaire très-divifé*
J’ai tout lieu de croire que c’eft à cette faculté'
diflolvante du calcaire que les terrains crayeux
doivent d’être fi infertiles, a raifon de ce qu a
mefure que deThumus y eft dépofé,' il eft entraîné
par les eaux.
On demandera fans doute ce que devient la
portion d’humus foluble qui n’eft pas abforbée par
la végétation. Il paroît qu’elle refte dans la Terre,,
car à quelqu’époque de l’année qu’on leffive une
petite portion de cette Terre avec de l’eau diftillé
e , on en trouve à peu près la même quantité ,
& que ni les couches inférieures du fo l, ni les
eaux des fontaines , n’en offrent d’ une manière-
notable. Je n’en ai jamais remarqué que dans les
eaux des rivières, où elle avoit été entraînée par
les pluies, & dans les eaux ftagnantes des marais,
où elle avoit été produite par la pourriture des
plantés.
Ainfi que je l’ai déjà obfèrvé, ce n’eft que lorfqu’on
ne regarde pas à la dépenfe, 5c feulement fur
des efpaces très-circonfcrits, qu’on peut changer
la nature de la Terre par des mélanges de fable
avec l’argile, d’argile avec le calcaire, ou par des
tranfports confidérables d’ engrais ; auffi n’ y a-t-il
, que les jardins, & encore les jardins voifins des
grandes villes, où on fe livre généralement aux