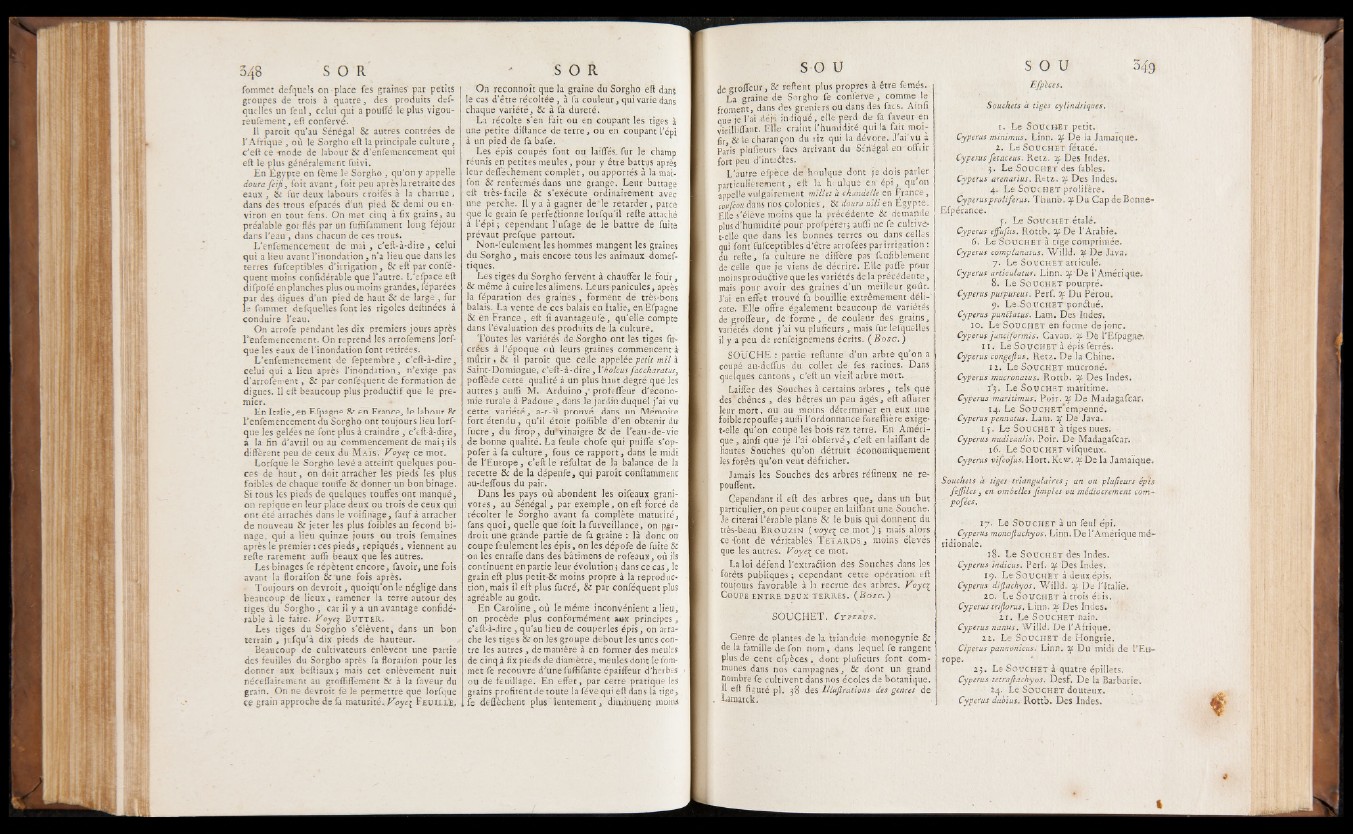
fommet defquels on place fes graines'par petits
groupes de trois à quatre , des produits desquelles
un Seul , celui qui a pouffé le plus vigou-
reufement, eft confervé. 11 paroït qu’au Sénégal & autres contrées de
l’Afrique , où le Sorgho eft la principale culture,
c’eft ce mode de labour & d’enfemencement qui
eft le plus généralement fuivi.
En Égypte on fème le Sorgho 3 qu’on y appelle
doura feifi3 Soit avant, foit peu après la retraite des
eaux 3 & fur deux labours croifés à la charrue,
dans des trous efpacés d’un pied & demi ou environ
en tout Sens. On met cinq à fix grains, au
préalable gorflés par un fuffifamment long Séjour
dans l’eau , dans chacun de ces trous.
L ’enfemencement de mai , c’eft-à-dire, celui
qui a lieu avant l’inondation, n’a lieu que dans les
terres fufceptibles d’irrigation , & eft par conséquent
moins confidérable que l’ autre. L’efpace eft
difpofé en planches plus ou moins grandes, Séparées
par des,digues d’un pied de haut & de large, fur
le fommet defquelles font les rigoles deftinées à
conduire l’eau.
On arrofe pendant les dix premiers jours après
l ’enfemencement. On reprend les arrofemens lorfque
les eaux de l’inondation font retirées.
L ’enfemencement de feptembre, c ’eft-à-dire,
celui qui a lieu après l’inondation, n’exige pas
d’arrofement, & parconféquent de formation de
digues. Il eft beaucoup plus productif que le premier.
En Italie, en Efpagne & en France, le labour 8c
l ’enfemencement du Sorgho ont toujours lieu lorf-
que les gelées ne font plus à craindre , c’ eft-à-dire,
à la fin d’ avril ou au commencement de mai, ils
diffèrent peu de ceux du M a ïs . Voyeç ce mot.
Lorfque le Sorgho levé a atteint quelques pouces
de haut, on doit arracher lés pieds les plus
foibles de chaque touffe & donner un bon binage.
Si tous les pieds de quelques touffes ont manqué,
on repique en leur place deux ou trois de ceux qui
ont été arrachés dans le voifinage, fauf à arracher
de nouveau & jeter les plus foibles au fécond binage,
qui a lieu quinze jours ou trois femaines
après le premier : ces pieds, repiqués, viennent au
refte rarement auffi beaux que les autres.
Les binages fe répètent encore, favoir, une fois
avant la floraifon &'une fois après.
- Toujours on devroit, quoiqu’on le néglige dans
beaucoup dé lieux, ramener la terre autour des
tiges du Sorgho , car il y a un avantage confidérable
à le faire. Voye[ Bu t t e r .
Les tiges du Sorgho s’élèvent, dans un bon
terrain, jufqu’à dix pieds de hauteur.
Beaucoup de cultivateurs enlèvent une partie
des feuilles du Sorgho après fa floraifon pour les
donner aux beftiaux > mais cet enlèvement nuit
néceffairement au groffiffement & à la faveur du
grain. On ne devroit fe le permettre que lorfque
ce grain approche de fa maturité.. Voye{ Feuillue,
On reconnoîc que la graine du Sorgho eft dans
le cas d’être récoltée, à fa couleur, qui varie dans
chaque variété, & à fa dureté.
La récolte s’en fait ou en coupant les tiges à
une petite diltance de terre, ou en coupant l’épi
à un pied de fa bafe.
Les épis coupés font ou laiffés, fur le champ
réunis en petites meules, pour y être battus après
leur defféchement complet, ou apportés à la mai-
fon & renfermés dans une grange. Leur battage
eft très-facile & s’exécute ordinairement avec
une perche. Il y a à gagner de*le retarder, parce
que le grain fe perfectionne lorfqu’il refte attaché
à l’épi i cependant l’ufage de le battre de fuite
prévaut prefque partout.
Non-feulement les hommes mangent les graines
du Sorgho , mais encore tous les animaux domef-
tiques.
Les tiges du Sorgho fervent à chauffer le four,
& même à cuire les alimens. Leurs panicules, après
la réparation des graines, forment de très-bons
balais. La vente de ces balais en Italie, en Efpagne
& en France, eft fi avantageufe, qu’elle compte
dans l’évaluation des produits de la culture.
Toutes les variétés de Sorgho ont les tiges fu-
crées à l’époque où leurs graines commencent à
mûrir » & il paroït que celle appelée petit mil à
Saint-Domingue, c’eft-à-dire, Yholcus [acckaratus3
poffède cette qualité à Un plus haut degré que les
autres } auffi M. Arduino ,• profeffeur d’économie
rurale à Padoue , dans le jardin duquel j’ai vu
cette variété, a-t-il prouvé dans un Mémoire
fort étendu, qu’il étoit poffible d’en obtenir du
fucr-e, du firop, du'vinaigre & de l’eau-de-vie
de bonne qualité. La feule chofe qui puilfe s’op-
pofer à fa culture, fous ce rapport, dans le midi
de l’Europe, c ’eft le réfultat de la balance de la
recette & de la dépenfe, qui paroït conftamment
au-deffous du pair.
Dans les pays où abondent les oifeaux granivores,
au Sénégal, par exemple, on eft forcé de
récolter le Sorgho avant fa complète maturité,
fans quoi, quelle que" foit la furveillance, on pgr-
droit une grande partie de fa graine : là donc on
coupe feulement les épis, on les dépofe de fuite 8c
on les enraffe dans des bâtimens de rofeaux, où ils
continuent en partie leur évolution} dans ce cas, le
grain eft plus petit-& moins propre à la reproduction,
mais il eft plus fucré, & par conféquent plus
agréable au goût.
En Caroline, où le même inconvénient a lieu,
on procède plus conformément a**x principes,
c’eft-à-dire, qu’au lieu de couper les épis, on arrache
les tiges & on fes groupe debout les unes contre
les autres, de manière à en former des meules
de cinq à fix pieds de diamètre, meules dont le fommet
fe recouvre d’une fuffifante epaiffeur d’herbes
ou de feuillage. En effet, par cette pratique les
grains profitent de toute la fève qui eft dans la tige,
fe deffèchent plu« lentement, diminuent moins
de groffeur, 8c reftent plus propres à être femés.
La graine de Sorgho fe conferve, comme le
froment, dans des greniers ou dans des facs. Ainfi
que je l ’ai déjù indiqué, elle perd de fa faveur-en
vieilliffant. Elle craint Vhumidité qui la fait moi-
fir, & le charançon du riz qui la dévore. J’ai vu à
Paris plufieurs facs arrivant du Sénégal en offrir
fort peu d’intaéies.
L’autre efpèce de houlque dont je dois parler
particulièrement, eft la h< ulque en épi, qu’ on
appelle vulgairement millet à chandelle en France,
coufcou dans nos colonies, & doura nili en Egypte.
Elle s’élève moins que la précédente & demande
plus d’humidité pour profpérer} auffi ne fe cultive-
t-elle que dans les bonnes terres ou dans celles
qui font fufceptibles d’être arrofées par irrigation :
du refte, fa culture ne diffère pas fenfiblement
de celle que je viens de décrire. Elle paffe pour
moins productive que les variétés de la précédente,
mais pour avoir des graines d’un meilleur goût.
J’ai eh effet trouvé fa bouillie extrêmement déli-"
cate. Elle offre également beaucoup de variétés
de groffeur, de formeJ de couleur des grains,
variétés dont j'ai vu plufieurs, mais furlelquelles
il y a peu de renfeignemens écrits. ( B o s c . )
SOUCHE : partie reliante d’un arbre qu’on a
coupé au-deffus du collet de fes racines. Dans
quelques cantons, c ’eft un vieil arbre mort.
Laiffer des Souches à certains arbres, tels que
des'chênes , des hêtres un peu âgé s, eft afiurer
leur mort, ou au moins déterminer en eux une
foible repouffe} auffi l’ordonnance foreftière exige-
t-elle qu’on coupe les bois rez terre. En Amérique,
ainfi que jè l’ai obfervé, c’eft en laiffant de
hautes Souches qu’on détruit économiquement
les forêts qu’on veut défricher.
Jamais les Souches des arbres réfineux ne repouffent.
Cependant il, eft des arbres que, dans un but
particulier, on peut couper en laiffant une Souche.
Je citerai l’érable plane & le buis qui donnent du
très-beau Br o u z in ( voyetf ce m o t)} mais alors
ce «font de véritables T êt a r d s , moins élevés
que les autres. Voye% ce mot.
La loi défend l’extraélion des Souches dans les
forêts publiques ; cependant cette opération eft
toujours favorable à h recrue des arbres. Voyeç
Coupe entre deux t e r re s . (Bosc.)
SOUCHE T. Cyperus.
Genre de plantes de la triandrie monogynie Sc
de la famille de Ton nom, dans lequel fe rangent
plus de cent efpèces, dont plufieurs font communes
dans nos campagnes, & dont un grand
nombre fe cultivent dans nos .écoles de botanique.
Il eft figuré pl. 3$ des lllufirations des genres de
Lamarck.
Efphes.
Souchets à tiges cylindriques.
1. Le Souchet petit.
Cyperus minimiis. Linn. Tf De la Jamaïque.
2. Le Souchet fétacé.
Cyperus fetaceus. Retz. Tf Des Indes.
3. Le Souchet des fables.
Cyperus arenarius. Rttz . tl Des Indes.
4. Le Souchet prolifère.
Cyperusprotiferus. Thunb. 2jcDu CapdeBonne-
Efpérance.
y. Le Souchet étalé.
Cyperus effufus. Rottb. Tf De l ’Arabie.
6 . Le Souchet à tige comprimée.
Cyperus complahatus. Willd. Tf De Java.
• 7. Le Souchet articulé.
Cyperus articulatus. Linn. Tf De l’Amérique.
8. Le Souchet pourpré.
Cyperus purpureus. Perf. Tf Du Pérou.
51. Le~SoucHET ponétué.
Cyperus punftàtus. Lam. Des Indes.
10. Le-Souchet en forme de jonc.
Cyperus junciformis. Cayan. Tf De i’ Efpagne.
11 . Le Souchet à épis ferrés.
Cyperus congeftus. Retz. De la Chine.
12. Le Souchet mucroné. '
Cyperus mucronatus. Rottb. Tf Des Indes.
. 13. Le Souchet maritime.
Cyperus maridmus. Poir. Tf De Madagafcar.
14. Le SoucHET*empenné.
Cyperus pennatus. Lam. Tf De Java.
1 y. Le Souchet à tiges nues.
Cyperus nudicau/is. Poir. De Madagafcar.
16. Le Souchet vifqueux.
Cyperus vifcofus. Hort. Kew\ Tf De la Jamaïque.
Souchets a tiges triangulairesun ou plufieurs épis
[effiles , en ombelles [impies ou médiocrement composes,
17. Le Souchet à un feul épi.
Cyperus monoflachyos. Linn. D e l’Amérique méridionale.
18. Le Souchet des Indes.
Cyperus indicus. Perf. Tf Des Indes.
19. Le Souchet à deux épis.
Cyperus diflachyos. Willd. Tf De l’Italie.
20. Le Souchet à trois épis.
Cyperus triflorus. Linn. Tf Des Indes.
2i. Le Souchet nain.
Cyperus nanus. Willd. De l’Afrique.
22. Le Souchet de Hongrie.
Ciperus pannonicus. Linn. Tf Du midi de l’ Ets-
rope.
25. Le Souchet à quatre épillets.
Cyperus tetraftachyos. Desf. De la Barbarie.
24. Le Souchet douteux.
Cyperus dubius, Rottb. Des Indes. 4É>