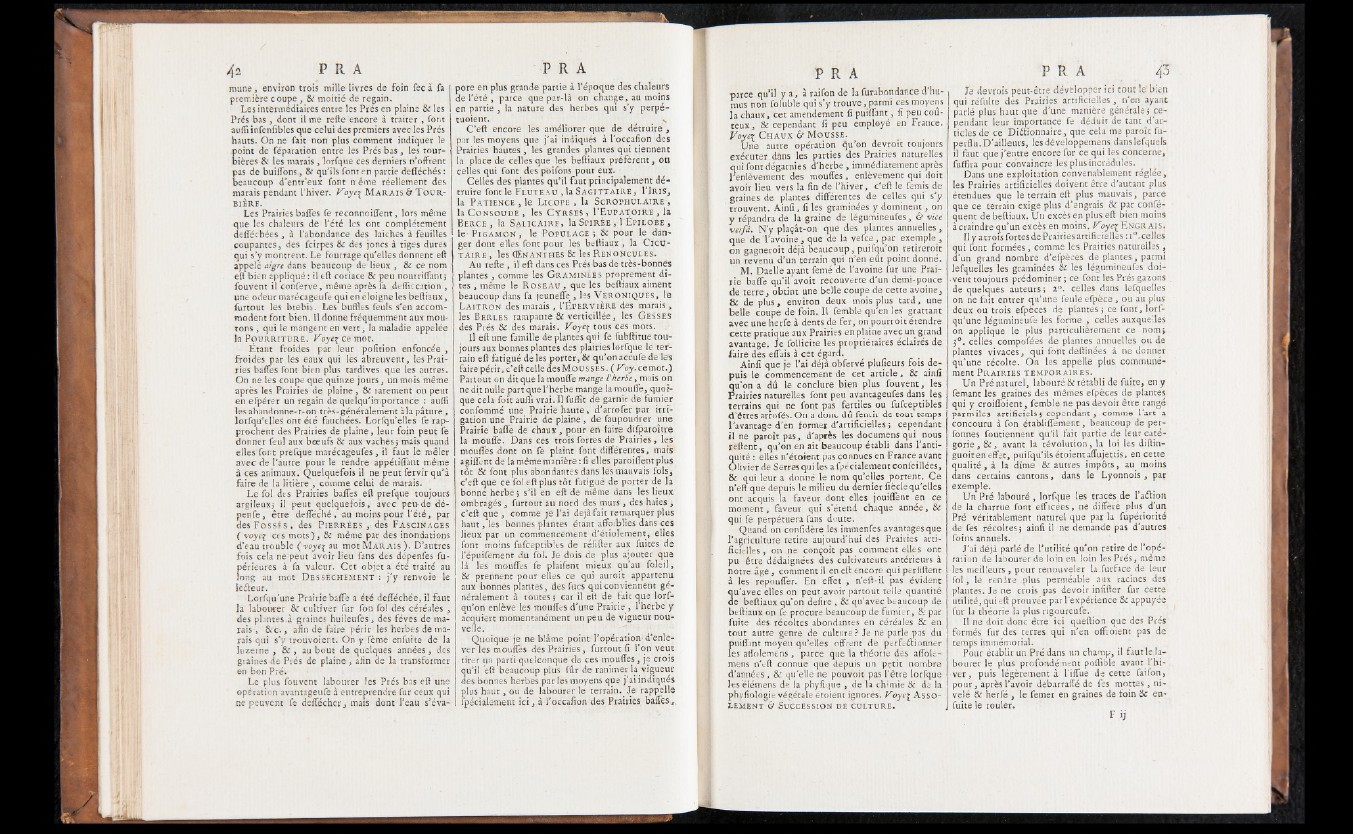
mune, environ trois mille livres de foin fec à fa
première cou p e , & moitié de regain.
Les intermédiaires entre les Prés en plaine 8c les
Prés bas , dont il me refte encore à traiter , font
auflî infenlibles que celui des premiers avec les Prés
hauts. On ne fait non plus comment indiquer le
point de féparation entre les Prés bas , les tourbières
& les marais , ‘lorfque ces derniers n’offrent
pas de buiffons, 8c qu’ ils font en partie defféchés :
beaucoup d’entr’eux font nrême réellement des
marais pendant l'hiver. Voyez Marais & T ourbière.
Les Prairies baffes fe reconnoiffent, lors même
que les chaleurs de l’été les ont complètement
defféchées j à l’abondance des laiches à feuilles
coupantes, des fcirpes 8c des joncs à tiges dures
qui s’y montrent. Le fourrage qu’elles donnent eft
appelé aigre dans beaucoup de lieux , 8c ce nom
eft bien appliqué : il eft coriace 8c peu nourriffant ;
fouvent il conferve, même après fa defficcation ,
une odeur maréeageufe qui en éloigne les beftiaux,
furtout les brebis. Les buffles feuls s’en accommodent
fort bien. Il donne fréquemment aux moutons
, qui le mangent en v e r t3 la maladie appelée
la PçurRiture. Voyez ce mot.
Étant froides par leur pofition enfoncée ,
froides par les eaux qui les abreuvent, lesPrai-
jies baffes font bien plus tardives que les autres.
On ne les coupe que quinze jours, un mois’même
après les Prairies de plaine, 8c rarement on peut
en efpérer un regain de quelqu’importance : aufli
les abandonne-t-on très-généralement àla pâture,
lorfqu’ efleS ont été fauchées. Lorsqu'elles fe rapprochent
des Prairies de plaine, leur foin peut fe
donner feul aux boeufs & aux vaches y mais quand
elles fort prêfque marécageufes, il faut le mêler
avec de l’autre pour le rendre appétiffant même
à ces animaux. Quelquefois il ne peut fervir qu’ à
faire de la litière , comme celui de marais.
Le fol des Prairies baffes eft prefque toujours
argileuxj il peut quelquefois, avec peu-de dé-
penfe, être defféçhé, au moins pour l’é té , par
des Fo s sé s , des Pierrées ,• des Fascinages
( voyez ces mots ), 8c même par des inondations
d’eau trouble ( voyez au mot Marais ). D’autres
fois cela ne peut avoir lieu fans des dépenfes fu-
périeures à fa valeur. Cet objet a été traité au
long au mot Dessèchement : j’ y renvoie le
leéteur.
Lorfqu’une Prairie baffe a été defféchëe, il faut
la labourer 8c cultiver fur fon fol des céréales ,
des plantes-à graines huileufes, des fèves de marais
, & c . , afin de faire périr les herbes de marais
qui s’y trouvoient. On y fème enfui te de la
luzerne , & , au bout de quelques années, des
graines de Prés de plaine, afin de la transformer
en bon Pré*
Le plus fouvent labourer les Prés bas eft une
opération avantageufe à entreprendre fur ceux qui
ne peuvent fe deffécher, mais dont l’eau s’ évapore
en plus grande partie à l’époque des chaleurs
de l’été , parce que par-là on change, au moins
en partie, la nature des herbes qui s’y perpé-
tuoient. %
C ’eft encore les améliorer que de détruire >
par les moyens que j’ ai indiqués à l’occafion des
Prairies hautes, les grandes plantes qui tiennent
la place de celles que les beftiaux préfèrent, ou
celles qui font des poifons pour eux.
Celles des plantes qu’ il faut principalement détruire
font le Fluteau , la Sagittaire , I’Iris,
la Patience , le Licope , la Scrophulatre ,
la C onsoude , les C yrses , I’Eupatoire , la
Ber c e , la Salica ire, l a Spirée, I Épilobe,
le- Pigamon', le Populage } 8c pour le danger
dont elles font pour les beftiaux, la C ic u -
i t a ir e , les (Enanthes 8c les Renoncules.
Au refte , il eft dans ces Prés bas de très -bonnes
j plantes, comme les Graminées proprement di-
I tes , même le Roseau , que les beftiaux aiment
beaucoup dans fa jeunefle , les V éroniques, le
Laitron des marais , I’Éperviere des marais,
les Berles rampante & verticillée, les Gesses
des Prés 8c des marais. Voyez tous ces mots.
Il eft une famille de plantes qui fe fubftitue toujours
aux bonnes plantes des plairies lorfque le terrain
eft fatigué de les porter, & qu’on accufe de les
faire périr, c’ eft celle des Mou s s e s . ( Voy. ce mot.)
Partout on dit que la moufle mange l'herbe, mais on
ne dit nulle part que l’ herbe mange la moufle, quoique
cela foit aufli vrai. Il fuffit de garnir de fumier
confommé une Prairie haute, d’ arrofer par irrigation
une Prairie de plaine, de Saupoudrer une
Prairie baffe de chaux, pour en faire difparoître
la moufle. Dans ces trois forces de Prairies, les
moufles dont on fe plaint font différentes, mais
agiffent de la même manière: fi elles paroiflentplus
tôt 8c font plus abondantes dans les mauvais fols*
c’ eft que ce fol eft plus tôt fatigué de porter de la
bonne herbe } s’ il en eft de même dans les lieux
ombragés, furtout au nord des murs, des haies;
c’eft que , comme je l’ai déjà fait remarquer plus
haut, les bonnes plantes étant affaiblies dans ces
lieux par un commencement d'étiolement, elles
font moins fufceptibles de réfifter aux fuites de
l’épuifement du fol. Je dois de plus ajouter que
là les moufles fe plaifent mieux qu’au foleil ,
8c prennent pour elles ce qui auroit appartenu
aux bonnes plantes, des fucs qui conviennent généralement
à toutes j car il eft de faic que lorsqu'on
enlève les moufles d’une Prairie , l’herbe y
acquiert momentanément un peu de vigueur nouvelle/
. ‘ ' : ' " - _ :■ ' I.;
Quoique je ne blâme point l’operation'd’enlever
les moufles des Prairies, furtout fi l’on veut
tirer un parti quelconque dé ces moufles, je crois
qu’il eft beaucoup plus fur de ranimer la vigüeut
des bonnes herbes par les moyens que j’ai indiqués
plus haut, ou de labourer le terrain. Je rappelle
fpécialement ic i , à Toccafion des Prairies baffes ,,
parce qu'il y a , à raifon de la furabondance d humus
non foluble qui s’y trouve, parmi ces moyens
la chaux, cet amendement fi puiffant, fi peu coûteux
, 8c cependant fi peu employé en France.
Voyez C haux & Mousse.
Une autre opération £[u’on devroit toujours
exécuter-dans les parties des Prairies naturelles
qui font dégarnies d’herbe, immédiatement après
re lè v em en t des moufles, enlèvement qui doit
avoir lieu vers la fin de l’hiver, c’eft le femis de
graines de plantes différentes de celles qui s’y
trouvent. Ainfi, fi les graminées y dominent, on
y répandra de la graine de légumineufes, & vice
verfâ. N’y plaçât-on que des plantes annuelles,
que de. l’avoine , que de la vefce, j>ar exemple ,
on gagneroit déjà beaucoup, puifqu’ on retireroit
un revenu d’ un terrain qui n’en eût point donné.
M. Daelle ayant femé de l’avoine fur une Prairie
baffe qu’il avoit recouverte d’ un demi-pouce
de terre, obtint une belle coupe de cette avoine,
& de plus, environ deux mois plus tard, une
belle coupe de foin. Il femble qu’en les grattant
avec une herfe à dents de fer, on pourroit étendre
çette pratique aux Prairies en plaine avec un grand
avantage. Je follicite les propriétaires éclairés de
faire des effais à cet égard,
Ainfi que je l’ai déjà obfervé plufieurs fois depuis
le commencement de cet article, & ainfi
qu’on a dû le conclure bien plus fouvent, les
Prairies naturelles font peu avantageufes dans les
terrains qui ne font pas fertiles ou fufceptibles
d’êtres arrofés. On a donc dû fentir de tout temps
l ’avantage d’en former d’artificielles } cependant
il ne paroît pas, d’après les documens qui nous
relient, qu’on en ait beaucoup établi dans l’ antiquité
: elles n’étoient pas connues en France avant
Olivier de Serres qui les a fpécialement confeillées,
8c qui leur a donné le nom qu’elles portent. Ce
n’eft que depuis le milieu du dernier fiècle qu’elles
ont acquis la faveur dont elles jouifient en ce
moment, faveur qui s’étend chaque année, &
qui fe perpétuera fans doute.
Quand on confidère les immenfes avantages que
l ’agriculture retire aujourd’hui des Prairies artificielles
, on me conçoit pas comment elles ont
pu être dédaignées des cultivateurs antérieurs à
notre â g e , comment il en eft encore qui perfiftent
à les repouffer. En effet , n’eft-il pas évident
qu’avec elles on peut avoir partout telle quantité
de beftiaux qu’on defire , 8c qu’avec beaucoup de
beftiaux on fe procure beaucoup de fumier, &: par
fuite des récoltes abondantes en céréales 8c en
tout autre genre de culture ? Je ne parle pas du
puiffant moyen qu’elles offrent de perfectionner
les alfolemens , parce que la théorie des affole-
mens n’ eft connue que depuis un petit nombre
d’années , 8c quelle ne pouvoit pas l ’être lorfque
les élémens de la phyfique , de la chimie 8c de la
phyfiologie végétale étoient ignorés. Voyez A s so lement
ô* Succession de culture.
Je devrois peut-être développer ici tout le bien
qui réfulte des Prairies artificielles, n’en ayant
parlé plus haut que d’une manière générale} cependant
leur importance fe déduit de tant d’articles
de ce Dictionnaire, que cela me paroît fu-
perflu. D ’ailleurs, lesdéveloppemens danslefquels
il faut que j’entre encore fur ce qui les concerne,
fuffira pour convaincre les plus incrédules.
Dans une exploitation convenablement réglée,
les Prairies artificielles doivent être d'autant plus
étendues que le terrain eft plus mauvais, parce
que ce terrain exige plus d’engrais 8c par confé-
quent de beftiaux. Un excès en plus eft bien moins
à craindre qu’un excès en moins. Voyez Engrais.
Il y a trois fortes de Prai ries artificielles : i° . celles
qui font formées, comme les Prairies naturelles ,
d’un grand nombre d’efpèces de plantes, parmi
lefquelles les graminées 8c les légumineufes doi-
•vent toujours prédominer ; ce font les Prés gazons
de quelques auteurs ; 2°. celles dans lefquelles
on ne fait entrer qu’une feule efpèce, ou ail plus
deux ou trois efpèces de plantes} ce font, lorfqu’une
légumineufe les forme , celles auxquelles
on applique le plus particulièrement ce nom,
30. celles compofées de plantes annuelles ou de
plantes vivaces, qui font deftinées à ne donner
qu’une récolte. On les appelle plus communément
Prairies temporaires.
Un Pré naturel, labouré 8c rétabli de fuite, en y
femant les graines des mêmes efpèces de plantes
qui y croiffoient, femble ne pas devoir être rangé
parmiles artificiels} cependant, comme l ’art a
concouru à fon établiffement, beaucoup de personnes
foutiennent qu’il fait partie de leur catégor
ie , 8c, avant la révolution, la loi les diftin-
guoit en effet, puifqu’ ilsétoienyaffujettis, en cette
qualité, à la dîme 8c autres impôts, au moins
dans certains cantons, dans le Lyonnois , par
exemple.
Un Pré labouré, lorfque les traces de l’aétion
de la charrue font effacées, ne diffère plus d’un
Pré véritablement naturel que par la fupériorité
de fes récoltes} ainfi il ne demande pas d’autres
foins annuels.
J’ai déjà parlé de l’ utilité qu’ on retire de l’opération
de labourer de loin en loin les Prés, même
les meilleurs, pour renouveler laJurface de leur
fo l, le rendre „plus perméable aux racines des
plantes. Je ne crois pas devoir infifter fur cette
utilité, qui eft prouvée par l'expérience 8c appuyée
fur la théorie la plus rigoureufe.
Il ne doit donc être ici queftion que des Prés
formés fur des terres qui n’en offroient pas de
temps immémorial.
Pour établir un Pré dans un champ, il faut le labourer
le plus profondément poflible avant l’hiv
e r , puis légèrement à l'iffue de cette faifon,
pour, après l’avoir débarrafle de fes mottes, nivelé
8c herfé , le femer en graines de foin 8c en-
fuite le rouler.
F i j