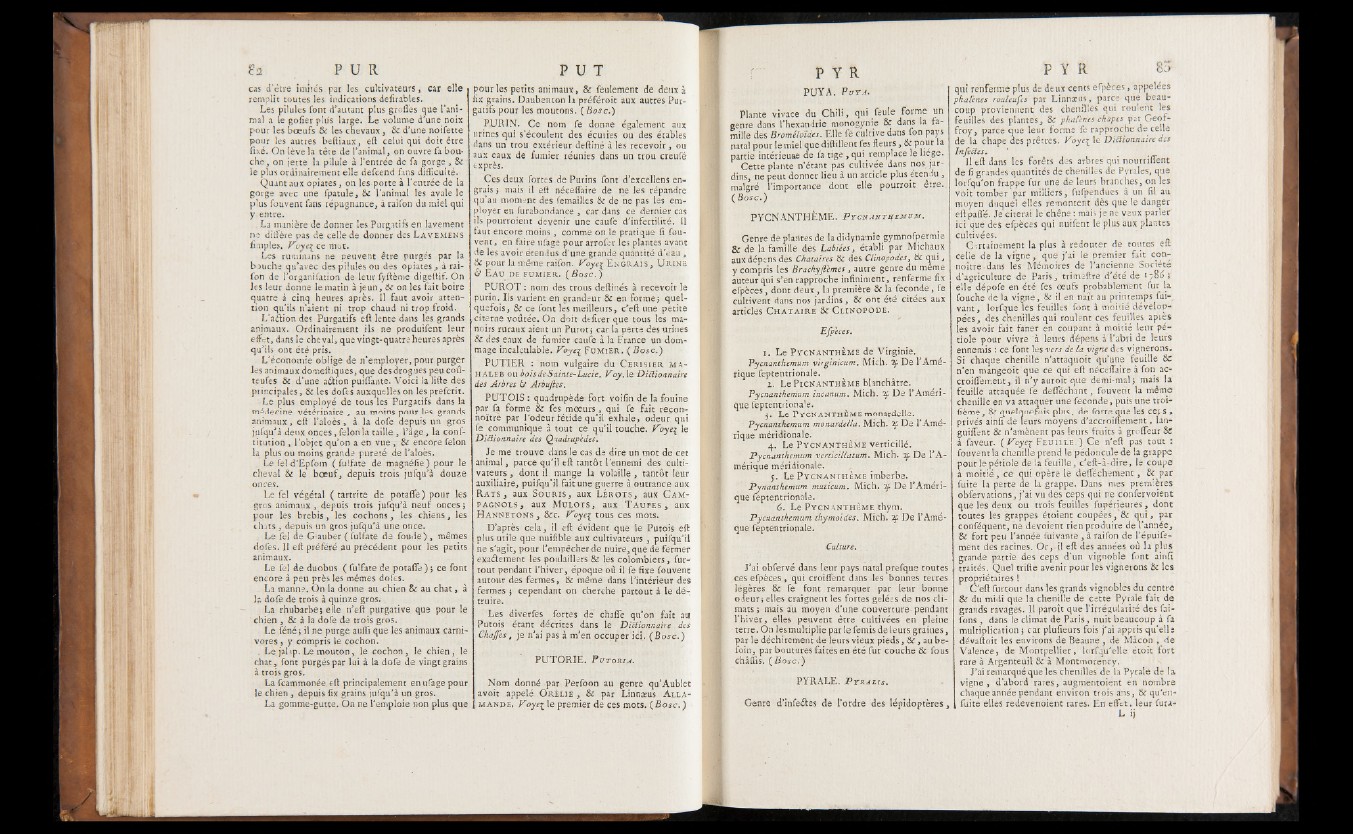
cas d'être imités par les cultivateurs, car elle
remplit toutes les indicationsdefirables.
Les pilules font d’autant plus girofles que ranimai
a le gofier plus large. Le volume d’une noix
pour les boeufs & les chevaux, & d’une noifette
pour les autres beftiaux, eft celui qui doit être
fixé. On lève la tête de l’animal, on ouvre fa bouche
, on jette la pilule à l’entrée de fa gorge , &
le plus ordinairement elle defcend fans difficulté.
Quant aux opiates, on les porte à l’entrée de la
gorge avec une fpatule, & l’animal les avale le
plus fouvent fans répugnance, à raifon du miel qui
y entre.
La manière de donner les Purgatifs en lavement
ne diffère pas de celle de donner des Lavemens
Amples. Voye^ ce mot.
Les ruminans ne peuvent être purgés par la
bouche qu’avec des pilules ou des opiates , à raifon
de l’organiCation de leur fyftème digeltif. On
les leur donne le matin à jeun, & on les fait boire
quatre à cinq heures après. Il faut avoir attention
qu’ ils n’aient ni trop chaud ni trop froid.
L’a&ion des Purgatifs eft lente dans les grands
animaux. Ordinairement ils ne produifent leur
effet, dans le cheval, que vingt-quatre heures après
qu’ ils ont été pris.
L’économie oblige de n’employer, pour purger
les animaux domeftiques, que des drogues peu coû-
teufes & d’une aêtion puiflante. Voici la lifte des
principales, & les dofes auxquelles on les prefcrit.
Le plus employé de tous les Purgatifs dans la
médecine vétérinaire , au moins pour les grands
animaux, eft l’aloès, à la dofe depuis un gros
jufqu’ à deux onces, félon la taille, l’â g e , la conf-
titution, l'objet qu’on a en vue, & encore félon
la plus ou moins grande pureté de l’aloès.
Le fel d'Epfom ( fuifate de magnéfie) pour le
cheval & le boe u f, depuis trois jufqu’ à douze
onces.
Le fel végétal ( tartrite de potafle) pour les
gros animaux, depuis trois jufqu’ à neuf onces ;
pour les brebis, les cochons, les chiens, les
chats, depuis un gros jufqu’ à une once.
, Le fel de Giauber ( fuifate de foude) , mêmes
dofes. Il eft préféré au précédent pour les petits
animaux.
Le fel de duobus ( fuifate de potafle ) j ce font
encore à peu près les mêmes dofes.
L3 manne. On la donne au chien & au chat, à
la dofe de trois à quinze gros.
La rhubarbe; elle n’ eft purgative que pour le
chien , & à la dofe de trois gros.
Le féné ; il ne purge aufli que les animaux carnivore
s , y compris le cochon.
. Le jalip. Le mouton, le cochon, le chien, le
chat, font purgés par lui à la dofe de vingt grains
à trois gros.
La fcammonée. eft principalement enufage pour
le chien, depuis fix grains jufqu’à un gros.
La gomme-gutte. On ne l’emploie non plus que
pour les petits animaux, & feulement de deux à
fix grains. Daubenton la préféroit aux autres Purgatifs
pour les moutons. ( Base.)
PURIN. Ce nom fe donne également aux
urines qui s’écoulent des écuries ou des étables
dans un trou extérieur deftiné à les recevoir, ou
aux eaux de fumier réunies dans un trou creufé
exprès.
Ces deux fortes de Purins font d’excellens engrais
j mais il eft néceflaire de ne les répandre
qu’au moment des femailles & de ne pas les employer
en furabondance , car dans ce dernier cas
ils pourroient devenir une caufe d’ infertilité. Il
faut encore moins, comme on le pratique fi fou-
vent, en faire nfage pour arrofer les plantes avant
de les avoir étendus d’une grande quantité d'eau ,
Ôc pour la même raifon. Voye[ E ngrais, Urine
& Eau de fumier. ( B o s c .)
PUROT : nom des trous deftinés à recevoir le
purin. Ils varient en grandeur & en forme; quelquefois,
& ce font les meilleurs, c’eft une petite
citerne voûtée. On doit defirer que tous les manoirs
ruraux aient un Purot; car la perte des urines
& des eaux de fumier caufe à la France un dommage
incalculable. Voye^ Fumier. ( B osc.)
PUTIER : nom vulgaire du C erisier ma-
HALEB ou bois de Sainte-Lucie. Voy. le Dictionnaire
des Arbres & Arbufies.
PUTOIS : quadrupède fort voifîn de la fouine
par fa forme & fes moeurs, qui fe fait recon-
noître par l'odeur fétide qu’ il exhale, odeur qui
fe communique à tout ce qu’il touche. Voye\ le
Dictionnaire des Quadrupèdes.
Je me trouve dans le cas de dire un mot de cet
animal, parce qu’ il eft tantôt l'ennemi des cultivateurs
, dont il mange la volaille , tantôt leur
auxiliaire, puifqu’ il fait une guerre à outrance aux
Rats , aux Souris, aux Léro ts , aux C ampagnols,
aux Mulots, aux T au p e s , aux
Hannetons , &c. Voyei tous ces mots.
D’après cela, il eft évident que le Putois eft
plus utile que nuifible aux cultivateurs , puifqu’ il
ne s’agit, pour l’empêcher dé nuire, que de fermer
exactement les poulaillers & les colombiers, fur-
tout pendant l’hiver, époque où il fe fixe fouvent
autour des fermes, & même dans l ’intérieur des
fermes ; cependant on cherche partout à le détruire.
Les diverfes fortes de chafle qu’on fait au
Putois étant décrites dans le Dictionnaire dei
Chajfes, je n’ai pas à m’en occuper ici. (B o s c .)
PUTORIE. PüTORJA.
Nom donné par Perfoon au genre qu’Aublet
avoit appelé. Orélie , & par Linnæus Alla-
mande, Voye{ le premier de ces mots. (B o s c .)
PUYA. P u r a .
Plante vivace du C h ili, qui feule forme un
genre dans l’hexandrie monogynie & dans la famille
des Broméloïdes. Elle fe cultive dans fon pays
natal pour le miel que diftillent fes fleurs, & pour la
partie intérieure de fa tig e , qui remplace le liege.
Cette plante n’étant pas cultivée dans nos jardins,
ne peut donner lieu à un article plus étendu,
malgré l’importance dont elle pourroit etre.,
( Bosc.)
PYCNANTHÈME. P y c n a n t h em u m .
Genre de plantes de la didynamie gymnofpermie
& de la famille des Labiées, établi par Michaux
aux dépens des Châtains & des CLinopodes, & q u i,
y compris les Brachyfiémes, autre genre du même
auteur qui s’en rapproche infiniment, renferme fix
efpèces, dont deux, la première & la fécondé , fe
cultivent dans nos jardins, & ont été citees aux
articles Chataire & C linopode.
Efpèces.
1. Le Pycnanthème de Virginie.
Pycnantkemum virginicum. Mich. Tf. De l’Amérique
feptentrionale.
2. Le Picnantheme bhnchâtre.
Pycnanthemum incanum. Mich. De i*Amérique
feptentrionale.
3. Le P ycnanthème monardelle.
Pycnanthemum monardella. Mich. 'if De l’Amérique
méridionale.
4. Le Pycnanthème verticillé.
Pycnanthemum verticillatum. Mich. if. De l’A mérique
méridionale.
5. Le Pycnanthème imberbe.
Pynanthemum muticum. Mich. "2f. De l’Amérique
feptentrionale.
6 . Le Pycnanthème thym.
Pycnanthemum thymoides. Mich. De l’Amé-
que feptentrionale.
Culture.
J’ai obfervé dans leur pays natal prefque toutes
ces efpèces , qui croiflent dans les bonnes terres
légères & fe font remarquer par leur bonne
odeur; elles craignent les fortes gelées de nos climats;
mais au moyen d’une couverture-pendant
l’ hiver, elles peuvent être cultivées en pleine
terre. On les multiplie par le femis de leurs graines,
par le déchirement de leurs vieux pieds, & , au be-
foin, par boutures faitésen été fur couche & fous
châflis. (B o s c .)
PYRALE. P y r a l i s .
Genre d’infeétes de l’ordre des lépidoptères,
qui renferme plus de deux cents efpèces, appelées
phalènes rouleufcs par Linnæus, parce que beaucoup
proviennent des chenilles qui roulent les
feuilles des plantes, & phalènes chapes par Geoffroy,
parce que leur forme fe rapproche de celle
de la chape des prêtres. V o y le Dictionnaire des
Infectes*
Il eft dans les forêts des arbres qui. nourriflent
de fi grandes quantités de chenilles de Py raies, que
lorfqu’on frappe fur une de leurs branches, on les
voit tomber par milliers, fufpendues à un fil au
moyen duquel elles remontent dès que le danger
eft pafl’é. Je citerai le chêne : mais je ne veux parler
ici que des efpèces qui nuifent le plus aux plantes
cultivées.
Certainement la plus à redouter de toutes eft
celle de la vigne, que j’ ai le premier fait con-
noître-dans les Mémoires de l’ancienne Société
d’agriculture de Paris, trimeftre d’ été de 1786}
elle dépofe en été fes oeufs probablement fur la
Couche de la vigne, & il en naît au printemps lui-
vant, lorfque les feuilles font à moitié développées,
des chenilles qui roulent ces feuilles après
I les avoir fait faner en coupant à moitié leur pétiole
pour vivre à leurs dépens à l’ abri de leurs
ennemis : ce font les vers de la vigne de s vignerons.
Si chaque chenille n’attaquoit qu’une feuille &
n’en mangeoit que ce qui eft néceflaire à fon ac-
croiflemènt, il n’y auroit que demi-mal; mais la
feuille attaquée fe deflechant, fouvent la même
chenille en va attaquer une fécondé, puis une troi-
fième, & quelquefois plus, de forte que les ceps ,
privés ainfi de leurs moyens d’accroiflement, lan-
guiflent & n’amènent pas leurs fruits à grofleur &
à faveur. ( Voye^ Feu il l e .) C e n’eft pas tout i
fouvent la chenille prend le pédoncule de la grappe
pour le pétiole de la feuille, c’eft-à-dire, le coupe
à moitié, ce qui opère le deflechement, & par
fuite la perte de la grappe. Dans mes premières
obfervations, j’ai vu des ceps qui ne confervoient
que les deux ou trois feuilles fupérieures, dont
toutes les grappes étoient coupées, & q u i, par
conféquent, ne dévoient rien produire de l’année,
& fort peu l’année fui vante, à raifon de l’épuife-
ment des racines. O r , il eft des années où la plus
grande partie des ceps d’un vignoble font ainfi
traités. Quel trifte avenir pour les vignerons & les
propriétaires !
C ’eft furtout dans les grands vignobles du centre
& du midi que la chenille de cette Pyrale fait de
grands ravages. Il paroît que l'irrégularité des faisons
, dans le climat de Paris, nuit beaucoup à fa
multiplication ; car plufieurs fois j’ ai appris qu’elle
dévaftoit les environs de Beaune, de Mâcon , de
Valence, de Montpellier, lorfqu’elle étoit fort
rare à Argenteuil & à Montmorency.
J’ai remarqué que les chenilles de la Pyrale de la
v igne, d’abord rares, augmentoient en nombre
chaque année pendant environ trois ans, & q u ’en-
1 fuite elles redevenaient rares. En effet, leur fura-
L ij