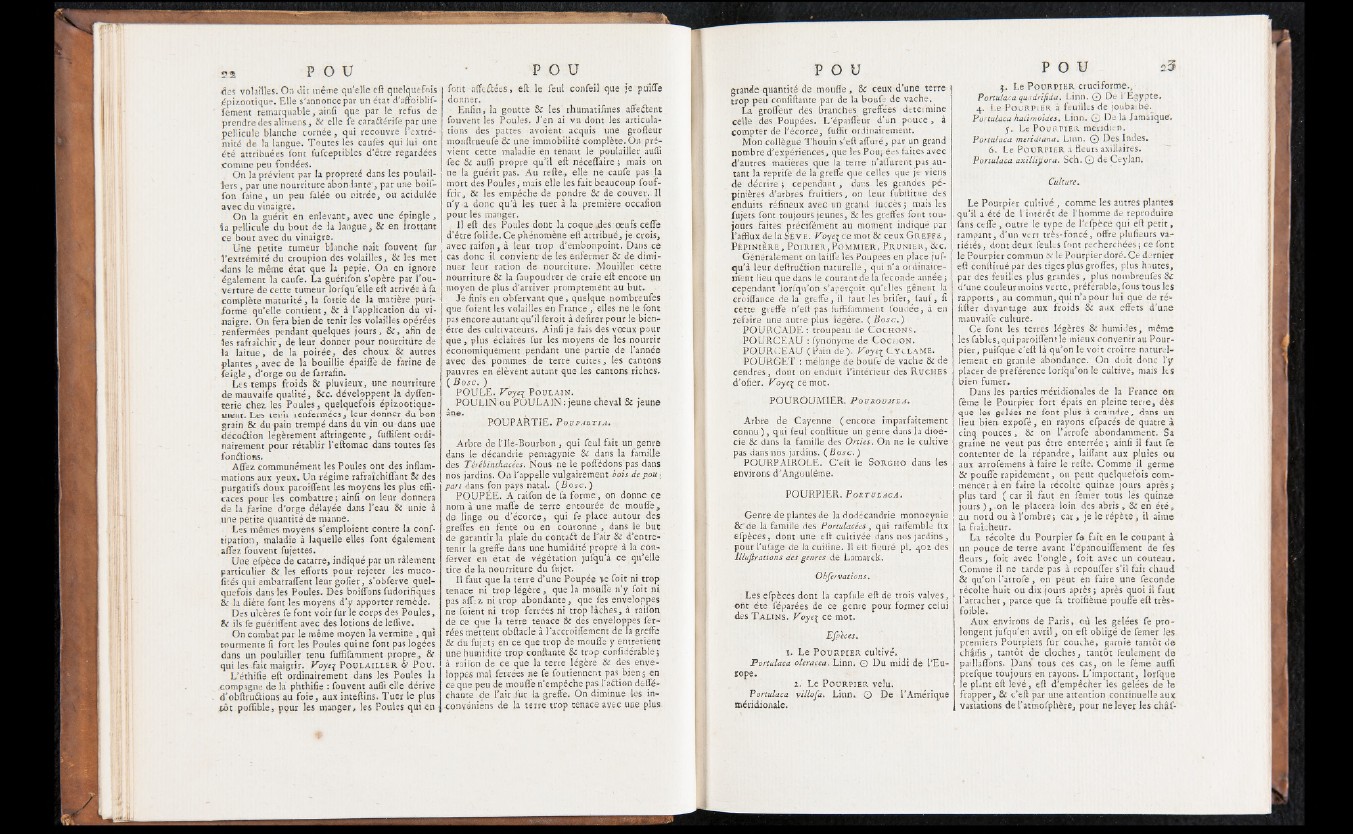
<ies volailles. On die même qu’elle eft quelquefois
.épizootique. Elle s'annonce par un état d’affoiblif-
îement remarquable , ainfi que par le refus de
prendre des alimens j & elle fe cara&érife par une
pellicule blanche cornée , qui recouvre l’extrémité
de la langue. Toutes les caufes qui lui ont
été attribuées font fufceptibles d’ être regardées
Comme peu fondées.
On la prévient par la propreté dans les poulaillers
, par une nourriture abondante", par une boif-
fon faine, un peu falée ou nitrée, ou acidulée
avec du vinaigre.
On la guérit en enlevant,, avec une épingle,
la pellicule du bout de la langue, & en frottant
ce bout avec du vinaigre.
Une petite .tumeur Manche naît fouvent fur
l ’extrémité du croupion des volailles, & les met
•dans le même état que la pepie. On en ignore
également la caufe. La guérifcn s’opère par l’ouverture
de cette tumeur lorfqu’elle eft arrivée à fa
complète maturité * la forrie de la matière puri-
forme qu’elle contient, & à l’application du v inaigre.
On fera bien de tenir les volailles opérées
renfermées pendant quelques jours, & , afin de
les rafraîchir, de leur donner pour nourriture de
la laitue, de la poirée, des choux 8c autres
plantes, avec de la bouillie épaiffe de farine de
fe ig le , d’orge ou de farrafin.
Les temps froids & pluvieux, une nourriture
de mauvaife qualité, & c . développent la dyffen-
terie chez les Poules, quelquefois épizootique-
ment. Les tenir renfermées, leur donner du bon
grain & du pain trempé dans du vin ou dans une
décoétion légèrement aftringente, fuffifent ordinairement
pour rétablir l’eftomac dans toutes les
fondions.
Affez communément les Poules ont des inflammations
aux yeux. Un régime rafraîchilfant 8c des
purgatifs doux paroiffent les moyens les plus efficaces
pour les combattre ; ainfi on leur donnera
de la farine d’orge délayée dans l’eau 8c unie à
une petite quantité de manne.
Les mêmes moyens s’emploient contre la conf-
tipation, maladie à laquelle elles font également
allez fouvent fujettes.
Une efpèce de catarre, indiqué par un râlement
particulier & les efforts pour rejeter les muco-
ficés qui embarraffent leur gofier, s’obferve quelquefois
dans les Poules. Dés boiffons fudorifiques
& la diète font les moyens d’y apporter remède.
Des ulcères fe font voir fur le corps des Poules,
& ils fe guériffent avec des lotions de leffive.
On combat par le même moyen la vermine , qui
tourmente fi fort les Poules qui ne font pas logées
dans un poulailler tenu fuffifamment propre., &
qui les fait maigrir. Voye^ Poulailler h Pou.
L’éthifie eft ordinairement dans les Poules la
compagne de la phthifie : fouvent auffi elle dérive
d’obftru&ions au fo ie , aux inteftins. Tuer le plus
xôt poffible, ppur les manger, les Poules qui-en
: font affe&ées, eft le feul confeil que je piiiffe
donner.
Enfin, la goutte 8c les rhumatifmes affe&ent
fouvent les Poules. J’en ai vu dont les articulations
des pattes avoient acquis une groffeur
monftrueufe & une immobilité complète. On prévient
cette maladie en tenant le poulailler auffi
fec 8c auffi propre qu’ il eft néceffaire j mais on
ne la guérit pas. Au refte^ elle ne caufe pas Ja
mort des Poules, mais elle les fait beaucoup fouf-
frir., & les empêche de pondre 8c dé couver. Il
n’y a donc qu'à les tuer à la première occafion
pour les manger. 11 eft des Poules dont la coque .des oeufs ceffe
d’être folide. Ce phénomène eft attribué, je crois,
avec raifon, à leur trop d’embonpoint. Dans .ce
cas donc il convient' de les enfermer 8c de diminuer
leur ration de nourriture. Mouiller cette
nourriture 8c la faupoudrer de craie eft encore un
moyen de plus d'arriver promptement au but.
Je-finis en obfervant que, quelque nombreufes
que foient les volailles en France , elles ne le font
pas encore autant qu’ il ferait à defirer pour le bien-
être des cultivateurs. Ainfi je fais des voeux pour
que, plus éclairés fur les moyens de les nourrir
économiquement pendant une partie de l’année
avec des pommes de terre cuites, les cantons
pauvres en élèvent autant que les cantons riches.
( B o s c . ) .
POULE. Voy.e[ Poulain.
POULIN ou POULAIN : jeune cheval & jeune
âne.
POUPARTIE. P oupartia.
Arbre de l’Ile-Bourbon , qui feul fait un genre
dans le décandrie pentagynie 8c dans la famille
des Térébinthacées. Nous ne le poffédons pas dans
nos jardins. On l’appelle vulgairement bois de pou >
part dans fon pays natal. ( B o s c . )
POUPÉE. A raifon de fa forme, on donne ce
nom à une maffe de terre entourée de mouffe,
de linge ou d’écorce, qui fe place autour des
greffes en fente ou en couronne , dans le but
de garantir la plaie du contaét de l’air 8c d’entretenir
la greffe dans une humidité propre à la çon-
ferver en état de végétation jufqu’à ce qu’elle
tire de la nourriture du fnjet.
Il faut que la terre d’ une Poupée ne foit ni trop
tenace ni trop légère, que la moufle n’y foit ni
pas a(f;z ni trop abondante, que fes enveloppes
ne foient ni trop ferrées ni trop lâches, à raifon
de ce que la terre tenace 8c des enveloppes ferrées
mettent obftacle à raccroilîement de la greffe
& du fujet-5 en ce que trop de moufle y entretient
une humidité trop confiante & trop confidérablej
à raifon de ce que la terre légère & des enveloppes
mal ferrées ne fe foutiennent pas bien 5 en
ce que peu de moufle n’empêche pas l'aétion deffé-
chante. de l’air iur la greffe. On diminue les in-
convéniêns de la terre trop tenace avec une plusgrande
quantité de moufle, & ceux d’une terre j
trop peu confiftante par de la boufe de vache.
La groffeur des branches greffées détermine 1
celle des Poupées. L'épaiffeur d’ un pouce , à |
compter de Fécorce, fuffit ordinairement.
Mon collègue Thouin s'eft afluré, par un grand
nombre d’ expériences, que les Poupées faites avec
d’autres matières que la terre n’affurent pas autant
la reprife de la greffe que celles que je viens
de décrire } cependant, dans les grandes pépinières
d’arbres fruitiers , on leur fubftitue des
enduits réfineux avec un grand fuccès j mais les
fujets font toujours jeunes, 8c les greffes font toujours
faites précifément au moment indiqué par
l’ afflux de la Sè ve . Voye^ ce, mot & ceux Greffe ,
Pépinière, Poirier,P ommier, Prunier, &c.
Généralement on laifle les Poupées en place jufqu’
à leur deftruétion naturelle, qui n’ a ordinairement
lieu que dans le courant de la fécondé année5
cependant iorfqu’on s’aperçoit qu’elles gênent Ja
crciffance de la greffe, il faut les brifer, lauf, fi
cette greffe n’elt pas fuffifamment foudée, à en
refaire une autre plus légère. ( B o s c .)
PO U R C AD E : troupeau de C ochons.
POURCEAU : fyndnyme de C ochon.
POURCEAU (Pain de). V^oye^ C y c l am e .
POURGET : mélange de boufe de vache 8c de
cendres, dont on enduit l’intérieur des Ruches
d’ofier. Voyei ce mot.
POUROUMIER. P ouroumr a .
Arbre de Cayenne (encore imparfaitement
connu), qui feul conftitue un genre dans la dioé-
cie 8c dans la ,famille des Orties. On ne le cultive
pas dans nos jardins. (# o s c .)
POURPAIROLE. C'eit le Sorgho dans les
environs d'Angoulême.
POURPIER. P o r tu l a c a .
Genre de plantes de la dodécandrie monogynie
8c de la famille des Portulacées, qui ralfemble fix
efpèces, dont une eft cuicivée dans nos jardins ,
pourl’ufage de la cuilïne. Il eit figuré pl. 401 des
Illufirations des genres de Lamarck.
Observations.
Les efpèces dont la capfule eft de trois valves,
ont été féparées de ce genre pour former celui
des T alins. Voye[ ce mot.
Efpeces.
i. Le Pourpier cultivé.
Portulaca oleracea. Linn. O Du midi de l ’Europe.
2. Le Pourpier velu.
Portulaca villofa. Linn., Q De l ’Amérique
méridionale.
3. Le Pourpier cruciforme.,
Portulaca quudrifida. Linn. 0 De l'Egypte.
4. Le Pourpier à feuilles de joubaibe.
Portulaca halimoides. Linn. 0 De la Jamaïque.
5. Le Pourpier méridien.
Portulaca meridiana. Linn. 0 Des Indes.
6. Le Pourpier à fleurs axillaires.
Portulaca axillifiora. Sch. 0 de Ceylan.
Culture.
Le Pourpier cultivé, comme les autres plantes
. qu’il a été de l'intérêt de l'homme de reproduire
fans ceffe , outre le type de l’efpèce qui eft petit,
rampant, d’ un verr très-foncé, offre plufieurs variétés,
dont deux feules font recherchées; ce font
le Pourpier commun le Pourpier doré. C e dernier
eft conflitué par des tiges plus groffes, plus hautes,
par des feuilles plus grandes, plus nombreufes 8c
d’une couleur moins verte, préférable, fous tous les
rapports , au commun, qui n’a pour lui que de ré-
fifter davantage aux froids 8c aux effets d’une
mauvaife culture.
Ce font les terres légères & humides, même
les fables, qui paroiffent le mieux convenir au Pourpier,
puifque c’eft là qu’on le voit croître naturel
lement en grande abondance. On doit donc l'y
placer de préférence lorfqu’on le cultive, mais les
bien fumer.
Dans les parties méridionales de la France on
fème le Pourpier fort épais en pleine terre, dès
que les gelées ne font plus à craindre, dans un
lieu bien- expofé, en rayons efpacés de quatre à
cinq pouces, 8c on l’ arrofe abondamment. Sa
graine ne veut pas être enterrée ; ainfi il faut fe
contenter de la répandre, laiflant aux pluies ou
aux arrofemens à faire le refte. Comme il germe
& pouffe rapidement, ou peut quelquefois commencer
à en faire la récolte quinze jours après ;
plus tard ( car il faut en femer tous lés quinze
jours),,-on le placera loin des abris, & en é té ,
au nord ou à l’ombre j car, je le répète, il aime
la fraîcheur.
La récolte du Pourpier fo fait en le coupant à
un pouce de terre avant l’épanouiffement de fes
fleurs, foit avec l’ongle, fo it avec un couteau.
Comme il ne tarde pas à repouffer s’il fait chaud
& qu’on l'arrofe, on peut en faire une fécondé
récolte huit ou dix jours après} après quoi il faut
l’arracher, parce que fa troifième pouffe eft très-
foible.
Aux environs de Paris, où les gelées fe prolongent
jufqu’ en avril, on eft obligé de femer les
premiers Pourpiers fur’ couche, garnie tantôt de
châffis , tantôt de cloches, tantôt feulement de
paillaffons. Dans* tous ces cas, on le fème auffi
prefque toujours en rayons. L ’important, lorfque
Je plant eft le vé , eft d’empêcher les gelées de le
frapper, & c’eft par une attention continuelle aux
variations d e l’atmofphère, pour ne lever les châf