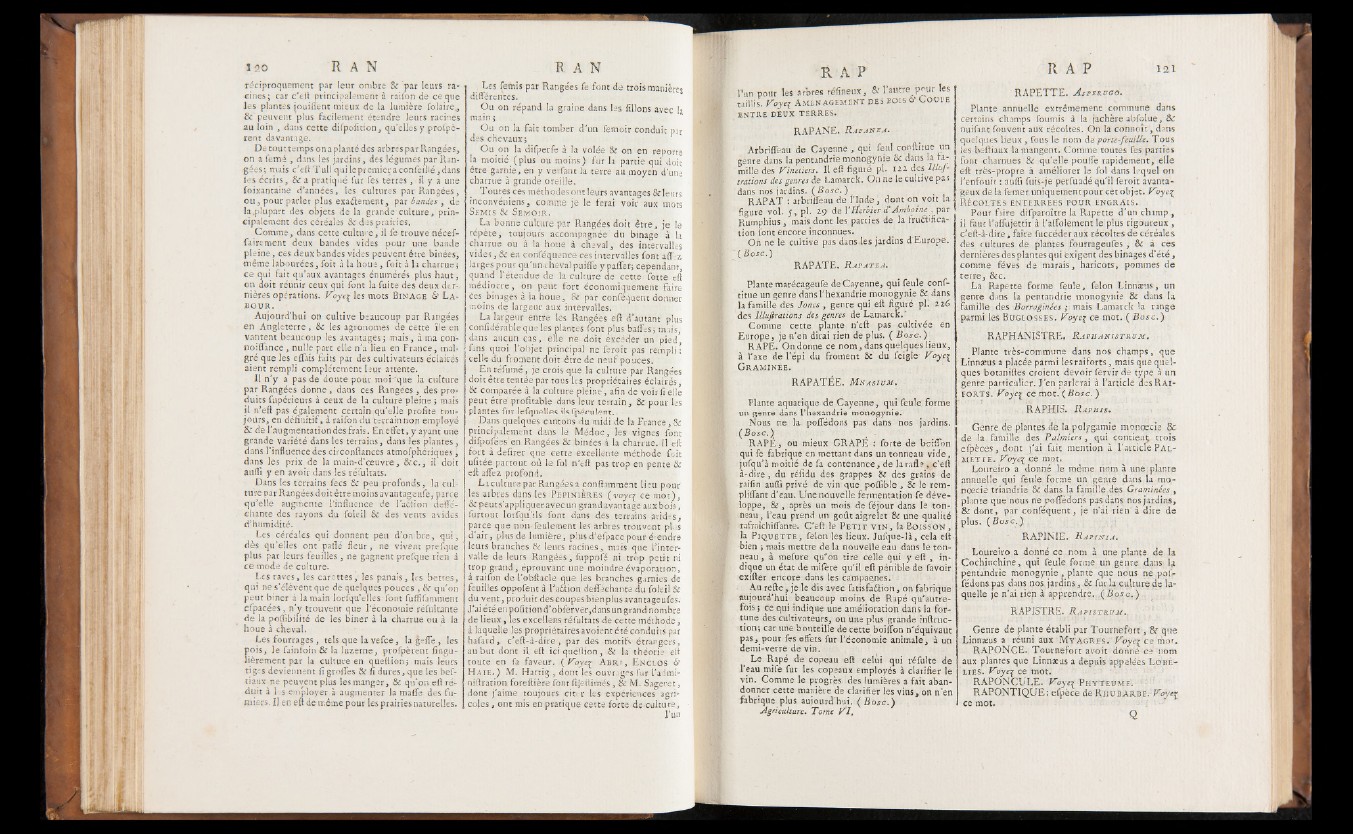
■ réciproquement par leur ombre 8c par leurs racines;
car c’ eft principalement à raifon de ce que
les plantes jjouiffenc mieux de la lumière folaire0
& peuvent plus facilement étendre leurs racines
au loin j dans cette difpoficion, qu’elles y profpè-
rent davantage.
De tout temps on a planté des arbres par Rangées,
on a femé , dans les jardins, des légumes par Rangées;
mais c e fi Tull qui le premier a confeillé, dans
les écrits, & a pratiqué fur fes terres , il y a une
foixantaine d'années, les cultures par Rangées,
o u , pour parler plus exa été ment, par bandes 3 de
la.plupart des objets de la grande culture, principalement
des céréales & des prairies.
Comme, dans cette culture, il fe trouve nécef-
fairement deux bandes vides pour une bande
pleine, ces deux bandes vides peuvent être binées,
même labourées, foit à la houe, foit à la charrue;
c e qui fait qu’aux avantages énumérés plus haut,
on doit réunir ceux qui font la fuite des deux dernières
opérations. Voyeç les mots Binage & La bo
u r .
Aujourd’hui on cultive beaucoup par Rangées
en Angleterre, 8c les agronomes de cette île en
vantent beaucoup les avantages; mais, à ma con-
noiflance, nulle part elle n’a lieu en France, malgré
que les eflais faits par des cultivateurs éclairés
aient rempli complètement leur attente.
Il n’y a pas de doute pour mor'que la culture
par Rangées donne, dans ces Rangées , des pro^
duits fupérieurs à ceux de la culture pleine ; mais
il n’eft pas également certain qu’elle profite toujours,
en définitif, à raifon du terrain non employé
& de l’augmentation des frais. En effet, y ayant une
grande variété dans les terrains, dans les plantes,
dans l’influence des circonftances atmofphériques,
dans les prix de la main-d’oeuv re, & c . , il doit
aufïî y en avoir dans les résultats.
Dans les terrains fecs & peu profonds, la culture
par Rangées doit être moins avantageufe, parce
qu’elle augmente l'influence de 1 action deffe-
chante des rayons du foleil 8c des vents avides
d’humidité.
Les céréales qui donnent peu d’ombre, q u i,
dès qu’elles ont palîé fleur, ne vivent prefque
plus par leurs feuilles, ne gagnent prefque rien à
ce mode de culture.
Les raves, les carottes,1 les panais, les bettes,
qui ne s’élèvent que de quelques pouces , & qu’ on
peut biner à la main lorsqu’elles font fuffifamment
efpacées , n’y trouvent que l'économie réfultante
de la pofïibilité de les biner à la charrue ou à la
houe à cheval.
Les fourrages, tels que la v efee, la g e fle , les
pois, le fainfoin 8c la luzerne, profpèrent fingu-
lièrement par la culture en question ; mais leurs
tiges deviennent fi grolfes & fi dures, que les bef-
tiaux ne peuvent plus les manger, & qu’on eft réduit
à Ls employer à augmenter la ma (Te des fumiers.
Il en eft de même pour les prairies naturelles.
Les femis par Rangées fe font de trois manières
différentes.
Ou on répand la graine dans les filions avec la
main ;
Ou on la fait tomber d'un femoir conduit par
des chevaux;
Ou on la difperfe à la volée 8c on en reporte
la moitié (plus ou moins) fur la partie qui doit
être garnie, en y verfant la terre au moyen d’une
charrue à grande oreille.
Toutes ces méthodes ont leurs avantages & leurs
inconvéniens, comme je le ferai voir aux mots
Semis & Semoir.
La bonne culture par Rangées doit ê tre , je le
répète, toujours accompagnée du binage à la
charrue ou à la houe à cheval, des intervalles
vides, & en conféquence ces intervalles font a fiez
larges pour qu'un cheval puifle y pafler; cependant,
quand l’étendue de la culture de cette forte eft
médiocre, on peut fort économiquement faire
Ces binages à la houe, & par conféquent donner
moins de largeur aux intervalles.
La largeur entre les Rangées eft d’autant plus
confidérablequeles plantes font plus baffes ; mais,
dans aucun cas , elle ne doit excéder un pied,
fans quoi l’objet principal ne feroit pas rempli :
celle du froment doit être de neuf pouces.
En réfumé, je crois que la culture par Rangées
doit être tentée par tous les propriétaires éclairés,
fie comparée à la culture pleine, afin de voir fi elle
peut être profitable dans leur terrain, & pour les
plantes fur lefquelles ilsfpéculent.
Daps quelques cantons du midi de la France, &
principalement dans le Médoc, les vignes font
difpofées'en Rangées 8c binées à la charrue..Il eft
fort à defirer que cette excellente méthode foit
ufitée partout où le fol n'effc pas trop en pente 8c
eft alfez profond.
La culture par Rangées a conftamment lieu pour
les arbres dans les Pépinières (voye^ ce m ot),
& peut s’appliquer avec un grand avantage aux bois,
furtout lorfqu'ils font dans des terrains arides,
parce que non-feulement les arbres trouvent plus
d'air, plus de lumière, plus d'efpace pour Rendre
leurs branches fie leurs racines, mais que l’ intervalle
de leurs Rangées, fuppofë ni trop petit ni
trop grand, éprouvant une moindre évaporation,
à raifon de i’obftacle que les branches garnies de
feuilles oppofent à l’ aaion defféchante du foleil fie
du vent, produit des coupes bien plus avantageufes.
J’ai été en pofition d’obferver,dans un grand nombre
de lieux, les excellens réfultats de cette méthode,
à laquelle les propriétaires avoient été conduits par
hafard, c’eft-à-dire, par des motifs étrangers,
au but dont il eft ici queftion, -8e la théorie eft
toute en fa faveur. ( Voyeç Ab r i , Enclos &
Haie.) M. Hartig , dont les ouvrages fur l'admi-
■ niftratioix foreftière font fi Je ftimé's, & M. Sageret,
dont j’aime toujours citer les expériences agricoles
, ont mis en pratique cette farce de-culture,
l’un
l’ un pour les arbres réfineux, Sr l ’autre pour les
taillis. Voyei AMENAGEMENT DES BOIS O* COUP E ;
ENTRE DEUX TERRES.
RAP ANE. R a p a n e a .
Arbrifleau de Cayenne, qui feu! conftitue un
genre dans la pentandrie monogynie Se dans la ra- ;
mille des Vinetiers. Il eft figuré pl. 12.2, des llluf-
trations des genres de Lamarck. On ne le cultive p»s
dans nos jardins. (B o s c .)
RAPAT ; arbrilfeau de l’Inde, dont on voit la
figure vol. y , pl. 2:9 de l’ tierbier d‘ Amboine, par
Rumphius, mais dont les parties de la fructification
font encore inconnues.
Oh ne le cultive pas dans .les jardins d Europe.
( Bosc.)
RAPATE. R a p a t e a .
Plante marécageufe de Cayenne, qui feule conftitue
un genre dans l’hexandrie monogynie 8c dans
la famille des Joncs , genre qui eft figuré pL 226
des lllu f rations des genres de LamàtcK.'
Comme cette plante n’eft pas cultivée en
Europe, je n’en dirai rien de plus. ( B o s c .)
RAPE. On donne ce nom, dans quelques lieux,
à l’axe de l’épi du froment 8e du feigle- Voye\
Graminée.
RAPATÉÊ. M n a s ium .
Plante aquatique de Cayenne, qui feule forme
un genre dans l’nexandrie monogynie/
Nous ne la pofledons pas dans nos jardins.
(B os c. ) . t -
R A PE , ou mieux GRAPË : forte de boifion
qui fe fabrique en mettant dans un tonneau vide,
jufqu’à moitié de fa contenance, de la rafle, .c’eft
à-dire, du réfidu des grappes fie des grains de
raifin auflî privé de vin que poflîble , & le rem-
plifiant d’ eau. Une nouvelle fermentation fe développe,
8e, après un mois de féjour dans le tonneau
, l’eau prend un goût aigrelet 8e une qualité
rafraîchiflante. C ’eft le Petit v in , la Boisson,
la Piquette, félon les lieux. Jufque-là, cela eft
bien ; mais mettre de la nouvelle eau dans le tonneau,
à mefure qu’ on tire celle qui y, eft , indique
un état de mifère qu'il eft pénible de favoir
exifter encore dans les campagnes.
Au refte, je le dis avec fatisfadion, on fabrique
aujourd'hui beaucoup moins de Râpé qu’autre-
fois ; ce qui indique une amélioration dans la fortune
des cultivateurs, ou une plus grande inftruc-
tion; car une bouteille de cette boifion n’équivaut
pas, pour fes effets fur l’économie animale, à un
demi-verre devin.
Le Râpé de copeau eft celui qui réfulte de
l’eau mife fur les copeaux employés à clarifier le
vin. Comme le progrès des lumières a fait abandonner
cette manière de clarifier les vins, on n’en
fabrique plus aujourd’hui. (B o s c .)
Agriculture. Tome VI.
R A PE T TE . A sperugo.
Plante annuelle extrêmement commune dans
certains champs fournis à la jachère abfolue, 8e
nuifant fouvent aux récoltes. On la connoîc, dans
quelques lieux , fous le nom de porte-feuille. Tous
les beftiaux la mangent. Comme toutes fes parties
font charnues 8e qu’elle poulfe rapidement, elle
eft très-propre à améliorer le fol dans lequel on
l’enfouir : auflî fuis-je perfuadé qu’il feroit avantageux
de la Cerner uniquement pour cet objet. Voye^
Récoltes enterrees pour engrais.
Pour fiire difparoître la Rapette d’ un champ,
il faut l’alfujettir à l'affolement le plus rigoureux ,
c-’eft-à-dire, faire fuccéder aux récoltes de céréales
des cultures de plantes fourrageufes, 8e à ces
dernières des plantes qui èxigent des binages d’é té ,
comme fèves de marais, haricots-, pommes de
terre, 8ec.
La Rapette forme feule, félon Linnæus, un
genre dans la pentandrie monogynie 8c dans la
famille des Borragïnées ,* mais Lamarck la range
parmi les Buglosses. Voyeç ce mot. ( B o s c .)
RAPHANISTRE. R a ph an is tr um .
Plante très-commune dans nos champs, que
Linnæus a placée parmi les rai forts, mais que quelques
botaniftes croient devoir fervir de type à un
genre particulier. J'en parlerai à l’article des R a i forts.
Voye^ce mot . (B o s c . )
RAPHIS. R aphis.
Genre de plantes de la polygamie monoecje 8c
de la famille des Palmiers 3 qui contient trois
efpèces, dont j’ ai fait mention à l’article Pa l -
mette. Voye^ce mot.
Loureiro a donné le même, nom à une plante
annuelle qui feule, forme un genre dans la mo-
noecie triandrie 8c dans la famille des Graminées ,
plante que nous ne pofledons pas dans nos jardins,
8c dont, par conféquent, je n’ai rien à dire de
plus. (B o s c .)
■ RAPINIE. R apiptia.
Lo.ureîro a donné ce nom à une plante de la
Cochinchine, qui feule forme un genre dans la
pentandrie monogynie, plante que nous ne pof-
fédonspas dans nos,jardins, 8c fur la culture de laquelle
je n’ai rien à apprendre.. ^ B o s c . ) ,
RAPISTRE. R a p istrum .,
Genre de plante établi par Tournefort, 8c que
Linnæus a réuni aux M y agre's .' Voye^ ce mor.
RAPONCE., Tournefort a voit donné ce nom
| aux plantés que Linnæus a depuis appelées Lobé-
| LIES. Voye\ ce mot.
RAPONCLÎLE. Voye[ Phyteume. r J
RAPONTIQÜE: efpèce de R hubARb Ev ^ }^ ?
ce mot.
Q