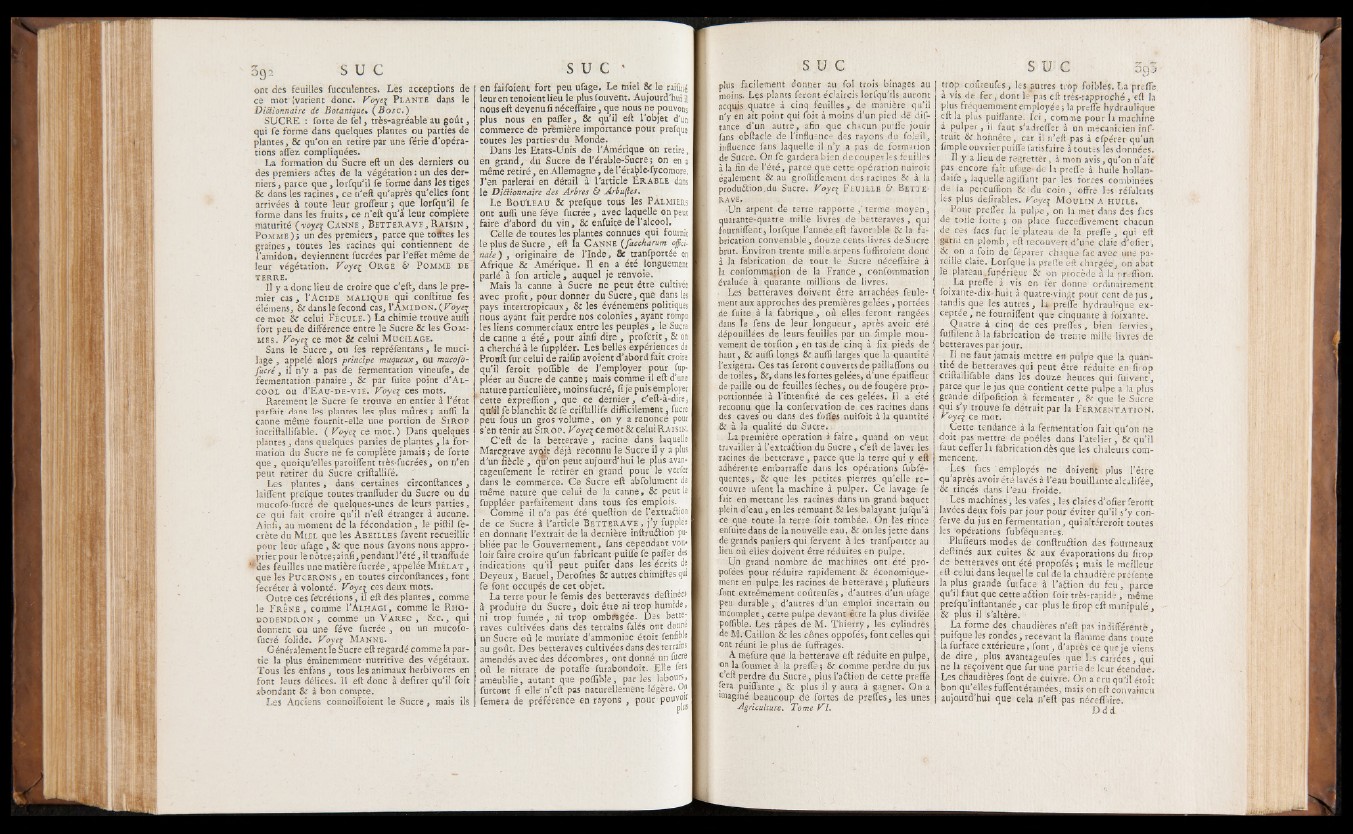
ont des feuilles fucculentes. Lés acceptions de
ce mot [varient donc. Voye[ Plan te dans le
Dictionnaire de Botanique» ( B o s c . )
SUCRE : forte de fel , très-agréable au goût ,
qui fe forme dans quelques plantes ou parties de
plantes, & qu'on en retire par une férié d'opérations
allez, compliquées.
La formation du Sucre eft un des derniers ou
des premiers attes de la végétation : un des derniers
, parce que , lorfqu'il fe forme dans les tiges
& dans les racines, ce n'eft qu’après qu'elles font
arrivées à toute leur groffeur j gue lorfqu’il fe
forme dans les fruits, ce n'eft qu’a leur complète
maturité ( voyei C a n n e , Be t t e r a v e ,R a i s in ,
P om m e ) j un des premiers, parce que toftes les
graines, toutes les racines qui contiennent de
l'amidon, deviennent fucrées par l’effet même de
leur végétation. Voye£ O rge & P omme de
TERRE.
Il y a donc lieu de croire que c’eft, dans le premier
cas, 1’A cide m a l iq d e qui conftitue fes
élémens, & dans le fécond cas, l’AMiDON.CFoy^
ce mot & celui Fécule.) La chimie trouve aufli
fort peu de différence entre le Sucre & les G omm
e s . Voye^ ce mot & celui Mucilage.
Sans le Sucre, ou fes repréfentans, le mucilage,
appelé alors principe muqueux, OU mucofo-
fu c r é , il n'y a pas de fermentation vineufe, de
fermentation-panaire, & par fuite point d'AL-
co o l ou d’EAU-DE-viE. V oy e i ces mots.
Rarement le Sucre fe trouve en entier à l’état
parfait dans les plantes les plus mûres ; aufli la
canne même fournit-elle une portion de Siro p
incriftallifable. ( Voyei ce mot.) Dans quelques
plantes , dans quelques parties de plantes , la formation
du Sucre ne fe complète jamais ; de forte
que, quoiqu’elles paroiffent très-fucrées, on n'en
peut retirer du Sucre criftallifé. ■'
Les plantes, dans certaines cîrconftances,
laiffent prefque toutes tranffuder du Sucre ou du
mucofo-fiicré de quelques-unes de leurs parties ,
ce qui fait croire qu'il n'eft étranger à aucune.
Air-fi, au moment de la fécondation, le piftil fe-
crète du Miel que les A beilles favent recueillir
pour leur ufage, & que nous favons nous approprier
pour Te nôtre } ainfi, pendant l'été , il tranftiide
*des feuilles une matière fuçrée, appelée Mié l a t ,
que les Pu c e r o n s , en toutes cîrconftances, font
fecréter à volonté. V oy e[ ces deux mots.
Outre ces fefcrétions, il eft des plantes, comme
le F r ê n e , comme I’Alh a g i , comme le Rhododendron
> comme un Y a r e c , &c., qui
donnent ou une fève fucrée | ou un mucofo-
fucré folide. Voyez Man ne.
Généralement le Sucre eft regardé comme la; partie
la plus éminemment-nutritive des végétaux.
Tous les énfans , tous les animaux herbivores en
font leurs délices. Il eft donc à defirer qu'il foit
abondant & à bon compte.
Les Anciens connoiffoient le Sucre , mais ils
en faifoient fort peu ufage. Le miel & le raifmé
leur en tenoient lieu le plus fouvent. Aujourd’hui il
nous eft devenu fi néceffaire, que nous ne pouvons
plus nous en paffer, & qu'il eft l'objet d’un
commerce de première importance pour prefque
toutes les parties*du Monde.
Dans les Etats-Unis de l’Amérique on retire,
en grand, du Sucre de l’érable-Sucre; on en a
même retiré, en Allemagne, de l’érable-fycomore.
J'en parlerai en détail à l'article É r a b l e dans
le Dictionnaire des Arbres & Arbuftes.
Le Bo u ïe a u & prefque tous les Palmiers
ont aufli une fève fucrée , avec laquelle on peut
faire d'abord du vin, & enfuite de l’alcool.
Celle de toutes les plantes connues qui fournit
le plus de Sucre , eft la C anne (faccharum officin
ale) , originaire de l’Inde, & tranfportée en
Afrique & Amérique. Il en a été longuement
parlé à fon article, auquel je renvoie.
Mais la canne à Sucre ne peut être cultivée
avec profit, pour donner du Sucre, que dans les
pays intertropicaux, & les événemens politiques
nous ayant fait perdre nos colonies, ayant rompu
les liens commerciaux entre les peuples , 1e Sucre
de canne a été, pour ainfi dire , profcrit, & on
a cherché à le fuppléer. Les belles expériences de
Proaft fur celui de raifin avoient d’abord fait croire
qu'il feroit poflible de l'employer pour fuppléer
au Sucre de canne} mais comme il eft d'une
nature particulière, moins fucré, fi je puis employer
F cette expreflion , que ce dernier, c’eft-à-dire,
qu«tl fe blanchit & fe criftallifé difficilement., fucre
peu fous un gros volume, on y a renoncé pour
s'en tenir au Sir o p . Voye£ ce mot & celui R aisin.
C’eft de la betterave , racine dans laquelle
Marcgrave avojt déjà reconnu le Sucre il y a plus
d’un fîèclè , qu'on peut aujourd’hui le plus avan-
tageufement le retirer en grand pour le verfer
dans le commerce. Ce Sucre eft abfolument de
même nature que celui de la canne, & peut le
fuppléer parfaitement dans tous fes emplois.
Comme il n'a pas été queftion de l'extra&ion
de ce Sucre à l'article Be t t e r a v e , j'y fupplée
en donnant l'extrait de la dernière inftruétion publiée
par le Gouvernement, fans cependant vouloir
faire croire qu'un fabricant puiffe fe paffer des
indications qu’il peut puifer dans les écrits de
Deyeux, Baruel, Derofnes & autres chimiftes qui
fe font occupés de cet objet.
La terre pour le femis des betteraves deftinees
à produire du Sucre, doit être ni trop humide,
ni trop fumée, ni trop ombrtigée. Des betteraves
cultivées dans des terrains falés ont donne
i Sucre oû le muriate d’ammoniac étoit fenfible
au goût. Des betteraves cultivées dans des terrains
amendés avec des décombres, ont donné un fucre
où le nitrate de potaffe furabondoit. Elle fera
ameublie, autant que poflible, par les labours>
furtoiit fi elle" n’eft pas naturellement légère. Oj1
femera de préférence en rayons , pour pouvoir
plus facilement donner au fol trois binages au
moins. Les plants feront éclaircis lorfqu'ils auront
acquis quatre à cinq feuilles, de manière qu’il
n’y en ait point qui foit à moins d’un pied de dif-
tance d’un autre, afin que chacun puiffe jouir
fans obftaçle de l’influence des rayons du fojeil,
influence fans laquelle il n'y a pas de formation
de Sucre. On fe gardera bien dé couper les feuilles
à la fin de l’été, parce que cette opération nuiroic
également & au groflîffement des racines & à la
production.du Sucre. Voye[ F euille & Be t t e rave,
•Un arpent de terre rapporte / terme moyen,
quarante-quatre mille livres de betteraves, qui
fourniffent, lorfque l’année eft favorable; & la fabrication
convenable, douze cents livres de Sucre
brut. Environ trente mille.arpens fuffiroient donc
à la fabrication de tout le Sucre néceffaire fà
la confomma|ion de la France, confommation
évaluée à quarante millions de livres^
Les betteraves doivent être arrachées feulement
aux approches des premières gelées, portées
de fuite à la fabrique, où elles, feront rangées
dans le fens de leur longueur, après avoir été
dépouillées de leurs feuilles par un.fimple mouvement
de tôrfion , en tas de cinq à fix pieds de
haut, & aufli longs & aufli larges que la quantité
l’exigera. Ces tas feront couverts de paillaffons ou
de toiles, &, dans les fortes gelées, d’une épaiffeur
de paille ou de feuilles lèches, ou de fougère proportionnée,
à l’intenfité de ces gelées. Il a été
reconnu que la confervation de ces racines dans
des caves ou dans des fofffs nuifoit à la quantité
& à la qualité du Sucre..
La première opération à faire, quand on veut
travailler à l’extraCUon du Sucre, c’èft de laver les
racines de betterave, parce que la terré qui y eft
adhérente embarraffe dans les opérations fubfé-
quentes, & que les petites pierres qu’elle recouvre
ufent la machine à pulper. Ce lavage fe
fait en mettant les racines dans un grand baquet
plein d'eau, en les remuant & les balayant jufqu'à
ce que toute la terre foit tombée. On l'es rince
enfuite dans de la nouvelle eau, & on les jette dans
de grands paniers qui fervent à les transporter au
lieu où elles- doivent être réduites en pulpe.
Un grand nombre de machines ont été pro-
pofées pour réduire rapidement & économiquement
en pulpe les racines de betterave} plufieurs
•font extrêmement coûteufes, d'autres d'un ufage
peu durable, d'autres d'un emploi incertain ou
incomplet, cette pulpe devant être la plus divifée
pofliblei Les râpes de M. Thierry, les cylindres
de M. Caillon & les cônes oppofés, font celles qui
ont réuni le plus de fuffrages.
A mefure que la betterave eft réduite en pulpe,
on la foumet à la preffe ; & comme perdre du jus
c'eft perdre du Sucre, plus l’a&ion de cette preffe
fera puiffante, & plus il y aura à gagner. On a
imaginé beaucoup dé fortes de preffes, les unes
Agriculture. Tome V I .
trop coûteufes, les autres trop foibles. La preffe
a vis. de fer, dont le pas eft très-rapproché, eft la
plus fréquemment employée} la prefle hydraulique
eft la plus puiffante. Ici, comme pour la machine
à pulper, il faut s'adreffer à un mécanicien inf-
truit & honnête , car il n’eft pas à efpérer qu’un
fimple ouvrier puiffe fatisfaire à toutes les données.
Il y a lieu de regretter, à mon avis,qu’on n'ait
pas encore fait ufage* de la preffe à huile hollan-
daife, laquelle a giflant par les forces combinées
de ia percuffion & du coin , offre les refultats
les plus de,fi râbles. Voyeç M oulin a huile.
Pour preffer ia pulpe, on la met dans des fies
de toile forte ; on place fucceflivement chacun
de ces facs fur le*plateau de la preffe, qui eft
garni en plomb, eft recouvert d'une claie d'ofier,
& on a foin de féparer chaque fac avec une pareille
claie. Lorfque la preffe eft chargée, on abat
le plateau Tupériqur & on procède à la preffion.
La preffe à vis en fer donne ordinairement
foixante-dix-huit à quatre-vingt pour cent de jus,
.tandis que les autres, la. preffe hydraulique exceptée,
ne fourniffent que cinquante à foixante.
Quatre à cinq de ces preffes, bien fervies,
fuffifent à la fabrication de trente mille livres de
betteraves par jour.
| IJ faut jamais mettre en pulpe que la quantité
de betteraves qui peut être réduite en firop
criftailifable dans les douze heures qui fuivent,
parce que le jus que contient cette pulpe a la plus
grande difpofition à fermenter, & que le Sucre
qui s'y trouve fe détruit par la Fe rm en t a t io n .
Voye% ce mot.
Cette tendance à la fermentation fait qu'on ne
doit pas mettre de poêlés dans l'atelier, & qu’il
faut ceffer la fabrication dès que les chaleurs commencent.
Les facs ' employés ne doivent plus l’être
qu'après avoir été lavés à l’eau bouillante alcalifée,
& rincés dans l'eau froide.
Les machines, les vafes, les claies d’ofier feront
lavées deux fois par jour pour éviter qu’il s'y con-
ferve du jus en fermentation, qui aitéreroit toutes
les opérations fubféqu=ntes.
Plufieurs modes de conftru&ion des fourneaux
défîmes aux cuites & aux évaporations du firop
de betteraves ont été propofés ; mais le meilleur
eft celui dans lequel le cul de la chaudière préfente
la plus grande furface à l’aftion du feu, parce
qu’il faut que cette aftion foit très-rapide , même
prefqu'inftantanée, car plus le firop eft manipulé,
& plus il s’altère.
La forme des chaudières n’eft pas indifférentè,
puifque les rondes, recevant la flamme dans toute
la furface extérieure, font, d’après ce que je viens
de dire, plus avantageufes que h-s carrées, qui
ne la reçoivent que fur une partie de leur étendue.
Les chaudières font de cuivre. On a cru qu’il étoit
bon qu’elles fuffentétamées, mais on eft convaincu
aujourd hui que cela n’eft pas néceffaire.
Ddd