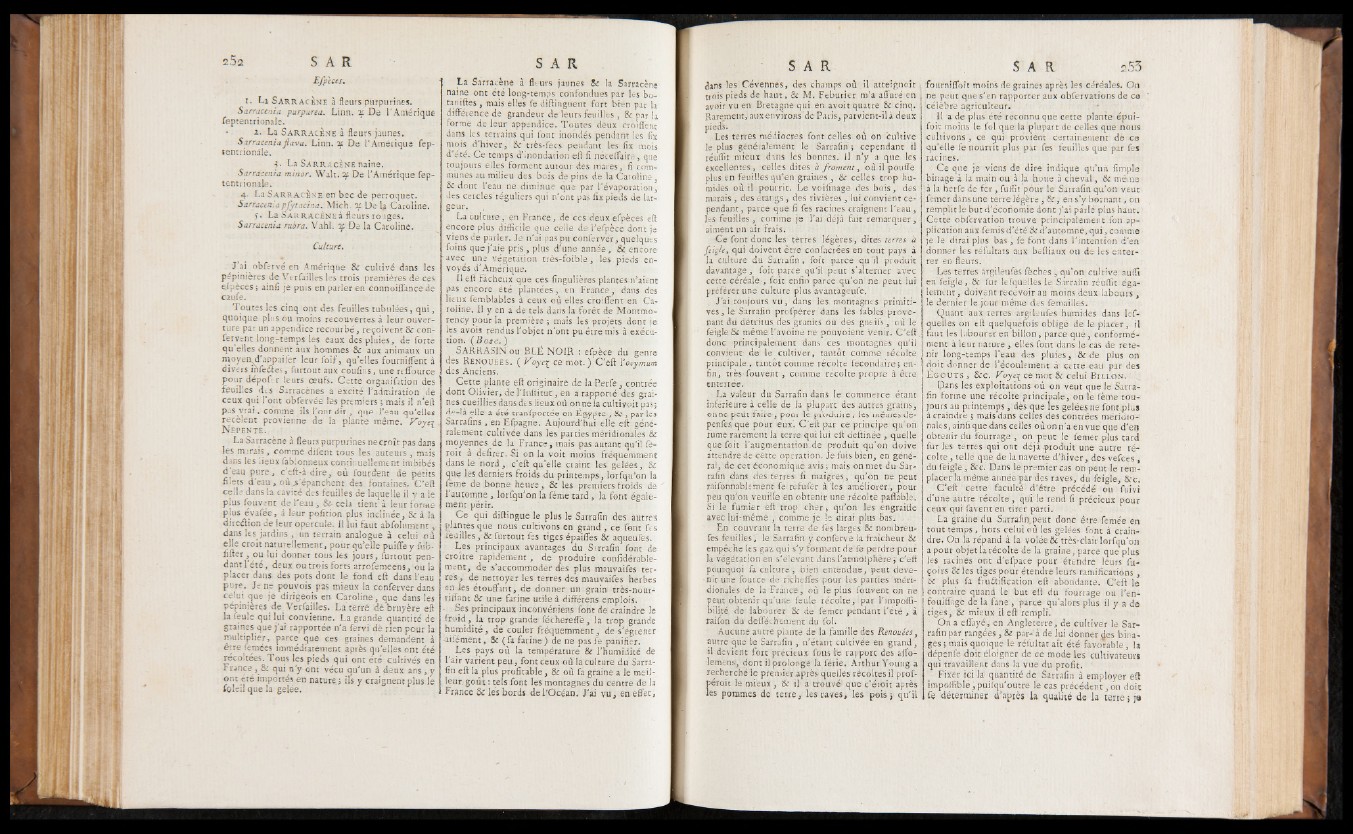
2 3 2 S A R
Efpéces.
i . La Sa r r a c è n e à fleurs purpurines.
Sarracenia purpurea. Linn. il De l 'Amérique
feptentrionale.
* 2. La Sa r r a c Ène à fleurs jaunes.
Sarracenia fiava. Linn. ^ De l’ Amérique fep-
tentrionàle.
v La Sa r r a c è n e naine.
Sarracenia minor. Walt. if De l’Amérique feptentrionale.
4 - La Sarracène en bec de perroquet.
Sarracenia pfytacina. Mjch. "2f De 1$ Caroline.
J• La Sarracène à fleurs rouges.
Sarracenia rubra. Vahl. y De la Caroline.
Culture.
Jai: obfervé en Amérique & cultivé dans les
pépinières de Vt rfailles les trois premières de ces
efpèces ; ainfi je puis en parler en connoiflance de
caufe.
Toutes les cinq ont des feuilles tubulées, q u i,
quoique plus ou moins recouvertes à leur ouverture
par un appendice recourbé, reçoivent & con-
fervcnt long-temps les eaux des pluies, de forte
qu’elles donnent aux hommes & aux animaux un
moyen^d’appaifer leur fo if, qu’elles fourniffent à
divers infeétes, furtout aux coufins, une rc Source
pour dépofir leurs oeufs. Cette organifation des
feuilles rte s Sarracènes a excité l’admiration de
ceux qui l’ont obfervée les premiers ; mais il n’eft
pas vrai, comme ils l’ont d i t , que l’eau qu’elles
recèlent provienne de la plante même. Voyez
N é p e n t e .
La Sarracène à fleurs purpurines ne croît pas dans
les marais, comme difent tous les auteurs , mais
dans les lieux fablonneux continuellement imbibés
d eau pure, c’eit-à d i r e o ù fourdent de petits
filets d'eau, où „s'épanchent des fontaines. 'C ’ eft
celle dans la cavité des feuilles de laquelle il y a le
plus fouvent de l’eau , &- cela tient à leur forme
plus évafée, à leur polîtion plus inclinée, & à la
direction de leur opercule. Il lui faut absolument ,
dans les jardins , un terrain analogue à celui où
elle croît naturellement, pour qu’elle puiffey ûib-
fîfter , ou lui donner tous les jours, furtout pendant
l’é té , deux ou trois forts arrofemeens, ou la
placer dans des pots dont le fond eft dans l’eau
pure. Je ne pouvois pas mieux la conferver dans
celui que jé dirigeois en Caroline, que dans les
pépinières de Verfailles. La terré dè bruyère eft
la feule qui lui convienne. La grande quantité de
graines que j'ai rapportée n’a fervi dè rien pour la
multiplier, parce que ces graines demandent à
être femées immédiatement après quelles ont été
récoltées. Tous les pieds qui ont été cultivés en
France , & qui n’y ont vécu qu’ un à deux ans, y
ont été importés en naturej ils y craignent plus le
foleil que la gelée.
s A R
La Sarracène à fit urs jaunes & la Sarracène
naine ont été long-temps confondues par les bo-
taniftes , mais elles fe diftinguent fort bien par la
différence de grandeur de leurs feuilles , & par la
forme de leur appendice. Toutes deux croiffent
dans les terrains qui font inondés pendant les fix
mois d’hiver, Si très-fecs pendant les fix mois
d’été. Ce temps d’inondation eft fi nécelfaire, que
toujours elles forment autour des mares, fi communes
au milieu des bois de pins de la Caroline,
& dont l’eau ne diminue que par l'évaporation,
des cercles réguliers qui n’ ont pas fix pieds de largeur.
.
La culture, en France, de ces deux efpèces eft
encore plus difficile que celle de l’efpèce dont je
viens de parler. Je n’ai pas pu conferver, quelques
foins que j’ aie pris, plus d’ une année, & encore
avec une végétation très-foible, les pieds envoyés
d’Amérique.
Il eft fâcheux que ces fingulières plantes n’aient
pas encore été plantées, en France, dans des
iieux femblables à ceux où elles croiffent en Caroline.
Il y en a de tels dans la-forêt de Montmorency
pour la première j mais les projets dont je
les avois rendus l’objet n’ont pu être mis à exécution.
(B o s e .}
. SARRASIN ou BLÉ NOIR : efpèce du genre
des Renouees. ( Voyc£ ce mot.) C ’eft: Yocymum
des Anciens.
Cette plante eft originaire de la Perfe, contrée
dont Olivier, d e l’Inftitut, en a rapporté des graines
cueillies dans des lieux où on ne la cultivait pas;
de-là elle a été tranfportée en Égyp te, & , par les
Sarrafins, en Efpagne. Aujourd'hui elle eft généralement
cultivée dans les parties méridionales &
moyennes de la France, mais pas autant qu’il fe-
roit a defîrer. Si on la voit moins fréquemment
dans le nord, c’eft qu’elle craint les gelées, &
que les derniers froids du printemps, lorfqu’on la
fème de bonne heure, & les premiers froids de
l’automne, lorfqu’on la fème tard , la font également
périr.
Ce qui diftingue le plus le Sarrafin des autres
plantes que nous cultivons en grand, ce font fes
veuilles, & furtout fes tiges épaiffes & aqueufes.
Les principaux avantages du Sirrafin font de
croître rapidement, de produire confidérable-
ment, de s’accommoder des plus mauvaifes terre
s , de nettoyer les terres des mauvaifes herbes
en les étouffant, de donner un grain très-nour-
rjlTant & une farine utile à différens emplois.
- Ses principaux inconvéniens font de craindre le
froid , la trop grande'féchereffe , la trop grande
humidité, de couler fréquemment, de s’égrener
-aifément, & (fa farine) de ne pas fe panifier.
Les pays où la température & l ’humidité de
l’air varient peu, font ceux où la culture du Sarra-
fîn eft la plus profitable, & où fa graine a le meilleur.
goût : tels font les montagnes du centre de la
France Sc les bords de l'Océan. J'ai v u , en effet,
S A R s 5 3
dans les Cévennes, des champs où il atteignoit i
trois pieds de haut, Si. M. Feburier m’a affuré en \
avoir vu en Bretagne qui en avoitquatre & cinq.
Rarement, aux en virons‘de Paris, parvient-il à deux
pieds.
Les terres médiocres font celles où on cultive
le plus généralement le Sarrafin; cependant il
réuffit mieux dans les bonnes, il n’y a que- les
excellentes, celles dites à froment3 où-il pouffe
plus en feuillesqu’en graines, & celles trop humides
où il pourrit. Le voifinage des bois, des
marais, des étangs, des rivières, lui .convient cependant,
parce que fi fes racines craignent l’eau,
les feuilles, comme je l’ai déjà fait remarquer,
aiment un air frais.
C e font donc les terres légères-, dites terres a
feigle.» qui doivent être confacrées en tout pays à
la culture du Sarrafin, foit parce qu'il produit
davantage, foit parce qu’il peut s’alterner avec
cette céréale -, foit enfin parce qu’on ne peut lui
préférer une culture plus avantageufe.
, J’ai toujours vu , dans les montagnes primitives,
le Sarrafin prcfpérer dans les fables, prove- .
nant du détritus des granits ou des gneifs, où le
feigle Si même l ’avoine ne pouvoient venir. C ’ eft.
donc principalement dans ces montagnes qu'il
convient de le cultiver, tantôt comme iécolte
principale , tantôt comme récolte fecondaire; enfin,
très-fouvent, comme récolte propre à être
enterrée. .
La valeur du Sarrafin dans le commerce étant
inférieure à celle de la plupart des autres grains,
onne petit faire, pour le:produire, les mêmes dé-
penfes que pour eux. C ’eft par ce principe qu'on
fume rarement la terre qui lui eft deftinée , quelle
que foit 1’augmentationxle produit qu’on doive
attendre de cette operation. Je fuis bien, en général,
de cet économique avis; mais on met du Sarrafin
dans des terres fi maigres, qu'on ne peut
raifonnablement fe refufer à les améliorer,, pour
peu qu’on veuille en obtenir une récolte paflable.
Si le fumier eft trop che r, qu’on les engraifie
avec lui-même , comme je le dirai plus Bas. -
En couvrant la terre de fes larges & nombreu-
fes feuilles/ le Sarrafin y conferve la fraîcheur &
empêche les gaz qui s’y forment de fe perdre pour
la végétation en s’élevant dansi’atmolphère ; c’ eft
pourquoi fa culture , bien entendue, peut devenir
une fôurce de riçheffes pour les parties méridionales
de la France, où le plus fouvent on ne
peut obtenir qu'une feule récolte, par Tlmpoffi-
bilité de labourer Si de femer pendant l’été , à
raifon du defféc bernent du fol.
Aucune autre plante de la famille des Renouées,
autre que le Sarrafin , n’étant cultivée en grand,
il devient fort précieux fous te rapport des affo-
lemens, dont il prolonge la férié. Arthur Young a
recherché le premier après quelles récoltes il prof-
péroit le mieux , & il a trouvé’ que c’ étoit après
les pommes de terre, les rayes, les pois; qu’ il
s A R
fourniffoit moins de graines après les céréales. On
ne peut que s’en rapporter aux obfervations de ce
célèbre agriculteur.
11 a de plus été reconnu que cette plante épui-
foit moins le fol que la plupart de celles que nous
cultivons, ce qui provient certainement de ce
qu’elle fe nourrit plus par fes feuilles que par fes
racines.
Ce que je viens de dire indique qu’uri fimple
binage à la main ou à la houe à cheval, & même
à la herfe de fe r , fuffit pour le Sarrafin qu’on veut
femer dans une terre légère, en s’y bornant, on
remplit le but d’économie dont j’ ai parlé plus haut.
Cette obfervation trouve principalement fon application
aux femis d’été & d’automne, qui, comme
je le dirai plus bas, fe font dans l’ intention d’en
donner les réfultats aux beftiaux ou de les enterrer
en fleurs.
Les terres argileufes fèches, qu’on cultive auflî
en feigle, & fur lefqueiles le Sarrafin réuflît également
, doivent recevoir au moins deux labours ,
le dernier le jour même des femailles.
Quant aux terres argileufes humides dans lefqueiles
on eft quelquefois obligé de le placer, il
faut les labourer en billon, parce qué, conformément
à leur nature , elles font dans le cas de retenir
long-temps l’eau des pluies, & de plus on
doit donner de l’écoulement à cette eaü par des
Ég o u t s , Scc. F o y e £ ce mot & celui Billon.
Dans les exploitations où on veut que le Sarrafin
forme une récolte principale, on le fème toujours
au printemps, dès que les gelées ne font\plus
à craindre ; mais dans celles des contrées méridionales,
ainfi que dans celles où on n'a en vue que d’etj
obtenir du fourrage , on peut le i'emer plus tard
fur les terres qui ont déjà -produit une autre ré-
colre, telle que de la navette d’hiver, des vefees ,■
du feigle, &c. Dans le premier cas on peut lé remplacer
la même année~par des raves, du feigle, & c .
C ’ eft cette faculté d’être précédé ou fuivi
d’ une autre récolte, qui le rend fi précieux pour
ceux qui faventen tirer parti.
La graine du Sarrafin.peut donc être femée en
tout temps, hors celui où les gelées font à craindre.
On la répand à la volée & très-clair lorfqu’ on
a pour objet la récolte de la graine, parce que plus
les racines ont d’efpace pour étendre leurs fu-
çoirs Scies tiges pour étendre leurs ramifications ,
Sc plus fa fructification eft abondante. C ’eft le
contraire quand le but eft du fourrage ou l’enfoui
ffage de la fane , parce qu’alors plus il y a de
tiges, Si mieux il eft rempli.
Ôn a effayé, en Angleterre, de cultiver le Sarrafin
par rangées , Sc par-!à de lui donner des binages
; mais quoique le réfultat ait été favorable, la
dépenfe doit éloigner de ce mode les cultivateurs
qui travaillent dans la vue du profit.
Fixer ici la’ quantité de Sarrafin à employer eft
impoilîblë, puifqu’outre le cas précédent, on doit
! fe déterminer d'après la qualité de la terre ; j«