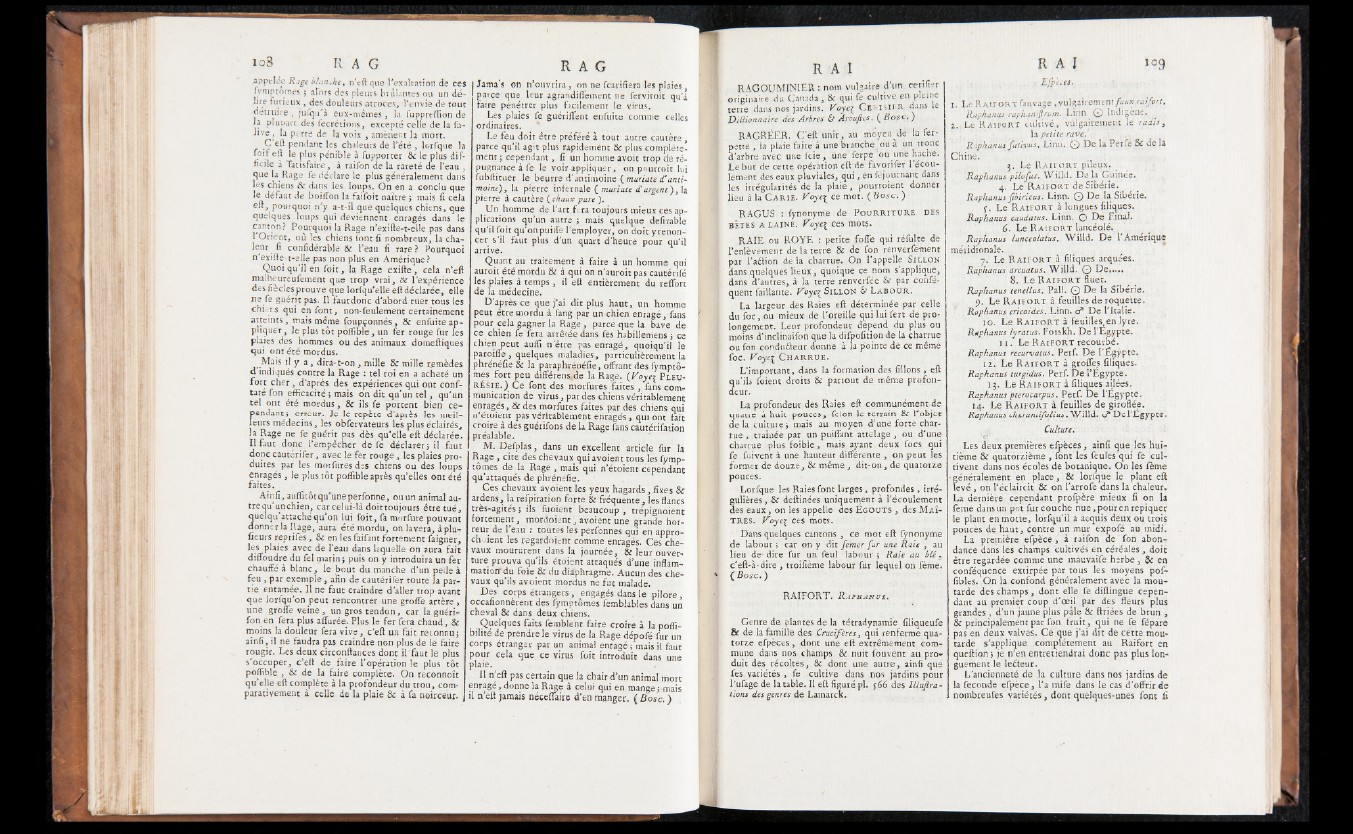
appelée Rage blanche} n’eftque l’exaltation de ces
fymptqmes ; alors des pleurs brûlantes ou un dé*
^'r/e furieux, des douleurs atroces, l'envié de tout
détruire , jufqu’ à eux-mêmes , la fuppreffion de
Ja plupart des décrétions, excepté celle de la fa-
live , la perte de la voix , amènent la mort.
C'eft pendant les chaleurs de l'été , lorfque la
fo if eft le plus pénible à fupporter & le plus difficile
à "fatisfaire, à raifon de la rareté de l'eau ,
que la Rage fe déclare le plus généralement dans
les chiens & dans les loups. On en a conclu que
le défaut de boiffon la faifoit naître ; mais fi cela
eftj pourquoi n'y a-t-il que quelques chiens, que
quelques loups qui deviennent enragés dans le
canton? Pourquoi la Rage n'exifte-t-elle pas dans I Orient, où les chiens font fi nombreux, la chaleur
fi confidérable & l'eau fi rare ? Pourquoi
n'exifte-t-elle pas non plus en Amérique?
Quoiqu'il en fo it , la Rage exifte, cela n'eft
malheureufement que trop vrai, & l ’expérience
des fiècles prouve que lorfqu'elle eft déclarée, elle
ne fe guérit pas. Il fautdonc d'abord tuer tous les
chiar.s qui en font, non*feulement certainement
atteints, mais même foupçonnés, & enfuite appliquer
, Je plus tôt pôffible, un fer rouge fur les
plaies des hommes ou des animaux domeftiques
qui ont été mordus.
Mais il y a , dira-.t-on , mille & mille remèdes
d indiqués contre la Rage : tel roi en a acheté un
fort ch e r , d’après des expériences qui ont conf-
taté fon efficacité; mais on dit qu'un t e l , qu'un i
tel ont été mordus, & ils fe portent bien ce- j
pendant; erreur. Je le repète d’après les meilleurs
médecins, les obfervateurs les plus éclairés,
la Rage ne fe guérit pas dès qu'elle eft déclarée.
II faut donc l'empêcher de fe déclarer; il faut
donc cautérifer, avec le fer rouge, les plaies produites
par les rriorfuresdes chiens ou des loups
enragés, le plus tôt pôffible après qu'elles ont été
faites.
Ainfi, auffitôtqu’uneperfonne, ou un animal autre
qu'un chien, car celui-là doit toujours être tué,
quelqu attaché qu'on lui foit, fa morfure pouvant
donner la Rage, aura été mordu, on lavera, àplu-
fieurs reprifes, & en les faifant fortement faigner,
les plaies avec de l'eau dans laquelle on aura fait
dififoudre du fel marin ; puis on y introduira un fer
chauffé à blanc, le bout du manche d'un pelle à
fe u , par exemple, afin de cautérifer toute la partie
entamée. Il ne faut craindre d ’aller trop avant
que lorfqu'on peut rencontrer une groffe artère,
une groffe veine, un gros tendon, car la guéri-
fon en fera plus affurée. Plus le fer fera chaud, &
moins la douleur fera v iv e , c ’eft un fait reconnu;
ainfi, il ne faudra pas craindre non plus de le faire
rougir. Les deux circonftances dont il'faut le plus
s’occuper, c’eft de faire l'opération le plus tôt
pôffible, & de la faire complète. On reconnoît
qu'elle eft complète à la profondeur du trou, comparativement
à celle de la plaie & à fa noirceur.
Jama’s on Couvrira, on ne fcarifiera les plaies
parce que leur agrandiffement ne ferviroit qu'à
faire pénétrer plus facilement le virus.
Les plaies fe guériffent enfuite comme celles
ordinaires.
Le feu doit être préféré à tout autre cautère,
parce qu’il agit plus rapidement & plus complètement
; cependant, fi un homme avoit trop de répugnance
à fe le voir appliquer, on pourroit lui
fubfti tuer le beurre d'antimoine ( mariale £ antimoine),
la pierre infernale ( muriate d'argent), la
pierre à cautère ( chaux pure ).
Un homme de l'arc fera toujours mieux ces applications
qu'un autre ; mais quelque defirable
qu'il foit qu'on piiiflfe l'employer, on doit y renoncer
s'il faut plus d’un quart d'heure pour qu'il
arrive.
Quant au traitement à faire à un homme qui
auroit été mordu & à qui on n'auroit pas cautérifé
les plaies à temps, il eft entièrement du reffort
de la médecine.
D'après ce que j’ ai dit plus haut, un homme
peut être mordu à fang par un chien enragé, fans
pour cela gagner la Rage, parce que la bave de
ce chien fe fera arrêtée dans fes habillerriens ; ce
chien peut auffi n'être pas enragé, quoiqu'il le
paroiffe, quelques maladies, particulièrement la
phrénéfie & la paraphrénéfie, offrant des fymptô-
mes fort peu différens,de la Rage. ( Voyej Pleurésie.)
Ce font des morfures faites , fans communication
de virus, par des chiens véritablement
enragés, & des morfures faites par des chiens qui
n'étoient: pas véritablement enragés, qui ont fait
croire à des guérifons de la Rage fans cautèrifation
préalable.
M. Defplas, dans un excellent article fur la
Ra g e , cite des chevaux qui avoient tous les fymp-
cômes de la Ra ge, mais qui n'étoient cependant
qu'attaqués de phrénéfie.
Ces chevaux avoient les yeux hagards, fixes &
ardens, la refpiration forte & fréquente, les flancs
très-agités ; ils fuoient beaucoup, ‘trëpignoient
fortement, mordoient, avoient une grande horreur
de l’eau : toutes les perfonnes qui en approchaient
les regardoient comme enragés. Ces chevaux
moururent dans la journée, & leur ouverture
prouva qu’ils étoient attaqués d’une inflarn-
mation*du foie & du diaphragme. Aucun des chevaux
qu'ils avoient mordus ne fut malade.
Des corps étrangers, engagés dans le pitore,
occafionnèrent des fymptômes femblables dans un
cheval & dans deux chiens.
Quelques faits femhlent faire croire à la poflï-
bilité de prendre le virus de la Rage dépofé fur un
corps étranger par un animal enragé; mais il faut
pour cela que ce virus foit introduit dans une
plaie.
Il n eft pas certain que la chair d*un animal mort
enragé, donne la Rage à celui qui en mange; mais
il n’elt jamais néceffaire d’en manger. ( B ose. )
R A G O U M IN 1 E R : nom vulgaire d’un cerifi^r
originaire du Canada, & qui fe cultive en pleine
terre dans nos jardins. Voye\ C er is ie r dans le
Diiïionnqire des Arbres 6* Ârbuftcs. ( Bosc. )
RAGRÉER. C ’eft unir, au moyen de la fer-
pette , la plaie faite à une branche ou a un tronc
d’arbre avec une lc ie , une ferpe ou une hache.
Le but de cette opération eft de favorifer 1 écoulement
des eaux pluviales, qui, en féjournant dans
les irrégularités de la plaie, pourroient donner
lieu à la Car ie . Voye^ ce mot. ( Bosc. )
RAGUS : fynonyme de Pourriture des
betes a laine. Voye^ ces mots.
RAIE ou ROYE : petite foffe qui réfulte de
l’enlèvement de la terre & de fon renverfement
par l’aétion de la charrue. On l’appelle Sillon
dans quelques lieux, quoique ce nom s’applique,
dans d’autres, à la terre renverfée & par confé-
quent Caillante. Voye7^ Sillon & Labo ur.
La largeur des Raies eft déterminée par celle
du foc, ou mieux de l’oreille qui lui fert de prolongement.
Leur profondeur dépend du plus ou
moins d’ inclinaifon que la difpofition de la charrue
ou fon çondu&eur donne à la pointe de ce même
foc. Voye\[ C harrue.
L’important, dans la formation des filions, eft
qu’ils foienc droits & partout de même profondeur.
La profondeur des Raies eft communément de
quatre à huit pouces , félon le terrain & l’objet
de la culture ; mais au moyen d’une forte charrue
, traînée par un puiffant attelage, ou d’ une
charrue plus foib le , mais ayant deux focs qui
f e . fuivent à une hauteur différente , on peut les
former de douze, & même, dit-on, de quatorze
pouces.
Lorfque les Raies font larges, profondes , irrégulières
, & deftinées uniquement à l’écoulement
des eaux, on les appelle des Egouts , des Ma î tres.
Voye^ ces mots.
Dans quelques cantons , ce mot eft fynonyme
de labour ; car on y dit femer fur une Raie , au
lieu de-dire fur un feul labour ; Raie au blé.
c’eft-à-dire, troifième labour fur lequel on fème.
( Bosc. )
RAIFORT. R a ph an u s .
Genre de plantes de la tétradynamie filiqueufe
& de la famille des Crucifères, qui renferme quatorze
efpèces, dont une eft extrêmement commune
dans nos champs & nuit Couvent au produit
des récoltes, & dont une autre, ainfi que
fes variétés, fe cultive dans nos jardins pour
l’ufàge de la table. Il eft figuré pl. y66 des lllufira-
tions des genres de Lamarck.
Efpeces.
1. Le Ra if o r t fauvage, vulgairement faux raifort.
Raphanus raphaniflrum. Linn. © Indigène.
2. Le Raifort cultivé, vulgairement le radis,
la petite rave.
Raphanus fitivus, Linn. (2) De la Perfe & de là
Chine.
3. Le Raifort pileux.
Raphanus pilofus. Willd. De la Guinée.
4. Le Raifort de Sibérie.
Raphanus fibiricus. Linn. O De la Sibérie,
y. Le Raifort à longues Cliques.
Raphanus caudatus. Linn. O Ds Final.
6 . Le Raifort lancéolé.
Raphanus lançeolatus. Willd. De l’Amérique
méridionale.
7. Le Raifort à Cliques arquées.
Raphanus arcuatus. Willd. (•) De .....
8. Le Raifort fluet.
Raphanus tenellus. Pall. O De la Sibérie.
9. Le Raifo rt à feuilles de roquette.
Raphanus ericoides. Linn. <ƒ* De l’ Italie.
10. Le Raifo rt à feuilles,en lyre.
Raphanus lyratus. Forskh. De l’Egypte.
1 1 . Le Raifort recourbé.
Raphanus recurvatus. Perf. De l’Égypte.
12. Le Raifort à groffes Cliques.
Raphanus turgidus. Perf. De l’Egypte.
13. Le Raifort à Cliques ailées.
Raphanus pteroïarpus. Perf. De l’Egypte.
14. Le Raifort à feuilles de giroflée.
Raphanus ch&rantifolius .W illd . o* D e l’Égyptî.
Culture.
Les deux premières efpèces, ainfi que les huitième
& quatorzième , font les feules qui fe cultivent
dans nos écoles de botanique. On les fème
•généralement en place, & lorfque le plant eft
levé , on l’éclaircit & on l’arrofe dans la chaleur.
La dernière cependant profpère mieux fi on la
fème dans un pot fur couche nue, pour en repiquer
le plant en motte, lôrfqu’ il a acquis deux ou trois
pouces de haut, contre un mur expofé au midi.
La première efpèce, à raifon de fon abondance
dans les champs cultivés en céréales , doit
être regardée comme une mauvaifè herbe , & en
conféquence extirpée par tous les moyens pof-
fibles. On la confond généralement avec la moutarde
des champs, dont elle fe diftingue cependant
au premier coup d’oeil par des fleurs plus
grandes, d’un jaune plus pâle & Criées de brun ,
& principalement par fon fruit, qui ne fe fépare
pas en deux valves. C e que j’ai dit de cette moutarde
s’applique complètement au Raifort en
queftiort ; je n’en entretiendrai donc pas plus longuement
le leéteur.
L ’ancienneté de la culture dans nos jardins de
la fécondé efpèce, l’ a mife dans le cas d’offrir de
1 nombreufes variétés, dont quelques-unes font fi