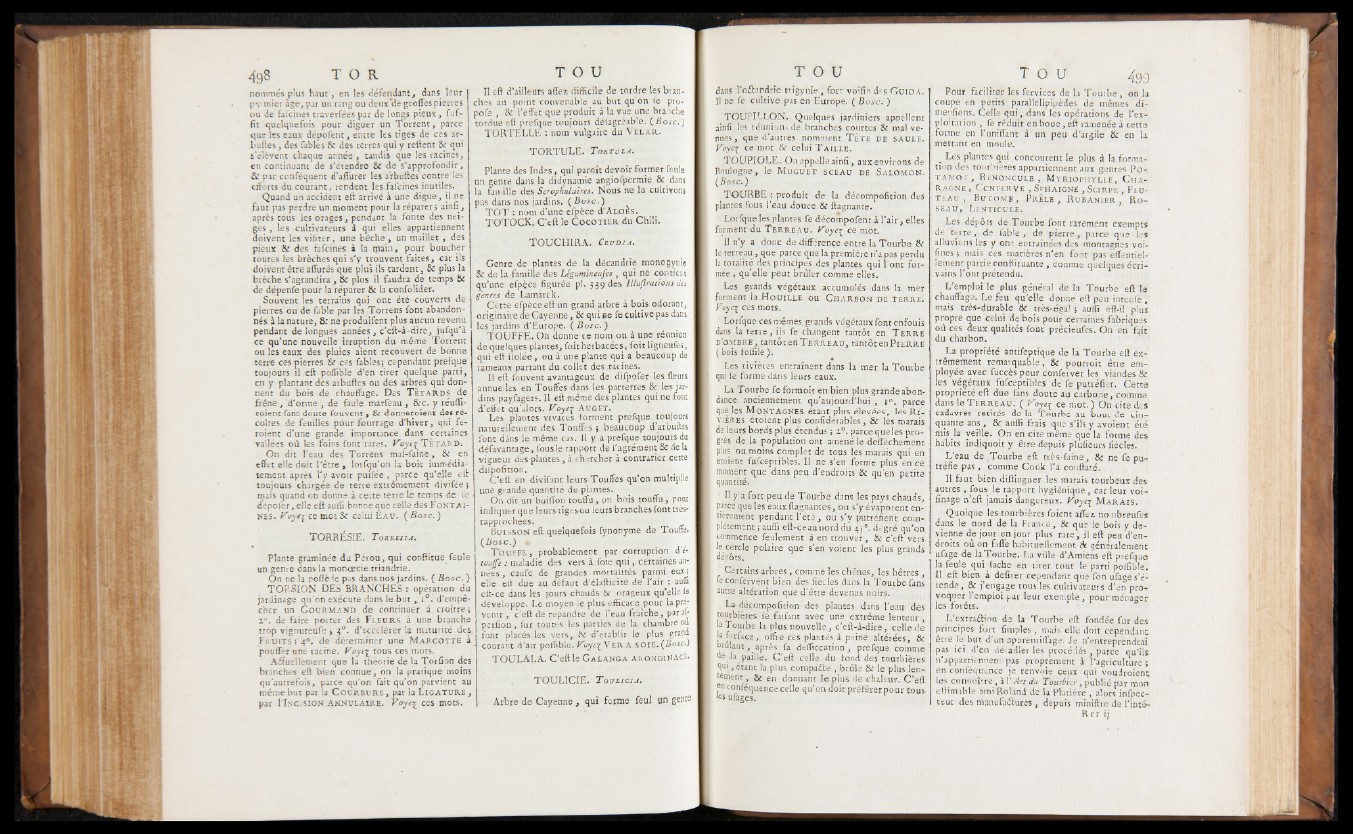
nommés plus haut , en les défendant, dans leur
p*v mier âge, par un rang oudeux*de groffes pierres
ou de fafcines traversées par de longs pieux, Suffit
quelquefois pour diguer un T orrent, parce
que les eaux dépofent, entre les tiges de ces ar-
bliftes, des fables & des terres qui y relient & qui
s’élèvent chaque année, tandis que les racines,
en continuant de s’étendre & de s’approfondir,
& par conféquent d’affurer les arbuftes contre les
efforts du courant, rendent les fafcines inutiles.
Quand un accident eft arrivé à une digue, il ne
faut pas perdre un moment pour la réparer? ainfi,
après tous les orages, pendant la fonte des neiges
, les cultivateurs à qui elles appartiennent
doivent les vifiter, une bêche, un maillet, dés
pieux & des fafcines à la main, pour boucher
toutes les brèches qui s’y trouvent faites, car ils
doivent être affurés que plus ils tardent, & plus la
brèche s’agrandira, & plus il faudra de temps 8ç
de dépenfe pour la réparer & la confolider.
Souvent les terrains qui ont été couverts de
pierres ou de fable par les Torrens font abandonnés
à la nature, & ne produifent plus aucun revenu
pendant de longues années, c’eft-à-dire, jufqu’ à
ce qu’ une nouvelle irruption du même Torrent
ou les eaux des pluies aient recouvert de bonne
terre ces pierres & ces fablesj cependant prefque
toujours il eft poffible d’en tirer quelque parti,
en y plantant des arbuftes ou des arbres qui donnent
du bois de chauffage. Des T êtards de
frêne, d’ orme , de faule marfeau , & c . y réuffi-
roient fans doute fouvent, & donneroient des récoltes
de feuilles pour fourrage d’hiver, qui fe-
roient d’une grande importance dans certaines
vallées où les foins font rares. Voyt\ T êtard.
On dit l’eau des Torrens mal-faine, & en
effet elle doit l ’être , lorfqu’on la boit immédiatement
après l’y avoir puifée, parce qu’elle eft
toujours chargée de terre extrêmement divifée 5
mais quand on donne à cette terre le temps de fe
dépofer,.elle eft auffi bonne que celle des Fontaines.
Voye^ ce mot & ceiui Eau . ( Rose. )
TORRÉSIE. T orresia.
Plante graminée du Pérou, qui conftitue feule
un genre dans la monoecie triandrie.
On ne la pofle-îe pas dans nos jardins. ( Rose, y
TORSION DES BRANCHES : opération du
jardinage qu’on exécute dans le but, i°- d’empêcher
un Gourmand de continuer à croître ;
20. de faire porter des Fleurs à une branche
trop vigoureufë 5. 30. d’accélérer la maturité.des
Fruits ; 40. de déterminer une Marcotte à
pouffer une racine. Voye£ tous ces mots.
Actuellement que la théorie de la Torfion des
branches eft bien connue, on la pratique moins
qu’autrefois, parce qu’on fait qu’on parvient au
même but par la C ourbure, par la Ligature,
par riN cisioN Annulaire. Voye£ ces mots.
Il eft d’ ailleurs affez difficile de tordre les branches
au point convenable au but qu’on le pro-
pofe , & l’effet que produit à la vue une branche
tordue eft prefque toujours dé (agréable. (,Bosc.)
TORTELLE : nom vulgaire du V e l a r .
TO R TULE . T o r tu l a .
Plante des Indes, qui paroît devoir former feule
un genre dans la didynamie angiofpermie & dans
la famille des Scropkulaires. Nous ne la cultivons
pas dans nos jardins. (B o s c .)
T O T : nom d’une efpèce d’A io è s .
TO TO CK . G’eft le C o co t ie r du Chili.
TO U CH IR A . Cr u d ia .
Genre de plantes de la décandrie monogynie
& de la famille des Légumineufes , qui ne contient
qu’ une efpèce figurée pl. 339 des llluftrations des
genres de Lamàrclc.
! Cette efpèce eft un grand arbre à bois odorant,
i originaire de C ayenne, & qui ae fe cultive pas dans
les jardins d’Europe. ( B o sc . )
TOUF FE . On donne ce nom ou à une réunion
de quelques plantes, foit herbacées, foit ligneufes,
qui eft ilolé e, ou à une plante qui a beaucoup de
rameaux partant du collet des .racines.
Il eft fouvent avantageux de difpofer les fleurs
annuelles en Touffes dans les parterres & les jardins
payfagers. Il eft même des plantes qui ne font
d’effet qu’alors. Voye% A ugBt .
Les plantes vivaces forment prefque toujours
naturellement des Touffes 5 beaucoup d arbuftes
font dans le même cas. 11 y a prefque toujours du
défavantage, fous le rapport de l’agrément & de la
vigueur des plantes, à chercher à contrarier cette
dilpofition.
C ’eft en divifant leurs Touffes qu’on multiplie
une grande quantité de plantes.
On dit un buiffon touffu, yn bois touffu, pour
indiquer que leurs tiges ou leurs branches font très-
rapprochées. '
Bu isson eft quelquefois fynonyme de Touffe.
(B o s c .) ♦
T o u f fe , probablement par corruption dV-
touffe : maladie des vers à foie qui, certaines an-
nées, caufe de grandes mortalités parmi eux ;
elle eft due au défaut d’élafticité de l'air : • aufli
eft-ce dans les jours chauds &’ orageux qu’elle fe
développe. Le moyen le plus efficace pour la prévenir
, c’eft de répandre de l’ eau fraîche, par af*
perfion,. fur toutes les parties de la- chambre ou
' font placés les vers,. & d’érablir le plus grand
• courant d'air poffible. Vyye% V er- a s o i e . (B osc.)
TO ULA LA. C ’ eft le G a l a n g a arondinacé.
TO UL IC IE . T o u l ic ia .
Arbre de Cayenne , qui forme feul un genrs
dans l’oCtandrie trigynie , fort voifin des GuiOA.
Il ne fe cultive pas en Europe. ( Bosc. )
TOURILLON. Quelques jardiniers appellent
ainfi les réunions de branches courtes & mal venues,
que d’autres nomment T ète de saule.
Voyei ce mot & celui T aille.
TOUPIOLE. On appelle ainfi, aux environs de
Boulogne, le Muguet sceau de Salomon.
(Bosc.)
TOURBE : produit de la décompofition des
plantes fous l’eau douce & ftagnante.
Lorfqueles plantes fe décompofent à l’air, elles
forment du T erreau. Voye? ce mot.
Il n’y a donc de différence entre la Tourbe &
le terreau, que parce que la première n’a pas perdu
la totalité des principes des plantes qui l’ont formée
, qu’elle peut brûler comme elles.
Les grands végétaux accumulés dans la mer
forment la Houille ou C harbon de terre.
Voye% ces mots.
Lorfque ces mêmes grands végétaux font enfouis
dans la terre, ils fe changent tantôt en T erre
d’ombre, tantôt en T erreau, tantôt en Pierre
( bois foffile);
Les rivières entraînent dans la mer la Tourbe
qui fe forme dans leurs eaux.
La Tourbe fe formoit en bien plus grande abondance
anciennement qu’ aujourd’hui i ° . parce
que les Montagnes étant plus élevées, les Ri vières
étoient plus confidérables, & les marais
de leurs bords plus étendus j 20. parce queles progrès
de la population ont amené le defféchement
plus ou moins complet de tous les marais qui en
étoient fufceptibles. Il ne s’ en forme plus en ce
moment que dans peu d’endroits & qu'en petite
quantité.
Il y a fort peu de Tourbe dans les pays chauds,
| parce que les eaux ftagnantes, ou s’y évaporent entièrement
pendant l’é t é , ou s’ y putréfient com-
I plétement; auffi eft-çeau nord du 45e. degré qu’ on
commence feulement à en trouver, & c'eft vers
le cercle polaire que s’en voient les plus grands
dépôts.
Certains arbres, comme les chênes, les hêtres ,
fe confervent bien des fiècles dans la Tourbe fans
1 autre altération que d’être devenus noirs.
, La décompofition des plantes dans l’eau des
tourbières fe fai Tant avec une extrême lenteur,
a Tourbe la plus nouvelle, c’eft-à-dire, celle de
I if [ur^ace* offre ces plantes à peine altérées, &
I brûlant, après fa defficcation, prefque comme
I de la paille. C'eft celle du tond des tourbières
I qui, étant la plus compacte , brûle & le plus 1er.-
I tement, & en donnant le plus de chaleur. C ’eft
I ®n conféquen.ce celle qu’ondoie préférer pour tous
I I£s ufages.
Pour faciliter les fervices de la Tou rb e , on la
coupe en petits parallélipipèdes de mêmes di-
menfions. Celle qui, dans les opérations de l’exploitation
, fe réduit en boue, eft ramenée à cette
forme en l’uniffant à un peu d'argile & en la
mettant en moule.
Les plantes qui concourent le plus à la formation
des tourbières appartiennent aux genres P o -
TAMOr, Renoncule, Myriophylle, C ha-
ragne , C cnferve , Sphaigne , Scirpe , Flu-
teau , Bu tom e , Prê le , Rubanier, Roseau,
Lenticule.
Les dépôts de Tourbe font rarement exempts
de Irerre, de fab le, de pierre, parce que les
alluvions les y ont entraînées des montagnes voi-
fines ; mais ces matières n’en font pas effentiel-
• lement partie conftituante, comme quelques écrivains
l’ont prétendu.
L’emploi le plus général de la Tourbe eft le
chauffage. Le feu qu’elle donne eft peu intenfe,
mais très-durable & très-égal 5 auffi eft-il plus
propre que Celui de bois pour certaines fabriques
où ces deux qualités font précieufes. On en fait
du charbon.
La propriété antifeptique de la Tourbe eft extrêmement
remarquable, & pourroit être employée
avec fuccès pour conferver les viandes &
les végétaux fufceptibles de fe putréfier. Cette
propriété eft due fans doute au carbone, comme
dans le T erreau. ( Voye[ ce mot.) On cite des
cadavres retirés de la Tourbe au bout de cinquante
ans , & auffi frais que s’ ils y avoient été
mis Ja veille. On en cite même que la forme des
habits indiquoit y être depuis plufieurs fiècles.
L ’eau de ^Tourbe eft très-faine, & ne fe pu-
• tréfie pas, comme Cook l’ a conftaté.
Il faut bien diftinguer les marais tourbeux des
autres , fous le rapport hygiénique, car leur voi-
finage n’eft jamais dangereux. Voyei Mar a is .
Quoique les tourbières foient affez nombreufes
dans le nord de la France, & que le bois y devienne
de jour en jour plus rare, il eft peu d’endroits
où on faffe habituellement généralement
ufage de laTourbe. La ville d’Amiens eft prefque
la feule qui lâche en tirer tout le parti poffible.
Il ,eft bien à defirer cependant que fon ufage s’étende,
& j’engage tous les cultivateurs d’en provoquer
l’emploi par leur exemple, pour ménager
les forêts.
L ’ extraCtion de la Tourbe eft fondée fur des
principes fort fimples, mais elle doit cependant
être te but d'un aporenriffage. Je n’entreprendrai
pas ici d’en détailler les procédés, parce qu’ils,
n’ appartiennenr pas proprement à l’agriculture >
en conféquence je renvoie ceux qui voudroient
les connoître, à Y Art du Tourbier, publié par mon
eftimable ami Roland de la Platière , alors infpec-
teur des manufactures, depuis miniftre de i’ inté-
R r r ij