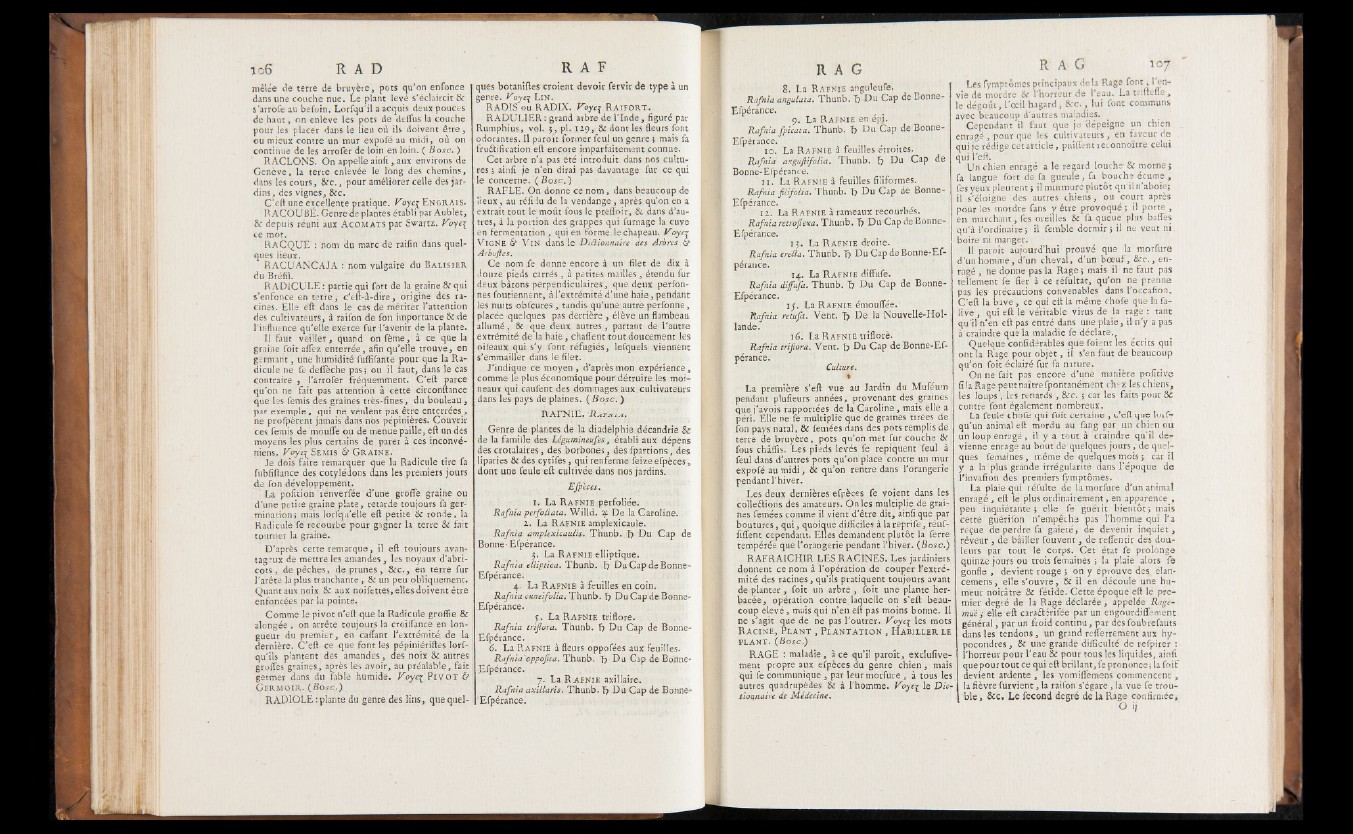
mêlée de terre de bruyère, pots qu’ on enfonce
dans une couche nue. Le plant levé s'éclaircit &
s'arrofe au befoin. Lorfqu'il a acquis deux pouces
de haut, on enlève les pots de deflus la couche
pour les placer dans le lieu où ils doivent ê tre ,
ou mieux contre un mur expofé au midi, où on
continue de les arrofer de loin en loin. ( B ose. )
RACLONS. On appelle ainfi, aux environs de
Genève, la terre enlevée le long des chemins,
dans les cours, & c . , pour améliorer celle des jardins,
des vignes, & c .
C ’ eft une excellente pratique. Voye% Engrais.
RACOU 8É . Genre de plantes établi par Au blet,
& depuis réuni aux A comats par Swartz. Voye\
ce mot.
Ra CQ U E : nom du marc de raifin dans quelques
lieux.
RA CU AN CAJA : nom vulgaire du Balisier
du Bréfil.
RADICULE : partie qui fort de la graine & qui
s’enfonce en terre, c’eft-à-dire, origine des racines.
Elle éft dans le cas de mériter l’ attention
des cultivateurs, à raifon de fon importance & de
l'influence qu’elle exerce fur l’avenir de la plante.
Il faut v e ille r , quand on fème, à ce que la
graine foit allez enterrée, afin qu’elle trouve, en
germant, une humidité fuffifante pour que la Radicule
ne fe delfèche pas; ou il faut, dans le cas
contraire > l’arrofer fréquemment. C ’eft parce
qu’on ne fait pas attention à cette circonftance
que les femis des graines très-fines, du bouleau,
par exemple, qui ne veulent pas être enterrées,
ne profpèrent jamais dans nos pépinières. Couvrir
ces femis de mouffe ou de menue paille, eft un des
moyens les plus certains de parer à ces inconvé-
niens. Voye\ Semis & Graine.
Je dois faire remarquer que la Radicule tire fa
fubfiftance des cotylédons dans les premiers jours
de fon développement.
La pofition îënvetfée d’une grolfe graine ou
d ’une petite graine plate, retarde toujours fà germination
; mais lorfqu’elle eft petite & ronde, la
Radicule fè recourbe pour gagner la terre & fait
tourner la graine.
D ’après cette remarque, il eft toujours avantageux
de mettre les amandes, les noyaux d’abrico
ts , de pêches, de prunes, & c . , en terre fur
l ’arête la plus tranchante, & un peu'obliquement.
Quant aux noix & aux noifettes, elles doivent être
enfoncées par la pointe.
Comme le pivot n’eft que la Radicule groffie &
aîongée , on arrête toujours la croilfance en longueur
du premier, en caftant l’extrémité.-de la
dernière. C ’ eft ce que font les pépiniériftes lorf-
qu’ ils plantent des amandes, des noix & autres
groftes graines, après les avoir, au préalable, fait
germer dans du fable humide. Voye^ Piv o t &
G ermqir. (,Bosc.)
RADIO LE : plante du genre des lins, que quelques
botaniftes croient devoir fervir de type à un
genre. Voye\ Lin.
RADIS ou RADIX. Raifort.
RADULIER : grand arbre de l’ Inde, figuré par
Rumphius, vol. 3, pl. 129, & dont les fleurs font
odorantes. Il paroîc former feul un genre; mais fa
fru&ification eft encore imparfaitement connue.
Cet arbre n’a pas été introduit dans nos cultures
5 ainfi je n’en dirai pas davantage fur ce qui
le concerne. ( Bosç.,)
RAFLE. On donne ce nom, dans beaucoup de
lieux, au réfidu de la vendange, après qu’on en a
extrait tout le moût fous le pçefloir, & dans d’au-
: très, à la portion des grappes qui fumage la cuve
en fermentation , qui en forme le chapeau. Voyeç
V igne & V in dans le Dictionnaire des Arbres ù
Arbuftes.
C e nom fe donne encore à un filet de dix à
douze pieds carrés, à petites mailles, étendu fur
deux bâtons perpendiculaires , que deux perfon-
nes foutiennent, à l’extrémité d’une haie, pendant
les nuits obfcures,. tandis-qu’ une autre perfonne,
placée quelques pas derrière , élève un flambeau
allumé, 8c que deux autres, partant de l’autre
extrémité de la haie, châtient tout doucement les
oifeaux qui s’y. font réfugiés, lefquels viennent
s’emmailler dans le filet.
J’indique ce moyen , d’après mon expérience,
comme le plus économique pour détruire les moineaux
qui caufent des dommages aux cultivateurs
dans les pays de plaines. ( B o s c . )
RAFNIE. 'RatniA.
Genre de plantes de la diadelphie décandrie &
de la famille des Légumineufes, établi aux dépens
des crotalaires, des borbones, des fpartions, des
liparies & des cytifes, qui renferme, feize efpèces,
dont une feule eft cultivée dans nos jardins.
Efpeces.
1. La Rafnie perfoliée,.
Rafnia perfoliata. Willd. ^ De la Caroline.
2. La Rafnie amplexicaule.
Rafnia amplexicaulis. T h u n b .b Du Cap de
Bonne- Efpérance.
3. La Rafnie elliptique.
Rafnia elliptica. Thunb. f) Du Cap de Bonne-
Efpérance.
4. La Rafnie à feuilles en coin.
Rafnia cuneifolia. Thunb. b Du Cap de Bonne-
Efpérance.
y. La Rafnie triflore.
Rafnia trijlora. Thunb. b Du Cap de Bonne-
Efpérance.
6 . La Rafnie à fleurs oppofées aux feuilles.
Rafnia'oppojtta. Thunb. b Du Cap de Bbilne-
Efpérance.
7. La R afnie axillaire.
. Rafnia axillaris. Thunb. T) Du Cap de Bonne-
Efpérance.
8. La R afnie anguleufe.
Rafnia angulata. Thunb. T? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
9. La Rafnle en épi.
Rafnia fpicata. Thunb. T? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
10. La Rafnie à feuilles étroites..
Rafnia angufiifolia. Thunb. b Du Cap de
Bonne-Efpérance.
11. La Rafnie à feuilles filiformes.
Rafnia flifolia. Thunb. b Du Cap de Bonne-
Efpérance.
12. La Rafnie à rameaux recourbés.
Rafnia retrofiexa. Thunb. T? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
13. La Rafnie droite.
Rafnia eretta. Thunb. b Du Cap de Bonne-Efpérance.
14. La Rafnie diffufe.
Rafnia diffufa. Thunb. 1? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
iy. La Rafnie émouftee.
Rafnia retufa. Vent, f? De la Nouvelle-Hollande.
16. La Rafnie triflorë.
Rafnia trifiora. Vent, b Du Cap de Bonne-Efpérance.
Culture.
*
La première s’eft vue au Jardin du Muféum
pendant plufieurs années, provenant des graines j
que j’avois rapportées de la Caroline , mais elle a
péri. Elle ne fe multiplie que de graines tirées de
fon pays natal, & femées dans des pots remplis de :
terre de bruyère, pots qu’on met fur couche &
fous châflîs. Les pieds levés fe repiquent feul à
feul dans d’autres pots qu’on place contre un mur
expofé au midi, & qu’on rentre dans l’orangerie
pendant l’hiver.
Les deux dernières efpèces fe voient dans les
colleêtions des amateurs. On les multiplie de graines
femées comme il vient d’être dit, ainfi que par
boutures, qui, quoique difficiles à la reprife, réuf-
fiffent cependant. Elles demandent plutôt la ferre
tempérée que l’orangerie pendant l’hiver. (Bosc.)
RAFRAICHIR LES RACINES. Les jardiniers
donnent ce nom à l’opération de couper Fextré-
mité des racines, qu’ils pratiquent toujours avant
de planter, foit un arbre , foit une plante herbacée,
opération contre laquelle on s’eft beaucoup
élevé, mais qui n’en eft pas moins bonne. Il
ne s’agit que de ne pas l’outrer. Voye^ les mots
Racine, Plant , Plantation , Habiller le
PLANT. (Bosc.)
RAGE : maladie, à ce qu’il paroît, exclufive-
ment propre aux efpèces du genre chien, mais
qui fe communique , par leur morfure , à tous les
autres quadrupèdes & à l’homme. Voye^ le Dictionnaire
de Médecine.
Les fymptornes principaux delà Rage fo n t, 1 envie
de mordre & l’horreur de l’eau. La triftefte,
le dégoût, l'oeil hagard, & c . , lui font communs
avec beaucoup d'autres maladies.
Cependant il faut que je "dépeigne un chien
enragé, pour que les cultivateurs, en faveur de
qui je rédige cet article, puiffent reconnoître celui
qui l'eft. _
Un chien enragé a le regard louche & morne ;
fa langue fort de fa gueule, fa bouche écume,
fes yeux pleurent ; il murmure plutôt qu'il n’aboie;
il s’éloigne des autres chiens, ou court après
pour les mordre fans y être provoqué ; il porte ,
en marchant, fes oreilles & fa queue plus baffes
qu’ à l’ordinaire; il femble dormir ; il ne veut ni
boire ni manger.
Il paroît aujourd’hui prouvé que la morfure
d'un homme, d’ un cheval, d’ un boe u f, & c . , enragé
, ne donne pas la Rage ; mais il ne faut pas
tellement fe fier à ce réfultat, qu’ on ne prenne
pas les précautions convenables dans l’occafion.
C ’eft la b ave, ce qui eft la même chofe que la fa-
live , qui eft le véritable virus de la rage : tant
qu'il n’en eft pas entré dans une plaie, il n'y a pas
à craindre que la maladie fe déclare.
Quelque confiderables que foient les écrits qui
ont la Rage pour o b je t, il s’en faut de beaucoup
qu’ on foit éclairé fur fa nature.
On ne fait pas encore d’unè manière pofîtive
fila Rage peut naître fpontanément chez les chiens,
les loups , les renards , & c . ; car les faits pour 8c
contre font également nombreux.
La feule chofe qui foit certaine , c’eft que lorf-
qu’ un animal eft mordu au fang par un chien ou
un loup enragé, il y a tout à craindre qu’il devienne
enragé au bout de quelques jours, de quelques
fe mai nés, même de quelques mois ; car il
y a la plus grande irrégularité dans l ’époque de
l’invafion des premiers fymptômes.
La plaie qui réfulte de la morfure d’ un animal
enragé, eft le plus ordinairement, en apparence ,
peu inquiétante ; elle fe guérit bientôt; mais
cette guérifon n’ empêche pas l'homme qui l’ a
reçue de perdre fa gaieté, de devenir inquiet,
rêveur , de bâiller fouvent, de reffentir des douleurs
par tout le corps. C et état fe prolonge
quinze jours ou trois femaines ; la plaie alors fe
gonfle , devient rouge ; on y éprouve des. élan-
cemens, elle s’ ouvre, & il en découle une humeur
noirâtre & fétide. Cette époque eft lé premier
degré de la Rage déclarée, appelée Rage-
mue ,* elle eft caraêtérifée par un engourdiffement
général, par un froid continu, par des foubrefauts
dans les tendons, un grand refferrement aux hy-
pocondres, & une grande difficulté de refpirer :
l’horreur pour l’eau & pour tous les liquides, ainfi
quepour tout ce qui eft brillant, fe prononce; la foif
devient ardente , les vomiffemens commencent ,
la fièvre furvient, la raifon s’égare, la vue fe troub
le , & c . Le fécond degré de la Rage confirmée *
O I