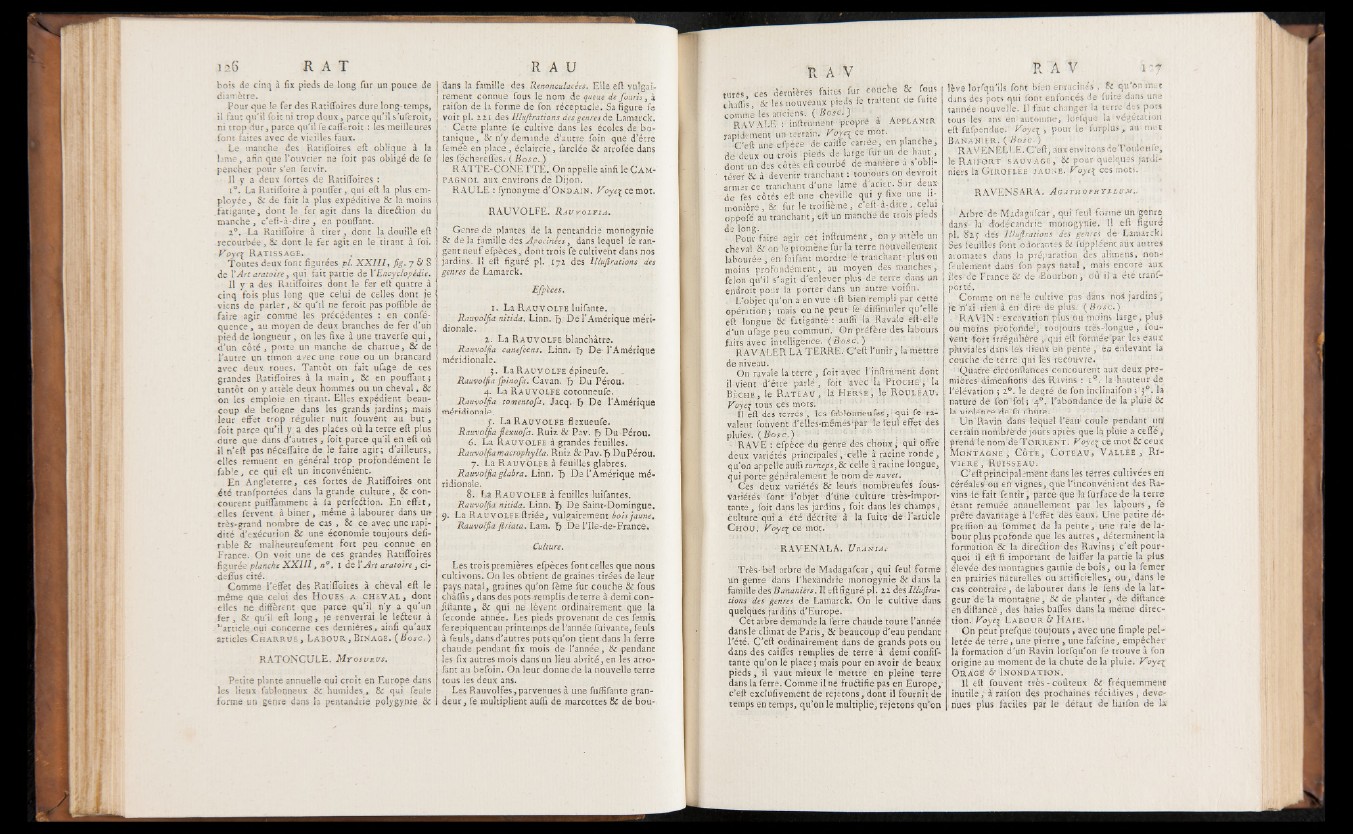
bois de cinq à fix pieds de long fur un pouce de
diamètre.
Pour que le fer des Ratiffoires dure long-temps,
il faut qu'il foie ni trop doux, parce qu’il s'uferoit,
ni trop dur, parce qu’il fe cafferoic : les meilleures
font faites avec de vieilles faux.
Le manche des Ratiffoires eft oblique à la
lame, afin que l’ouvrier ne foit pas obligé de fe
pencher pour s’en fervir.
Il y a deux fortes de Ratiffoires :
i°. La Ratiffoire à pouffer, qui eft la plus employée,
8c de fait la plus expéditive & la moins
fatigante, dont le fer agit dans la direction du
manche, c’eft-à-dire, en pouffant.
2°. La Ratiffoire à tirer, dont la douille eft
recourbée, & dont le fer agit en le tirant à foi.
Voyez Ratissage.
Toutes deux font figurées pL X X I I I , fig. 7 & 8
de Y Art aratoire y qui fait partie de Y Encyclopédie.
Il y a des Ratiffoires dont le fer eft quatre à
cinq fois plus long que celui de celles dont je
viens de parler, 8c qu’il ne feroit pas poflible de
faire agir comme les précédentes : en confé-
quence, au moyen de deux branches de fer d’un
pied de longueur, on les fixe à une traverfe qui,
d’un côté, porte un manche de charrue, 8c de
l’autre un timon avec une roue ou un brancard
avec deux roues. Tantôt on fait ufage de ces
grandes Ratiffoires à. la main, & en pouffant ;
tantôt on y attèie deux hommes ou un cheval, 8c
on les emploie en tirant. Elles expédient beaucoup
de befogne dans les grands jardins j mais
leur effet trop régulier nuit fouvent au b u t,
foit parçe qu’il y a des places, où la terre eft plus
dure que dans d’autres , foit parce qu'il en eft où
il n’eft pas néceffaire de le faire agir; d’ailleurs,
elles remuent en général trop profondément le
fable, ce qui eft un inconvénient.
En Angleterre, ces fortes de Ratiffoires ont
été tranfportées dans la grande culture, 8c concourent
puîffamment à la perfection. En effet,
elles fervent à biner, même à labourer dans un-
très-grand nombre de cas , 8c ce avec une rapidité
d’exécution 8c une économie toujours delï-
rable & malheureusement fort peu connue en
France. On voit une de ces grandes Ratiffoires
figurée planche X X I 11, n°, 1 de Y Art aratoire , ci-
deffus cité.
Comme l’effet des Ratiffoires à cheval eft le
même que celui des Houes a cheval, dont
elles ne diffèrent que parce qu’il n’y a qu’un
fe r, 8c qu’il eft long, je renverrai le lecteur à
’’article oui concerne ces dernières, ainfi qu’aux
articles C harrue, Labour, Binage. ( Bosc.)
R A TO N CU LE . M yosurus.
Petite plante annuelle qui croît en Europe dans
les lieux Sablonneux & humides,, 8c qui feule
forme un genre dans la pentandrie polygynie 8c
dans la famille des Renonculacées. Elle eft vulgairement
connue fous le nom de queue de fauris, à
raifon de h forme de fon réceptacle. Sa figure fe
voit pl. 221 des lllufirations des genres de Lamarck.
■ Cette plante fe cultive dans les écoles de botanique,
8c n’y demande d’autre foin que d’être
feméè en place, éclaircie, fardée 8c arrofée dans
les féchereffes. ( Bosc.)
R ATTE-CONETTE. On appelle ainfi le Campagnol
aux environs de Dijon.
RAULE : fynonyme d’ONDAiN. Voyez ce mot.
RAUVOLFE. R a u v o l f ia .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
8c de la famille des Apocinées, dans lequel fe rangent
neuf efpèçes, dont trois fè cultivent dans nos
jardins. 11 eft figuré pl. 172 des lllufirations des
genres de Lamarck.
Efpéces.
1. La Rauvolfe luifante.
Rauvolfia nitida. Linn. De l’Amérique méridionale.
2. La Rauvolfe blanchâtre.
Rauvolfia canefcens. Linn. J) De- l’Amérique
méridionale.
$. La Rauvolfe épineufe. . I
Rauvolfia fpinofa. Cavan. T? Du Pérou.
4. La Rauvolfe cotonneufe.
Rauvolfia tomentofa. Jacq. De l’Amérique
méridionale.
y. La Rauvolfe flexueufe.
Rauvolfia flexuofa. Ruiz 8c Pav. T) Du Pérou.
6. La Rauvolfe à grandes feuilles.
Rauvolfiamacrophylla. Ruiz 8c Pav.Tj Du Pérou.
7. La Rauvolfe à feuilles glabres.
Rauvolfia glabra. Linn. T) Ds l’Amérique mé*
ridionale.
8. La Rauvolfe à feuilles luifantes.
Rauvolfia nitida. Linn. De Saint-Domingue.
9. La Rauvolfe ftriée, vulgairement bois jaune.
Rauvolfia ftriata. Lam. f) De l’Ile-de-France.
Culture.
Les trois premières efpèces font celles que nous
cultivons. On les obtient de graines tirées de leur
pays natal, graines qu’on fème fur couche 8c fous
châffis, dans des pots remplis de terre à demi con-
jïftante, 8c qui ne lèvent ordinairement que la
fécondé année. Les pieds provenant de ces femia
fe repiquent au printemps de l’année fuivante, feuls
à feuls, dans d’autres pots qu’on tient dans la ferre
chaude pendant fix mois de l’année, 8c pendant
les fix autres mois dans un lieu abrité, en les arro-
fant au befoin. On leur donne de la nouvelle terre
tous les deux ans.
Les Rauvolfes,parvenues à une fiiffifante grandeur,
fe multiplient aufli de marcottes 8c de boutures,
ces dernières faites fur couche 8c fous
thaflis, 8c les nouveaux pieds fe traitent de fuite
comme les anciens-. (Æoje.)| • 1 (
RAVALE : infiniment1 propre a APPLANIR
rapidement un terrain. Voÿè% ce mon
C’eft unè e-fpèce dè caiffe carree, en planche,,
de deux ou trois pieds de large fur un de haut,
dont un des côtés eft courbé de manière a s oblitérer
8c-à d e venir tranchant : toujours on devroit
armer ce tranchant d’une lame d acier. Sur deux'
de fes côtés eft une cheville qui y fixe une h-
monière, 8c fur le troifième, c’eft-à*dire, celui
de long. . • m
Pour faire agir cet infirumént, on y attele un
cheval 8c on le promène fur la terre nouvellement
labourée , en faifant mordre le tranchant -plus ou
moins profondément, au moyen des manches,
félon qu’il S’agit d’enlever pl-us-de terre dans un
endroit pour la porter dans un autre yoifin.
L’objet qu’on a en vue eft bien rempli par cette
opération 5 mais ou ne peut fe diffimuler qu’eîlé
eft longue 8c- fatigante : aufli la Ravale' éft-elîe
d’un ufage peu, commun. On préfère des labours
faits avec intelligence. (Bosc. ) 3
RAVALER LA TERRE. C’eft l’unir, la mettre
de niveau. ‘
On ravale la'terre , foit avec rififtmment dont
il-vient d’êtré parlé-, foit avec la Piocher 1 la
Bêche, le Rateaü , la Herse, lé Rouleau.
Voye£ tous' ces mots:! ■ :- (J : ' lU ' ' ‘ ' ‘ -
Il eft des terrés| les ffabîonneufes, J qui fe-ravalent
fouvent d’èllès-mémésJpar le feül effet des
pluies-. (B lo s c . ) ' : c ! .
RAVE : êfpèce du genre des choiix j qui' offre
deux variétés principales^ Celle à racine ronde,
qu’on appelle aufli 8c celle à racine longue,
qui porte- généralement le nom de navet.
Ces deux variétés 8c leurs nombreufes fous-
variétés font l’objet d’üne culture très-importante
, foit dans les jardins, foit dans les champs,
culture qui à été décrite' à la. fuite de l’artifcle
C h ou ; Ployez ce mot.
R AVEN AL A. U r a n i a .
Très-bel arbre de'Madagafcar, qui feul forme
un genre dans l’hexandrie monogynie 8c dans la
famille des Bananiers. Il eft figuré pl. 22 des Illufira-
tions des genres de Lamarck. On le cultive dans
quelques jardins d’Europe.
Cet arbre demande la ferre chaude toute l’année
dans le climat de Paris, 8c beaucoup d’eau pendant
l’été. Ç’eft ordinairement dans de grands pots ou
dans des caiffes remplies de terre à demi confif-
tante qu’on le place ; mais pour en avoir de beaux
pieds, il vaut mieux le mettre en pleine terre
dans la ferre. Comme il né fructifie pas en Europe,'
c’eft exclufivement de rejetons , dont il fournit de
temps en temps, qu’on le multiplie, rejetons qu’on
lève lorsqu’ils font bien enracinés , & qu’on met
dans des pots qui font enfoncés de fuite dans une
tannée nouvelle. 11 faut changer la terre des pots
tous les ans en automne, lor-lque la végétation
eft fufpsndue» Voyez » Pour Ie fur plus, au mut
Bananier. ( B osc/)
RAVENELLE. C ’eft, aux environs deToulcnfe,
le Raifort sauvage, 8c pour quelques jardiniers
la Giroflée jaune. Voyez ces mots.
RAVENSARA. A g a t h o p h y l l v m ..
Arbre de Madagascar, qui feul forme un'genre
dans la dbdécandrie monogynie. 11 eft figuré
pl. 8ly dés lllufirations des genres de- Lamareki
Ses feuilles font odorantes 8c fùppléent aux autres
aromates dans la préparation des ali mens, non?
feulement dans.fon pays natal, mais encore aux
îles de France 8c de 'Bourbon, où il a été tranf-
portéV:y • -/ V • l- * ' - -, ; ■ ' _ a
Comme on ne lé cultive pas'dâns noë jardins '
je 'ff a’i - rietv à en dire de plus: ( B éW’d )
1 RAVIN : excavation plus ou inefins large, plus
ou moins1 pYofondë^ toujours trës-'longue, fou-
Vêtit 'foie irrégulière ,-qui eft formée par les eaux
phiviàlès'dans lés dieux ën pënté , èa enlevant la
couché de tèrre:qui les recouvre. -
-Quatre cîréonftànces concourent aux deux premières*
dimêhftons dés Ravins : 1®. la hauteur ds
l’élévation 52°. le degré de fon inclinaifon ; ■ 3° . la
nature dé fon fol 5 4°r l’abondance de la pluie 8c
la violence1 de fa chute. ‘
Un Ravin dans lequel l’iâù1 coule pendant un
certain norUbrè'dë jours après que la pluie a ceffé ÿ
prënd: le nom de T orrent. Voyez ce mot 8c ceux
Montagne, Côt’e., Coteau, V allée, Rivière
, Ruisseau.
G’eft principalement dans les terres cultivées en
céréales'Ym en vignes, que l’inconvénient des Ravins
lë fait fentir, parce que k furface de la terre
1 étant remuée annuellement par les labours, fe
prêté davantage à l’effet dés eaux'. Une petite dé-
preftion au fômmec de la pente, une raie de labour
plus profonde que les autres, déterminent la
formation 8c la direction des Ravins; c’eft pourquoi
il eft fi important de Iaiffer la partie la plus
élevée des-montagnes garnie de bois, ou la femer
en prairies naturelles ou artificielles, ou, dans le
cas contraire, de labourer dans le fens de la largeur
de la montagne, 8c de planter , de diftance-
• ërt diftancé, des haies baffes dans la même direc-
: tion. Voyez Labour & Haie. -
On peut prefque toujours » avec une fimple pelletée
de terre, une pierre, une fafeine, empêcher
la formation d’un Ravin lorfqu’on fe trouve à fon
origine au moment de la chute delà pluie. Voyez
Orage & Inondation.
Il eft fouvent très - coûteux 8c fréquemment
inutile ; à raifon des prochaines récidives, deve-
nues plus faciles par le défaut de liaifon de la