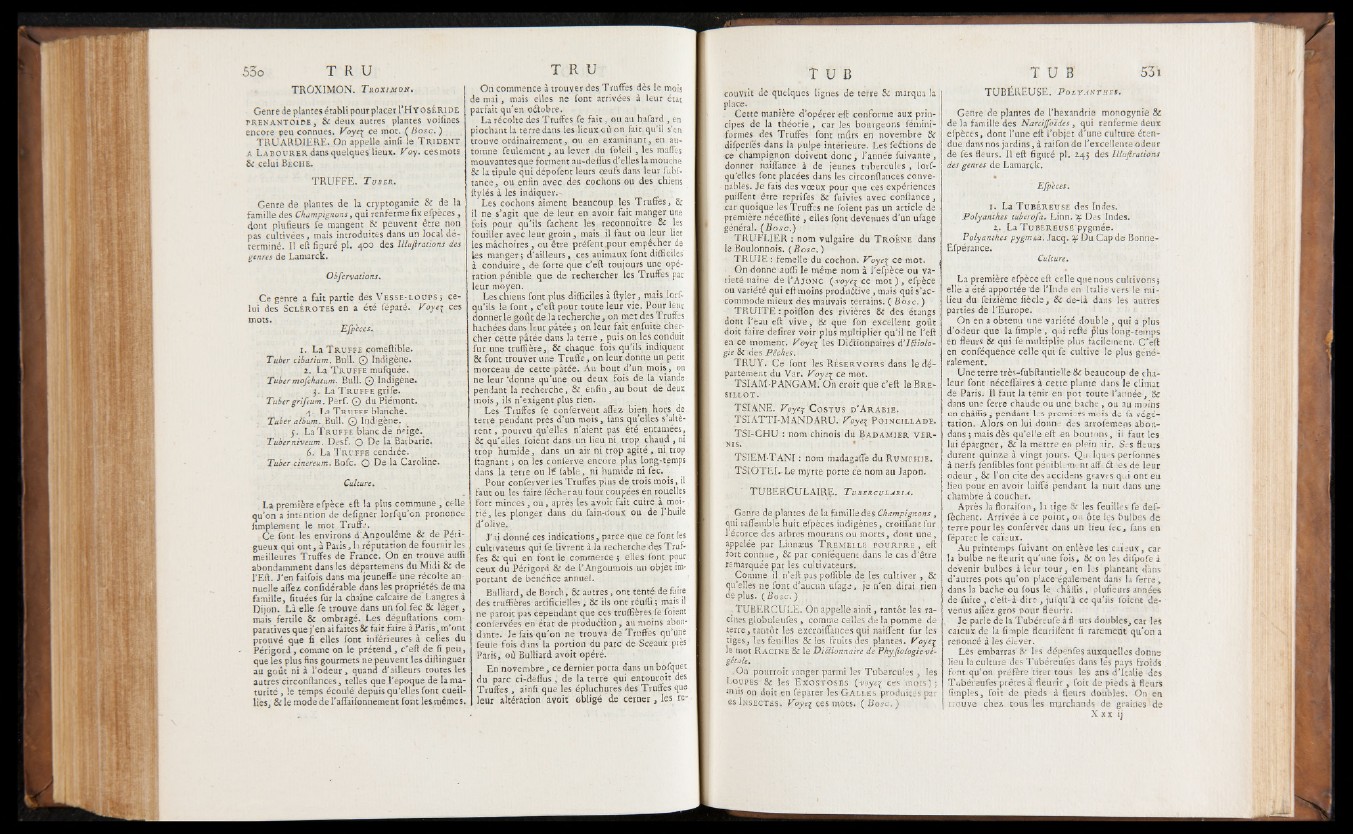
53o T R U
TRÛX1MON. T r o x imo n .
Genre de plantes établi pour placer l’H Y o s é r i d e
p r e n a n t o ïd e , & d e u x autres plantes voifines
encore peu connues. V o y e^ ce mot. ( B o s c . )
TRUARDIERE. On appelle ainfi le T rident
a Labourer dans quelques lieux. V o y . cesmots
& celui Bêche.
TRUFFE. T uber.
Genre de plantes de la cryptogamie & de la
famille des C h am p ig n o n s , qui renferme lix efpèces ,
dont plufieurs fe mangent & peuvent être non
pas cultivées, mais introduites dans un local dé- ,
terminé. Il eft figuré pl. 400 des l llu f t r a t io n s d es
g en r e s de Lamarck.
O b s e r v a t io n s ,
Ce genre a fait partie des V e s s e - l o u p s ; celui
des Sc l ê r o t e s en a été réparé. V o y e ^ ces
mots. î y .. .
E fp è c e s .
1. La T ruffe pomeftible.
T u b e r c ib a r ium . Bull. O Indigène.
2. La T ruffe mufquée.
T u b e r m o fch a tum . Bull. O Indigène.
3. La T ruffe grife.
T u b e r g r i fe um . Perf. © du Piémont.
4. La T r u f f e blanche.
T u b e r a lb u m . Bull. © I n d 'g è n e .
y . La T r u f f e b la n c d é neige.^
T u b e r n iv e um . Desf. O De la Barbarie.
6 . La T r u f f e c e n d ré e .
T u b e r c in e r eum . Bofc. O De-la Caroline.
C u ltu r e .
La première efpèce eft la plus commune , celle
qu’on a intention de défigner lorfqu’on prononce
fimplement le mot Truffe.
Ce font les environs d'Angoulême & de Péri-
gueux qui ont, à Paris, 1 » réputation de fournir les
meilleures Truffes de France. On en trouve aufli
abondamment dans les départemens du Midi & de
l’Eft. J’en faifois dans ma ieuneffe une récolte an
nuelle affez confidérable dans les propriétés de ma
famille, fituées fur la chaîne calcaire dé' Langres à
Dijon. Là elle fe trouve dans un fol. fec & léger,
mais fertile & ombragé. Les déguftations comparatives
que j’en ai faites & fait faire à Paris, m’ont
prouvé que fi elles font inférieures à celles du
Périgord, comme on le prétend, c’eft de fi peu,
que les plus fins gourmets ne peuvent les diftinguer
au goût ni à l’odeur, quand d’ailleurs toutes les
autres circonftances, telles que l’époque de la maturité
, le temps écoulé depuis qu'elles font cueillies,
& le mode de l’affaifonnement font lesmêmes.
T R U
On commence à trouver des Truffes dès le mois
de mai, mais elles ne font arrivées à leur état
parfait qu’en octobre.
La récolte des Truffes fe fait, ou au hafard , en
piochant la terre dans les lieux où on fait qu’il s'en
trouve ordinairement, ou en examinant, en automne
feulement, au lever du foleil, les maffes
mouvantes que forment au-deffus d’elles la mouche
& la tipule qui dépofent leurs oeufs dans leur fubf-
tance, ou enfin avec des cochons ou des chiens
ftylés à les indiquer.--
Les cochons aiment beaucoup les Truffes, &
il ne s’agit que de leur en avoir fait manger une
fois pour qu’ils fâchent les reconnoître & les
fouiller avec leur groin, mais il faut ou leur lier
les mâchoires, ou être préfent.pour empêcher de
Les manger; d’ailleurs, ces animaux font difficiles'
à conduire, de forte que c’eft toujours une opération
pénible que de rechercher les Truffes par
leur moyen.
Les chiens font plus difficiles à ftyler, mais .lorsqu’ils
le font, c’eft pour toute leur vie. Pour leur
donner le goût de la recherche, on met des Truffes
hachées dans leur pâtée; on leur fait,enfuite chercher
cette pâtée dans la terre, puis on les conduit
fur une truffière, & chaque fois qu’ils indiquent
& font trouver une Truffe, on leur donne un petit
morceau de cette pâtée. Au bout d’un mois, on
ne leur ‘donne qu’une ou deux fois de la viande
pendant la recherche, & enfin, au bout de deux
mois, ils n’exigent plus rien.
Les Truffes fe con fervent affez bien hors de
terre pendant près d’un mois, fans qu’elles s’altèrent
, pourvu qu’elles n’aient pas été entamées,
& qu’elles foient dans un lieu ni trop chaud , ni
trop humide, dans un air ni trop agité, ni trop
ftagnant ; on les conferve encore plus, long-temps
dans la terre ou 1£ fable, ni humide ni fec. ;
Pour conferver les Truffes plus de trois mois, il
faut ou les faire fécher au four coupées en rouelles
fort minces , ou, après les avoir fait cuire à moitié,
les plonger dans du fain-doux ou de l’huile
d’olive.
J’ai donné ces indications, parce que ce font les
cultivateurs qui fe livrent à la recherche des Truffes
& qui en font le commerce ; elles lont pour
ceux du Périgord & de I’Angoumois un objet important
de bénéfice annuel.
Bulliard, de Borch, & autres, ont tenté défaire
des truffières artificielles, & ils ont réuffi; mais il
ne paroît pas cependant que ces truffières fe foient
confervées en état de produdion, au moins abondante.
Je fais qu’on ne trouva de Truffes qu’une
feule fois dans la portion du parc de Sceaux près
Paris, où Bulliard avoit opéré.
En novembre, ce dernier porta dans un bofquet
du parc ci-deffus, de la terre qui entouroit des
Truffes , ainfi que les épluchures des Truffes que
leur altération ayoit obligé de cerner, les re-
T U B'
TUBÉREUSE. P O L Y A K THE t .
T U B
c o u v r it d e q u e lq u e s lig n es d e te f r e & m a rq u a la
place.
Cette manière d’opérer eft conforme aux principes
de la théorie , car les bourgeons fémini-
formes des Truffes font mûrs en novembre &
difperfés dans la pulpe intérieure. Les fe&ions de
•ce champignon doivent donc, l’année fuivanté,
donner naiffance à de jeunes tubercules , lorf-
qu’elles font placées dans les circonftances convenables.
Je fais des voeux pour que ces expériences
puiffent être reprifes & fuivies avec confiance,
car quoique les Truffes ne foient pas un article de
première néceffité , elles font devenues d’un ufage
général. ( B o s c . ) f
TRUFLIER : nom vulgaire du Troène dans
le Boulonnois. ( B o s c . )
TRUIE : femelle du cochon. V o y e z ce mot.
On donne aufli le même nom à l’efpèce ou variété
naine de I’A jo n c ( -v o y e z ce mot), efpèce
ou variété qui eft moins productive, mais qui s’ac-
commode mieux des mauvais terrains. ( B o s c , )
TRUITE : poiffon des rivières & des étangs
dont l’eau eft vive, & que fon excellent goût
doit faire defirer voir plus multiplier qu’il ne l’eft
en ce moment. V o y e z les Dictionnaires à T t f i o l o -
g ie & des P ê c h e s .
TRUY. Ce font les Réservoirs dans le département
du Var. V o y e % ce mot.
TSIAM-PANGAM. On croit que c’eft le Bre-
s i l l o t .
TSIÀNE. V o y e z CosTuS d’Arabie.
TSIATTI-MANDARU. V o y e z P o i n c i l l a d e .
TSI-CHU : nom chinois du B a d a m i e r v e r n
is . .
TSIEM-TANI : n om madagaffe d u R u m p h i e .
TSIOTEULe myrte porte ce nom au Japon.
' TUBERCULAIRE. T ü b e r c u l a r i a .
Genre de plantes de la famille des C h a m p ig n o n s ,
qui raffemble huit efpèces indigènes, croiffant fur
l’écorce des arbres mouransou morts, dont une,
appelée par Linnæus T r e m e l l e p o u r p r e , eft
fort connue, & par conféquenc dans le cas d’être
remarquée par les cultivateurs.
Comme il n’eft pas poffible de les cultiver , &
qu’elles ne font d’aucun ufage, je n’en dirai rien
de plus.. ( B o s c . ) I
- TUBERCULE. On appelle ainfi, tantôt les racines
globuleufes , comme celles de la pomme de
terre, tantôt les excroiffances qui naiffent fur les
tiges, les feuilles & les fruits des plantes. V o y e z
le mot RAC INE & le D iH io n n a i r e d e P h y j îo lo g ie v é g
é ta le . .
.On p o u r r o ît r a n g e r p a rm i les T u b e r c u le s , les
Lo u pes & le s E x o s t o s e s ( v o y e z c e s m o t s ) ;
u n is on d o it e n fé p â re r les G a l l e s p r o d u ite s p a r
es I n s e c t e s . V o y e z ce s m ó ts . ( B o s c . )
53 ï
Genre de plantes de l’hexandrie monogynie &
de la famille des N a r c i j fo ïd e s , qui renferme deux
efpèces, dont l’une eft l’objet d’une culture étendue
dans nos jardins, à raifon de l’excellente odeur
de fes fleurs. Il eft figuré pl. 243 des lllu f t r a t io n s
d e s g en r e s de Lamarck.
E fp è c e s .
1. La T u b é r e u s e des Indes.
P o l y a n t h e s tu b e r o fa . Linn. 'if Des Indes.
2. La TuBÉREUSE pygmée.
P o ly a n t h e s p y gm & a . Jacq. 2f D u Cap de Bonne-
Efpérance.
C u ltu r e .
La première efpèce eft celle que nous cultivons;
elle à été apportée de l’Inde en Italie'vers le milieu
du feizième fiècle, & de-là dans les autres
parties de l’Europe.
On en a obtenu une variété double , qui a plus
d’odeur que la fimple, qui refté plus long-temps
en fleurs & qui fe multiplie plus facilement. C’eft:
en conféquence celle qui fe cultive le plus généralement.
Une terre très-fubftantielle & beaucoup de chaleur
font néceffaires à cette planté dans le climat
de Paris. Il faut la tenir en pot toute l’année, &
dans une ferre chaude ou une bâche, ou au moins
un châffis ; pendant les premiers mois de fa végétation.
Alors on lui donne des arrofemeps abon-
dans ; mais dès qu’elle eft en boutons, ii faut les
lui épargner, & la mettre en plein air. S e s fleurs
durent quinze à vingt jours. Quelques perfonnes
à nerfs fenfibles font péniblement afft élues de leur
odeur , & l’on cite des accidens graves qui ont eu
lieu pour en avoir laiffé pendant la nuit dans une
chambre à coucher.
Après la floraifon, h tige 3c les feuilles fe def-
fèchent. Arrivée à ce point, oa ôte les bulbes de
terre pour les conferver dans un lieu fec, fans en
féparer le caïeux.
Au printemps fuivant on enlève les caïeux, car
la bulbe ne fleurit qu’unë fois, âc on les difpofe à
devenir bulbes à leur tour, en lus plantant dans
d’autres pots qu’on place'également dans la ferre,
dans la bâche ou fous le c h â f f i s , plufieurs années
de fuite , c’eft-à dire , jufqu’à ce qu’ils foient devenus
affez gros pour fleurir.
Je parle de la Tubéreufe à fl urs doubles, car les
caïeux de la fimple fleuriffènt fi rarement qu’on a
renoncé à les élever.
Les embarras B' les dépenfes auxquelles donne
lieu la culture des Tubéreufes dans les pays froids
font qu’on préfère tirer tous les ans d’Italie des
Tubéreufes prêtes à fleurir, foie de pieds à fleurs
Amples, foit de pieds à fleurs doubles. On en
trouve chez tous les marchands de graines de