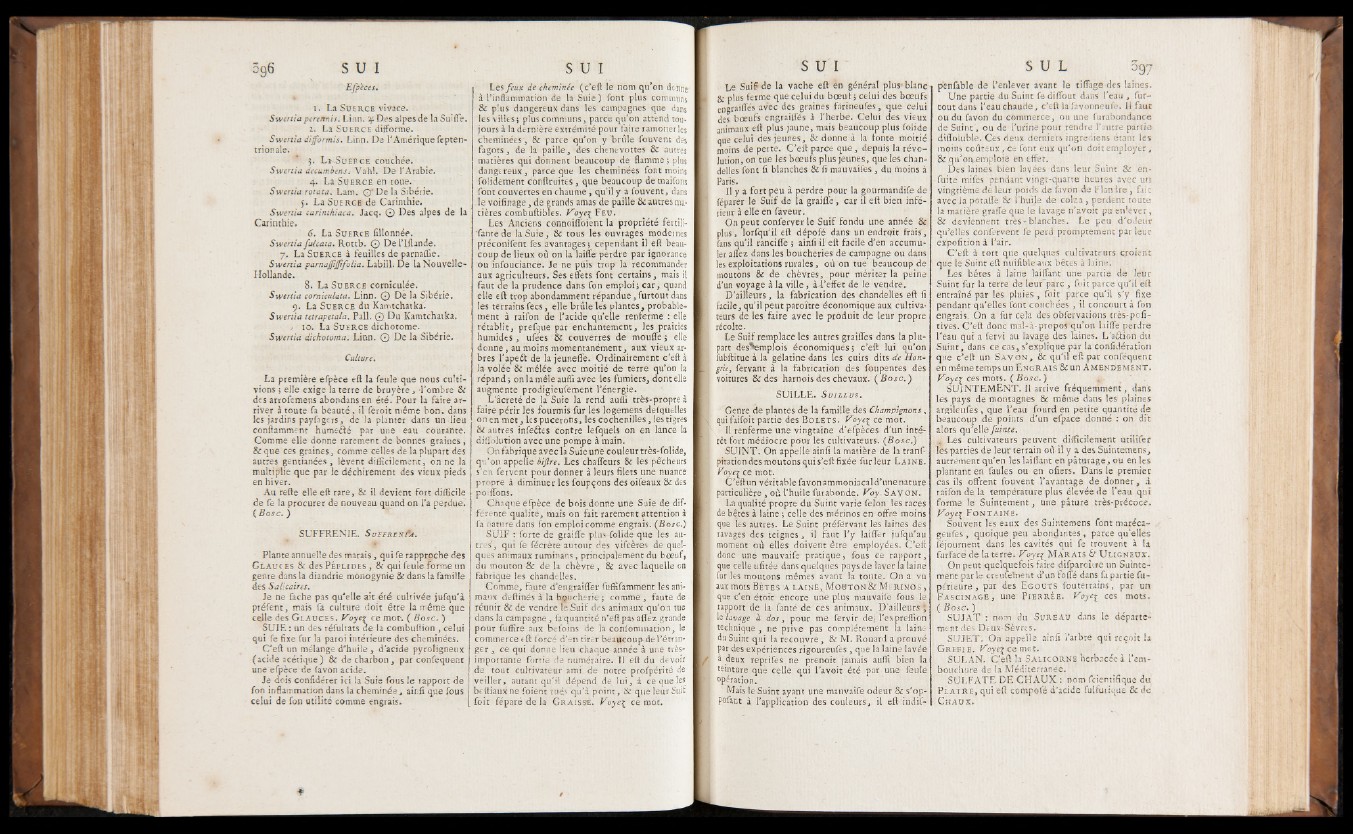
Efpeces.
i. La Suercb vivace.
Swertia persitnis. Linn. ^ Des alpes de la Suifie.
2. La Suerce difforme.
Swertia difformis. Linn. De l'Amérique fepten-
trionale.
' 3. L^Süerce couchée.
Swertia decumbens.• Vahl, De l'Arabie.
4. La Suerce en roue.
Swertia rot ata. Lam. O* De la Sibérie*
5. La Suerce de Carinihie.
Swertia carinthiaca. Jacq. O Des alpes de la
Carinthie.
6 . La Suerce lîllonnée.
Swertia fidcata. Rottb. 0 De l'iflande.
7. La Suerce à feuilles de parnaflie.
Swertia parnajfijfifolia. Labill. De la Nouvelle-
Hollande.
8. La Suerce corniculée.
Swertia corniculata. Linn. 0 De la Sibérie.
9. La Suerce du Kamtchatka.
Swertia tetrapetala. Pall. ©. Du Kamtchatka.
; 10. La Suerce dichotome.
Swertia dickotoma. Linn. O De la Sibérie.
Culture.
La première efpèce eft la feule que nous cultivions
5 elle exige la terre de bruyère, -l'ombre &
des arrofemens abondans en été. Pour la faire arriver
à toute fa beauté, il feroit même bon, dans
les jardins payfagers, de la planter dans un lieu
conftamment humeéfcé par une eau courante.
Comme elle donne rarement de bonnes graines,
& que ces graines, comme celles de la plupart des
autres gentianées, lèvent difficilement, on ne la
multiplie que par le déchirement des vieux pieds
en hiver.
Au refte elle eft rare, & il devient fort difficile
de fe la procurer de nouveau quand on l'a perdue.
( Bosc. |
SUFFRENIE. S u m m Ê t .
Plante annuelle des marais, qui fe rapprpche des
Glauces & des Pépudes , & qui feule forme un
genre dans la diandrie mônogynie & dans la famille
des Salicaires.
Je ne fâche pas qu’elle ait été cultivée jufqu'à
préfent, mais fa culture doit être la même que
celle des G lauces. Voyez ce mot-. ( Bosc. )
SUIE : un des réfultats de la combuftion , celui
qui fe fixe fur la paroi intérieure des cheminées.
C ’eft un mélange d’huile , d’acide pyroligneux
(acide acétique) & de charbon, par confequent
une efpèce de favon acide.
Je dois confidérer ici la Suie fous le rapport de
fon inflammation dans la cheminée, ainfi que fous
celui de fon utilité comme engrais.
Les feux de cheminée (c'eft le nom qu’on donne
à l'inflammation de la Suie) font plus communs
& plus dangereux dans les campagnes que dans
les villes ; plus communs, parce qu'on attend toujours
à la dernière extrémité pour faire ramoner les
cheminées', & parce qu’on y "brille -fouvent des
fagots, de la paille, des chenevottes & autres
matières qui donnent beaucoup de flamme > plus
dangereux, parce que les cheminées font moins
foüdement conftruites, que beaucoup de maifons
font couvertes en chaume, qu’il y a fouvent, dans
le voifînage, de grands amas de paille & autres matières
combuftibles. Voyez Feu.
Les Anciens connoifloient la propriété fertili-
‘fantede la Suie, & tous les ouvrages modernes
préconifent fes avantages; cependant il eft beaucoup
de lieux où on la lai(fe perdre par ignorance
ou infouciance. Je ne puis trop la recommander
aux agriculteurs. Ses effets font certains, mais il
faut de la prudence dans fon emploi; car, quand
elle eft trop abondamment répandue, furtout dans
les terrains fecs, elle brûle les plantes, probablement
à raifon de l'acide qu’elle renferme : elle
rétablit, prefque par enchantement, les prairies
humides , ufées & cou verres de mouffe 5 elle
donne, au moins momentanément, aux vieux arbres
l'apeét de la jeuneffe. Ordinairement c ’eft à
la volée & mêlée avec moitié de terre qu’on la
répand ; on la mêle auflï avec les fumiers, dont elle
augmente prodigieqfement l’énergie.
L'âcreté de la Suie la rend aufli très-propre à
faire périr les fourmis fur les logemens defqüelles
on en met, les pucerons, les cochenilles, les tigres
& autres infeétes contre lefquels on en lance la
diflblution avec une pompe à main.
On fabrique avec la Suie une couleur très-fôlide,
qu'on appelle biftre. Les chaffeurs & les pêcheurs
s’en fervent pour donner à leurs filets une nuance
propre à diminuer les foupçons des oifeaux & des
poi fions.
Chaque efpèce de bois donne une Suie de différente
qualité, mais on fait rarement attention à
fa nature dans fon emploi comme engrais. (Bosc.)
SUIF : forte de graille plus- folide que les autres',
qui fe fécrète autour des vifcères de quelques
animaux ruminans, principalement du boeuf,
du mouton & de la chèvre, & avec laquelle ou
fabrique les chandelles.
Comme, faute d'engraifler fuffifamment les animaux
deftinés à la boucherie ; comme, faute de
réunir & de vendre le Suif des animaux qu'on tue
dans la campagne, fa quantité n'eft pas a fiez grande
pour fuffire aux befoins de la contamination, le
commerce eft forcé d'en tirer beaucoup de l'étrang
e r , ce qui donne lieu chaque année à une très-
importante fortie de numéraire. 11 eft du devoir
de tout cultivateur ami de notre profpérité de
veiller, autant qu'il dépend de. lui, à ce que les
beftiauxne foient tués qu’à point, & que leur Suit
tait féparé de la Graisse. Voyei cernât.
Le Suif de la vache eft èn général plus* blanc
& plus ferme que celui du boeu f; celui des boeufs
engraiflés avec des graines fàrineufes, que celui
des boeufs engrailfés à l’herbe. Celui des vieux
animaux eft plus jaune, mais beaucoup plus folide
que celui des jeunes, & donne à la fonte moitié
moins de perte. C'eft parce que, depuis la révolution,
on tue les boeufs plus jeunes, que les chandelles
font fi blanches & fi mauvaises, du moins à
Paris.
Il y a fort peu à perdre pour la gourmandife de
féparer le Suif de la graiffe, car il eft bien inférieur
à elle en faveur.
On peut conferver le Suif fondu une année &
plus, lorfqu'il eft dépofé dans un endrqit frais,
fans qu'il rancilfe j ainfi il eft facile d’en accumuler
allez dans les boucheries de campagne ou dans
les exploitations rurales, où on tue beaucoup de
moutons & de chèvres, pour mériter la peine
d’un voyage à la v ille, àTeffet de le vendre.
D’ailleurs, la fabrication des chandelles eft fi
facile, qu’il peut paroître économique aux cultivateurs
de les. faire avec le produit de leur propre 1
récolte.
Le Suif remplace les autres graiffes dans la plupart
des’&emplois économiques; c ’eft lui qu’ on
fubftitue à la gélatine dans les cuirs dits de Hon-
grie, fervant à la fabrication des foupentes des
voitures & des harnoisdes chevaux. (B o s c .')
SUILLE. S uillüs.
Genre de plantes de la famille des Champignons,
qui faifoit partie des Bolets. Voyez ce mot.
Il renferme une vingtaine d’efpècës d’un intérêt
fort médiocre po'ur les cultivateurs. (Bosc.)
SUINT. On appelle ainfi la matière de la tranf-
piration des moutons qui s’eft fixée fur leur Laine.
Foye£ ce mot.
C ’eft un véritable favon ammoniacal d’ une nature
particulière, où l’huile furabonde,. Voy. Sa v o n .
La qualité propre du Suint varie félon les races
de bêtes à laine ; celle des mérinos en offre moins
que les autres. Le Suint préfervant les laines des
ravages des teignes, il faut l'y laitier jufqu'au
moment où elles doivent être employées. C'eft
donc une mauvaife pratique, fous ce rapport,
que celle ufitée dans quelques pays de laver la laine
fur les moutons mêmes avant la tonte. On a vu
aux mots Betes a laine. Mouton Sc Mérinos ,
que c’en étoir encore une plus mauvaitè fous le
rapport de la fanté de ces animaux. D ailleurs %
le lavage a dos, pour me fervir dej l'expreflion
technique, ne prive pas complètement la laine :
du Suint qui la recouvre, & M. Rouard a prouvé
par des expériences rigoureufes, que la laine lavée
a deux reprifes ne prenoit jamais aufli bien la
teinture que celle qui l ’avoit été par une feule
opération.
Mais le Suint ayant une mauvaife odeur & s'op-
pofant à l’application des couleurs, il eft- indifpènfable
de l’ enlever avant le tiflage des laines.
Une partie du Suint fe diflout dans l’ eau , fur-
tout dans i’eàuchaude, c’eft lafavonneufe. Il,faut
ou du favon du commerce, ou une furabondance
de Suint, ou de l’urine pour rendre l’autre partie
diffoluble. Ces deux derniers ingrédiens étant les
moins coûteux, ce font eux qu'on doit employer,
& qu’oivemploie en effet.
Des laines bien lavées dans leur Suint & en-
fuite mifes pendant vingt-quatre heures avec un
vingtième de leur poids de favon de Flan ir e , fait
avec la potafle &r l’huile de colza , perdent toute
la matière grafle que le lavage n'avoit pu-enlever,
& deviennent très-blanches. Le peu d’ odeur
qu’elles confervent fe perd promptement par leur
expofition à l'air.
C'eft à tort que quelques cultivateurs croient
que le Suint eft nuifible aux bêtes à laine.
Les bêtes à laine laiflant une partie de leur
Suint fur la terre de leur” parc , foit parce qu’ il eft
entraîné par les pluies, foit parce qu'il s'y fixe
pendant qu’elles font couchées , il concourt à fon
engrais. On a fur cela des obfervations très-pcfi-
tives. C'eft donc mal-à-propos qu'on lai fie perdre
l’eau qui a fervi au lavage des laines. L ’a&ion du
Suint, dans ce cas, s'explique par la confidération
que c'eft un Sa v o n , & qu’ il eft par confequent
en même temps un E ngrais &un Amendement.
Voyez ces mots. (B o s c .)
SUINTEMENT. Il arrive fréquemment, dans
les pays de montagnes & même dans les plaines
argileufes, que l’eau fourd en petite quantité de
beaucoup de points d’un efpace donné : on dit
alors qu’elle fuinte.
* Les cultivateurs peuvent difficilement utilîfer
lès parties de leur terrain où il y a des Suintemens,
autrement qu’en les laiflant en pâturage, ou en les
plantant en faules ou en ofiers. Dans le premier
cas ils offrent fouvent l'avantage de donner, a
raifon de la température plus élevée de l’eau qui
forme le Suintement, une pâture très-précoce.
Voye% Fontaine.
Souvent les eaux des Suintemens font maréca-
geufes, quoique peu abondantes, parce qu’elles
féjournent dans les cavités qui fe trouvent à la
furfacè de la terre. Voyez Marais & Uligneux.
On peut quelquefois faire difparoîire un Suintement
parle creufeînent d*un fotîé dans fa partie fu-
périeure, par des É g o u t s fouterrains, par un
Fascinage, une Pierrée. Voyez ces mots.
( Bosc. )
SUJAT : nom du Sureau dans le département
dès Deux-Sèvres.
SUJET. On appelle ainfi i’arbre qui reçoit la
Greffe. Voyez ce met.
SULAN. C ’eft la Salicorne herbacée à L’embouchure
de la Méditerranée.
SULFATE DE CH AU X : nom feientifique du
Plâtre , qui eft compote d’acide fulfuiique & de
Chaux..