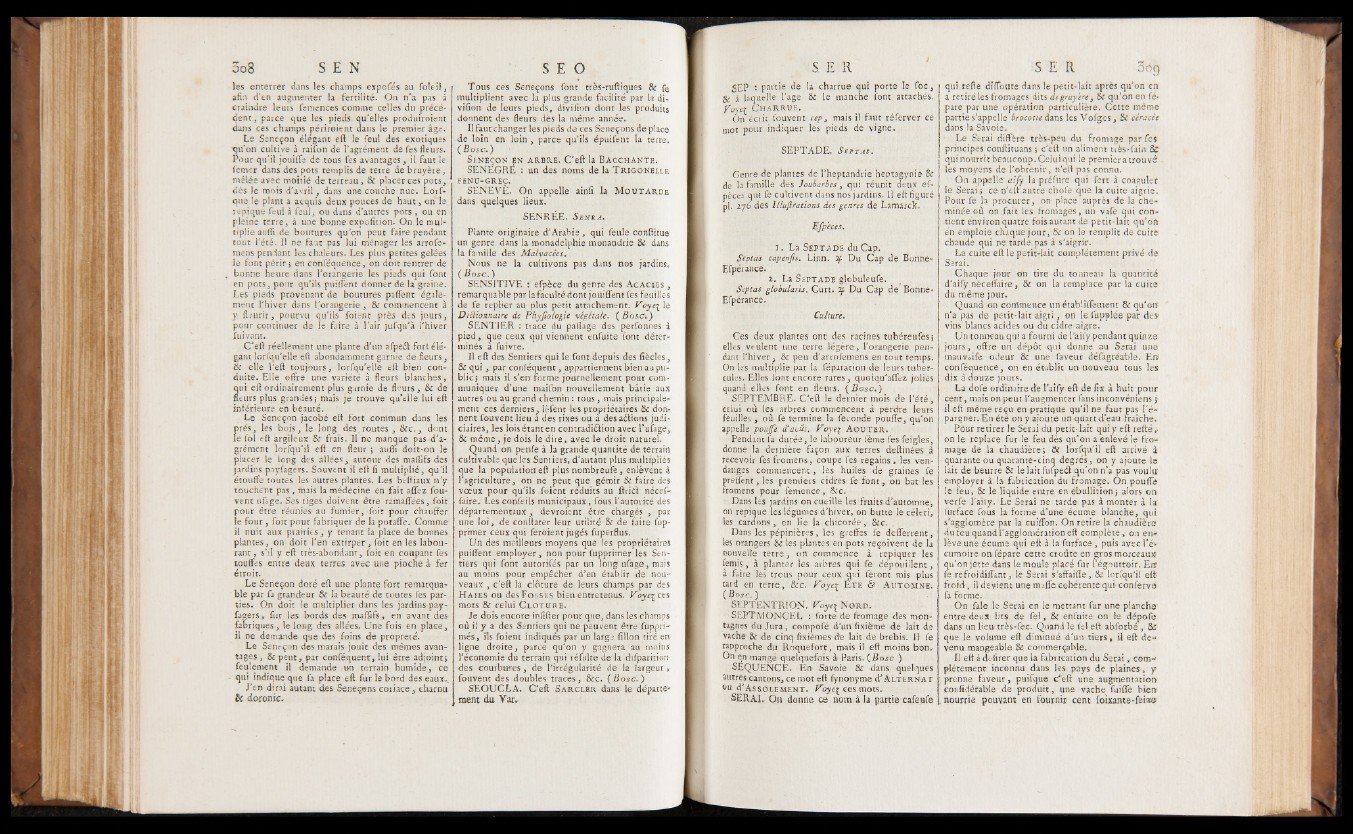
les enterrer dans les champs expo Tes au fole iî,
afin d’en augmenter la fertilité. On n’ a pas à
craindre leurs femences comme celles du précédent,
parce que les pieds qu’elles produiroient
dans ces champs périroient dans le premier âge.
Le Seneçon élégant eft le feul des exotiques
■ qu’on cultive à raifon de l’agrément de fes fleurs.
Pour qu’ il jouifie de tous fes avantages , il faut le
femer dans des pots remplis de terre de bruyère,
mêlée avec moitié de terreau, & placer ces pots,
dès le mois d’a v r il, dans une couche nue. Lorf-
que le plant a acquis deux pouces de haut, onde,
repique feul à feul, ou dans d’autres pots, ou en
pleine terre, à une bonne expofition. On le multiplie
auffi de botirures qu'on peut faire pendant
tout l’été. Il ne faut pas lui ménager les arrofe-
mens pendant les chaleurs. Les plus petites gelées
le font périr 5 en conféquence, on doit rentrer de
bonne heure dans l’orangerie les pieds qui font
en pots, pour qu’ ils puilfent donner de la graine.
Les pieds provenant de boutures paffent également
l’hiver dans l’orangerie, & commencent à
y fleurir, pourvu qu’ ils foient près des jours,
pour continuer de le faire à l ’air jufqu’ à l’hiver
fuivant.
C ’ eft réellement une plante d’ un afpeét fort élégant
lorfqu’elle eft abondamment garnie de fleurs,
& elle l'eft toujours, lorfqu’elle eft bien conduite.
Elle offre une variété à fleurs blanches,
qui eft ordinairement plus garnie de fleurs , & de
fleurs plus grandes} mais je trouve qu’elle lui eft
inferieure en beauté.
Le Seneçon jacobé eft fort commun dans les
prés, les bois, le long des,routes , & c . , dont
le fol eft argileux & frais. Il ne manque pas d’agrément
lorfqu’ il eft - en fleur ; auffi doit-on le
placer le long des allées,, autour des maffifs des
jardins payfagers. Souvent il eft fi multiplié, qu’il
étouffe toutes les autres plantes. Les beftiaux n’y
touchent pas , mais la médecine en fait aflfez fou-
vent ufage. Ses tiges doivent être ramaffées, foit.
pour être réunies au fumier, foit pour chauffer
le fou r , foit pour fabriquer de la potafle. Comme
il nuit aux prairies,'y tenant la place de bonnes
plantes, on doit l’en extirper, foit en les labourant
, s’il y eft très-abondant> foit en coupant fes
touffes entre deux terres avec une pioche à fer
étroit.
Le Seneçon doré eft une plante fort remarquable
par fa grandeur & la beauté de toutes fes parties.
On doit le multiplier dans les jardins payfagers,
fur les bords des maffifs, en avant des
fabriques, le long des allées. Une fois en place,
il ne demande que des foins de propreté.
Le Seneçon des marais jouit des mêmes avantages
, & peut, par conféquenr, lui être adjoint}
feulement il demande un terrain humide, ce
qui indique que fa place eft fur le bord des eaux..
J’en dirai autant des Séneçons coriace , charnu
& doronxc.
Tous ces Séneçons font très-ruftiques & fe
multiplient avec la plus grande facilité par la di-
vifion de leurs pieds, divifion dont les produits
donnent des fleurs dès la même année.
II faut changer les pieds de ces Séneçons de place
de loin en lo in , parce qu’ ils épuifent la terre.
( Bosc. )
S eneçon en.a r b r e . C ’ eft la Ba c ch a n t e .
SENEGRÉ : un des noms de la T rigonelle
FENU-GREÇ.
SENEVE. On appelle ainfi la Mo u ta rd e
dans quelques lieux.
SENRÉE. Sekb-a.
Plante originaire d’Arabie, qui feule conftitue
un genre dans la monadelphie monandrie & dans
la famille des Malvacées.
Nous ne la cultivons pas dans nos jardins.
( Bosc. )
SENSITIVE : efpèce du genre des A cacies ,
remarquable par la faculté dont jouiffent fes feuilles
de fe replier au plus petit attachement. Foye{ le
Dictionnaire de Phyjîologie végétale. ( Bosc*}
SENTIER : trace du paflage des pecfonnes à
pied, que ceux qui viennent enfuite font déterminés
à fuivre.
Il eft des Sentiers qui le font depuis des fïècles,
& q u ip a r conféquent, appartiennent bien au public}
mais il s’en forme journellement pour communiquer
d’une maifon nouvellement bâtie aux
autres ou au grand chemin : tous, mais principalement
ces derniers, lèfent les propriétaires & donnent
fouvent lieu à des rixes ou à des aétions judiciaires,
les lois étant en contradiction avec l’ ufage,
& même, je dois le dire, avec le droit naturel.
Quand on penfe à la grande quantité de terrain
cultivable que les Sentiers, d’autant plus multipliés
que la population eft plus nombreufe, enlèvent à
l'agriculture, on ne peut que gémir & faire des
voeux pour qu’ ils -foient réduits au ftrièl nécef-
faire. Les confeils municipaux, fous l’autorité des
départementaux, devroiem être chargés , par
une lo i, de eonftater leur utilité & de faire fup-
primer ceux qui feroient jugés fuperftus.
Un des meilleurs moyens que les propriétaires
puilfent em p lo y e rn o n pour fupprimer les Sentiers
qui font autorifés par un long ufage, mais
au moins pour empêcher d’ en établir de nouveaux
, c ’eft la clôture de leurs champs par des
H aie s ou des Fossés bien entretenus. Foye^ce s
mots & celui C lô tu r e .
Je dois encore infifter pour que, dans les champs
où il y a des Sentiers qui ne peuvent être fuppri-
més, ils foient indiqués par un large fillon tiré en
ligne droite, parce qu’on y gagnera au moins
l’économie du terrain qui réfulte de-la difparition
des courbures, de l'irrégularité de la largeur,
fouvent des doubles traces, & c . (B o s c ,)
SEOUCLA, C ’eft Sarcler dans le département
du Var.-
SEP : partie de la charrue qui porte le fo c ,
& à laquelle l’age & le manche font, attachés.
Voye\ C h a r r u e ,.
On écrit fouvent cep, mais il faut réfer ver ce
mot pour indiquer les pieds de vigne.
SEPTADE. S e p t a s .
Genre de plantes de l’heptandrie heptagynie &
de la famille des Joubarbes, qui réunit deux espèces
qui fe cultivent dans nos jardins. Il eft figuré
pl. 276 des Illustrations des genres de Lamarck.
Efpéces,
1. La Septaue du Cap.
Septas capenfis. Linn. y Du Cap de Bonne-
Efpérance.
1. La S f.p tad e globuleufe.
Septas globularis. Curt. Tf. Du Cap de Bonne-
Efpérance.
Culture.
Ces deux plantes ont des racines tubéreufes}
elles veulent une terre légère, l’orangerie pendant
l’h iv e r , & peu d’ arrofemens en tout temps.
On les multiplie par la réparation de leurs tubercules.
Elles font encore rares, quoiqu’ affez jolies
quand elles font en fleurs. (B o s c .)
SEPTEMBRE. C ’ eft le dernier mois de l’é té ,
celui où les arbres commencent à perdre leurs
feuilles, où fe termine la fécondé pouffe, qu’on
appelle poujfe d'août. Voye$ AOUTER.
Pendant fa durée, le laboureur fème fes feigles,
donne la dernière façon aux terrés deftinées à
recevoir fesfromens, coupe fes regains, les vendanges
commencent, les huiles de graines fe
preflent, les premiers cidres fe fo n t, on bat les
iromens pour femence, &rc.
Dans les jardins on cueille les fruits d’automne,
on repique les légumes d’hiver, on butte le céleri,
les cardons , on lie la c h ic o r é e & c .
Dans les pépinières, les greffes fe defferrent,
les orangers bc les plantes en pots reçoivent de la
nouvelle terre, on commence à repiquer les
femis, à planter les arbres qui fe dépouillent,
à faire les trous pour ceux qui feront mis plus
fard en terre, &c. Foyer Été & Automne.
( Bosc. )
SEPTENTRION. Foye^ No r d .
SEPTMONCEL t forte de fromage des' montagnes
du Jura, compofé d'un fixième de lait de
vache & de cinq fixièmes de lait de brebis. 11 fe
rapproche du Roquefort, mais il eft moins bon.
On en mangé quelquefois à Paris. (Bosc. )
SÉQUENCE. En Savoie & dans quelques
autres cantons, ce mot eft fynonyme d’ A l t e r n a t
©u d’ A s s o l e m e n t . Foye% ces mots.
SERAI. On donne ce nom à la partie cafeufe
qui refie di {Toute dans le petit-lait après qu’on en
a retiré les fromages dits de gruyère, & qu’on en fé-
pare par une opération particulière. Cette même
partie s’appelle brocotte dans les V o fg e s , & céracée
dans la Savoie.
Le Serai diffère très-peu du fromage par fes
principes conftituans 5 c’eft un aliment très-fain &
qui nourrit beaucoup. Celui qui le premier a trouvé .
les moyens de l’obtenir, n’eft pas connu.
On appelle aify la préfure qui fert à coagulet
le Serai} ce tj’eft autre chofe que la cuite aigrie.
Pour fe la procurer, on- place auprès de la cheminée
où on/ait les fromages, un vafe qui contient
environ quatre fois autant de petit-lait qu’on
en emploie chaque jour, & on le remplit de cuite
chaude qui ne tarde pas à s’aigrir.
La cuite eft le petit-lait complètement privé de
Serai.
Chaque jour on tire du tonneau la quantité
d’aify néceffaire, & on la remplace par la cuite
du même jour.
Quand on commence un établiflement & qu’on?
n’a pas de petit-lait aigri, on le fupplée par desvins
blancs acides ou du cidre aigre.
Un tonneau qui a fourni de l'aify pendant quinze
jours, offre un dépôt qui donne au Serai une
mauvaife odeur & une faveur défagréable. En
conféquence, on en établit un nouveau tous les
dix à douze jours.
La dofe ordinaire de l’aify eft de ftx à huit pour
cent, mais on peut l’augmenter fans ineonvéniens}'
il eft même reçu en pratique qu’il ne faut pas l’é pargner.
En été on y ajoute un quart d’eau fraîche.
Pôur retirer le Serai du petit-lait qui y eft reftéy
on le replace fur le feu dès qu’on a enlevé le fromage
de la chaudières & lorfqu’ il eft arrivé à
quarante ou quarante-cinq degrés , on y ajoute le
lait de beurre & le lait fufpeél qu’on n’a pas voulu'
employer à la fabrication du fromage. On pouffe
le feu, & le liquide entre en ébullition} alors on
vetfe l’aiiy. Le Serai ne tarde pas à monter à la
furface fous la forme d’une écume blanche, qui
s’agglomère par la euiffon. On retire la chaudière
du feu quand T agglomération eft complète, oh enlève
une écume qui eft à la furface, puis avec l’écumoire
ouTépare cette croûte en gros morceaux
qu’on jette dans le moule placé fur l’égouttoir. Eiï
fe refroidiffant, le Serai s’affaiffe, & lorfqu'il eft
froid, il devient une maffe cohérente qui conferve
fa forme.
On fale le Serai en le mettant fur une planche-
entre deux lits de f e l , & enfuite on le dépofe
dans un lieu très-fee. Quand le fel eft abforbé , &'
que le volume eft diminué d'un tiers , il eft devenu
mangeable & commerçable.
Il eft à defirer que la fabrication du S e r a ic om plètement
inconnu dans les pays de plaines, y
prenne faveur, puifque c’eft une augmentation
confîdérable de produit, une vache fuifle bien
nourrie pouvant en fournir cent foixante-feia©