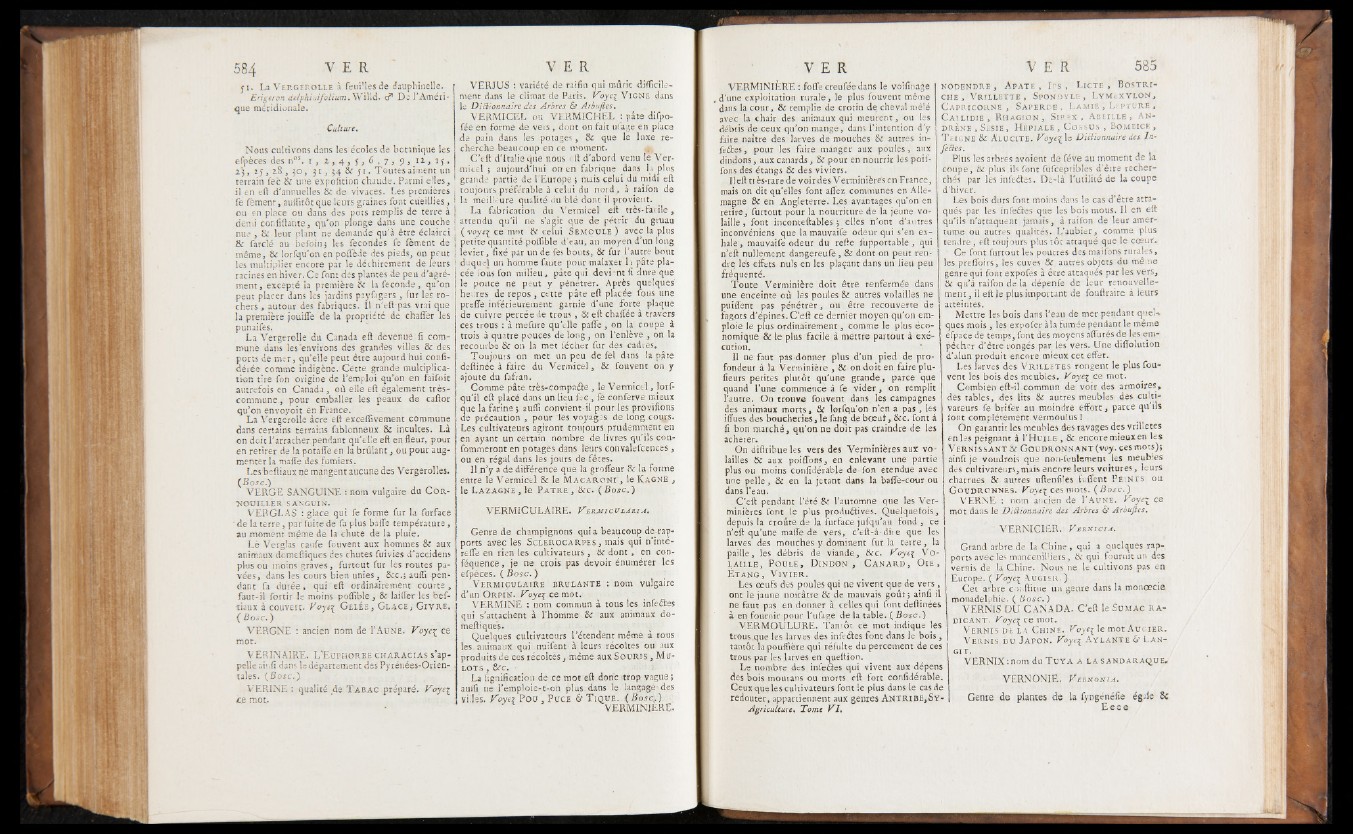
y i. La V ergerolle à feuilles de dauphin elle.
Eriger on delphiuifoliurn. Wil’ld. C71 De l’Amérique
méridionale.
Culture.
Nous cultivons dans les écoles de botanique les
efpèces des nos. i , 2 , 4 , y , 6 , 7 j t o i 2. 14,
23, 25, 28 , 30, 31 j 34 & 51. Toutes aiment un
terrain fec & une expofition chaude. Parmi elles,
il en eft d'annuelles & de vivaces. Les premières
fe fèmenr, a u fli t ô t que leurs graines font cueillies,
ou en place ou dans des pots remplis de terre à
demi confinante, qu'on plonge dans une couche
n u e , & leur plant ne demande qu'à être éclairci
& fardé au befoin j les fécondés fe fèrr.ent de
même, 8c lorfqu'on en poffède des pieds, on peut
les multiplier encore par le déchirement de leurs
racines en hiver. Ce font des plantes de peu d'agrément
, excepté la première 8c la fécondé, qu’on
peut placer dans les jardins payfagers , fur les rochers
, autour des fabriques. Il n'eftpas vrai que
la première jouiffe de la propriété de chaffer les
punaifes.
La Vergerolle du Canada eft devenue fi commune
dans les‘environs des grandes villes & des
ports de mer, qu'elle peut être aujourd hui confi-
dérée comme indigène. Cette grande multiplication
tire fon origine de l'emploi qu’on en faifoit
autrefois en Canada, où elle eft également très-
commune., pour emballer les peaux de caftor
qu’on envoyoit en France.
La Vergerolle âcre eft exceflivement commune
dans certains terrains fablonneux & incultes. Là
on doit l'arracher pendant qu'elle eft en fleur, pour
en retirer de la potaffe en la brûlant, ou pour augmenter
la maffe des fumiers.
Les beftiaux ne mangent aucune des Vergerolles.
( B o sc .)
VERG E SANGUINE : nom vulgaire du C o r n
ou il le r san g uin .
VERGLAS : glace qui fe forme fur la furface
■ de la terre, par fuite de fa plus baffe température,
au moment même de la chute de la pluie.
Lè Verglas caufe feuvent aux hommes 8c aux
animaux domefliques des chutes fui vies d'aceidens
plus ou moins graves, furtcut fur les routes pavées,
dans les cours bien unies, 8c.c.; aufli pendant
fa durée, qui eft ordinairement courte,
faut-il for tir le moins poffible, 8c laiffer les beftiaux
à couvert. Voye[ G elée, Gl a c e , Giv r e .
( Bosc. )
VERGNE : ancien nom de I’A u n e . Voy*^ ce
mot.
VERIN AIRE. L ’Euphorbe c h a r a c ia s s’appelle
aii.fi dans le département des Pyrénées-Orientales.
{B o s c .)
VERINE : qualité de T a b a c préparé. Voye\
c& mot.
VERJUS : variété de raifin qui mûrit difficilement
dans le climat de Paris. Voye1 V igne dans
le Diftionnaire des Arbres & Arbujles.
VERMICEL ou VERMICHEL : pâte difpo-
fée en forme de v ê ts , dont on fait ufage en place
de pain dans les potages, 8c que le luxe recherche
beaucoup en ce moment.
C'eft d'Italie que nous eft d’abord venu le V e r micel
i aujourd'hui on en fabrique dans la pins
grande partie de l ’Europe ; mais celui du midi eft
toujours préférable à celui du nord, à raifon de
la meilleure qualité du blé dont il provient.
La fabrication du Vermicel eft très-facile,
attendu qu’il ne s’agit que de pétrir du gruau
.( voyei ce mot 8c celui Semoule ) avec la plus
petite quantité poffible d’eau, au moyen, d’un long
levier, fixé par un de fes bouts, 8c fur l’ autre bout
duquel un homme faute pour malaxer l i pâte placée
fous fon milieu, pâte qui devient fi dure que
le pouce ne peut y pénétrer. Après quelques
heures de repos , cette pâte eft placée fous une
preffe inférieurement garnie d’ une forte plaque
de cuivre percée de trous, & eft chaffée à travers
ces trous : à mefure quelle pafte, on la coupe à
trois à quatre pouces de long, on l’enlève , an la
recourbe 8c on la met fécher fur des cadres.
Toujours on met un peu de fel dans la p,âte
deftinée à faire du Vermicel, 8c fouvent on y
ajoute du fafran.
Comme pâte très-compa&e , le Vermicel, lorf-
qu’il eft placé dans un lieu f e c , fe conferve mieux
que la farine 5 aufli convient-il pour les provifions
ae précaution , pour les voyages de long coqp.
Les cultivateurs agiront toujours prudemment en
en ayant un certain nombre de livres qu’ils con-
fommeront en potages dans leurs convalefcences,
ou en régal dans les jours de fêtes.
I l j i ’y a de différence que la groffeur 8c la forme
entre le Vermicel 8c le Ma c a r o n i ', le Kagne ,
le L a z a g n e , le Pâ t r e , 8cc. ( B o s c .)
VERMICULAIRE. V ermicularia.
Genre de champignons qui a beaucoup de-rapports
avec les Sc l e r o c a r p e s , mais qui n’ inté-
reffe en rien les cultivateurs , 8c d o n t, en con-
féquence, je ne crois pas devoir énumérer les
efpèces. ( Bore. )
V e rm içu l a ir e b rû lan t e : nom vulgaire
d’ un Or pin . Voyeç ce mot. v
VERMINE : nom commun à tous les infe&es
qui s'attachent à l'homme 8c aux animaux do-
meftiques.
Quelques cultivateurs l ’étendent même à tous
les. animaux qui nuifent à leurs récoltes ou aux
produits de ces récoltes, même aux Souris , M ulo
ts , 8cc. -
La lignification de ce mot eft donc 'trop vague ;
aufli ne l’emploie-t-on plus dans le langagé des
yijles. Voyez Pqu , Puce & T ique. ( B osc[.)
VERMINIERE..
VERMINIÈRE : foffe creufée dans le voifinage
d’une exploitation rurale, le plus fouvent même
dans la cour, 8c remplie de crotin de cheval mêlé
avec la chair des animaux qui meurent, ou les
débris de ceux qu’on mange, dans l’intention d’y
faire naître des larves de mouches 8c autres in-
fedtes, pour les faire manger aux poules, aux
dindons, aux canards, 8c pour en nourrir les poif-
fons des étangs 8c des viviers,
. Il eft très-rare de voir des Verminières en France,
mais on dit qu’elles font affez communes en Allemagne
8c en Angleterre. Les avantages qu’on en
retire, furtout pour la nourriture de la jeune volaille
, font inconteftables 5 elles n’ont d’autres
inconvéniens que la mauvaife odeur qui s’en exhale,
mauvaife odeur du refte fupportable, qui
n’eft nullement dangereufe, 8c dont on peut rendre
le's effets nuis en les plaçant dans un lieu peu
fréquenté.
Toute Verminière doit être renfermée dans
une enceinte où les poules 8c autres volailles ne
puiflènt pas pénétrer, ou être recouverte de
fagots d’épines. C ’eft ce dernier moyen qu’on emploie
le plus ordinairement, comme le plus économique
8c le plus facile à mettre partout à exécution.
Il ne faut pas donner plus d’ un pied de profondeur
à la Verminière , 8c on doit en faire plu-
fieurs petites plutôt qu’une grande, parce que
quand l’une commence à fe v id e r , on remplit
l’autre. On trouve fouvent dans les campagnes
des animaux morts, 8c lorfqu’on n’en a pas , les
iffues des boucheries, le fang de boe u f, 8cc. font à
fi bon marché, qu’on ne doit pas craindre de les
acheter.
On diftribue les vers des Verminières aux vo lailles
8c aux poiffons, en enlevant une partie
plus ou moins confidérable de fon étendue avec
une pelle, 8c en la jetant dans la baffe-cour ou
dans l’eau.
C'eft pendant l’été 8c l’automne que les Verminières
font le plus productives. Quelquefois,
depuis la croûte de la furface jufqu’au fond , ce
n’eft qu’une maffe de vers, c’eft-à-diie que les
larves des mouches y dominent fur la terre, la
paille, les débris de viande, 8cc. Voye{ V ol
a il l e , Po u l e , Din d o n , C a n a r d , Oi e ,
Ét a n g , V iv ie r .
Les oeufs des poules qui ne vivent que de vers ,
ont le jaune noirâtre 8c de mauvais goût} ainfi il
fie faut pas en donner à celles qui font deftinées
à en fournir pour l’ ufage de la table. (B o s c .)
VERMOULURE. Tamôt ce mot indique les
trous .que les larves des infeCtes font dans le bois,
tantôt la pouflîère qui réfulte du percement de ces j
trous par les larves en queftion.
Le nombre des infectes qui vivent aux dépens
des bois moutans ou morts eft fort confidérable.
Ceux que les cultivateurs font le plus dans le cas de
redouter, appartiennent aux genres A n t r ib e ,S y -
Agriculture, Tome VI.
NODENDRE , A PATE , 1rs , LlCTE , BOSTRI-
CHE , VRILLETTE , SPONDYLE, LYMcXYLON,
C a pr ico rn e , Sa perd e , L am ie , L epture ,
C a i .lidie , Rh a g io n , Sir ex , A b e il l e , An-
drène , Se s ie , Hé p ia l e , C os sus , Bom b ic e ,
T eigne 8c A lu c it e . V o y e ^ lû Diftionnaire des In-
feftes. . ‘ ‘ ' " .
Plus les arbres avoient de fève au moment de la
coupe, 8c plus ils font fufceptibles d’être recherchés
par les infeCtes. De-là l ’utilité de la coupe
d’hiver.
Les bois durs font moins dans le cas d’ être attaqués
par les infeCtes que les bois mous. Il en eft
qu’ ils n’attaquent jamais, à raifon de leur amertume
ou autres qualités. L’aubier, comme plus
tendre, eft toujours plus tôt attaqué que le coeur.
' Ce font furtout les poutres des maifons rurales,
les preffoirs, les cuves 8c autres objets du même
genre qui fontexpofes à être attaqués par les vers,
8c qu’ à raifon de la dépenfe de leur renouvellement
, il eft le plus important de fouftraire à leurs
atteintes.
Mettre les bois dans l’eau de mer pendant quel-,
ques mois , les expofer à la fumée pendant le même
efpace de temps, font des moyens affurés de les empêcher
d’ être rongés par les vers. Une diffolution
d’alun produit encore mieux cet effet.
Les larves des V r ille te s rongent le plus fouvent
les bois des meubles. Voye% ce mot.
Combien eft-il commun de voir des armoires,
des tables, des lits 8c autres meubles des cultivateurs
fe brifer au moindre effort, parce qu’ ils
font complètement vermoulus !
On garantit les meubles des ravages des vrilletes
en les peignant à I’Huile , 8c encore mieux en les
V e r n is san t & Gou d r o n n an t {voy. ces mots);
ainfi je voudrois que non-feulement les meubles
des cultivateurs, mais encore leurs voitures, leurs
charrues 8c autres uftenfi-es fuffent Peints ou
G ou d ron né s . Voyei ces mots. (B o s c .)
VERNE : nom ancien de I’Au ne. Voyei ce
mot dans le Diftionnaire des Arbres & Arbujles.
VERNICIER. V e r n i c i a .
Grand arbre.de la Chine, qui a quelques rapports
avec les mancenil'iers, 8c qui fournit un des
vernis de la Chine. Nous ne le cultivons pas en
Europe. ( Voye[ Augier. )
Cet arbre conftitue un genre dans la monoecie
monadelphie. ( Bosc. )
VERNIS DU CAN AD A . C ’eft le Sum a c r a -
DICANT. Voye% ce mot.
V ernis de la C hine. Voye* le mot A u g ie r .
V ernis du Ja p o n . Voye{ A y l a n t e 6* La n -
g it .
VERNIX-.nom du T u y A a l a s a n d a r a q u e *
VERNONIE. V e r n o n i a .
Genre de plantes de la fyngénéfie égale &
E e e e