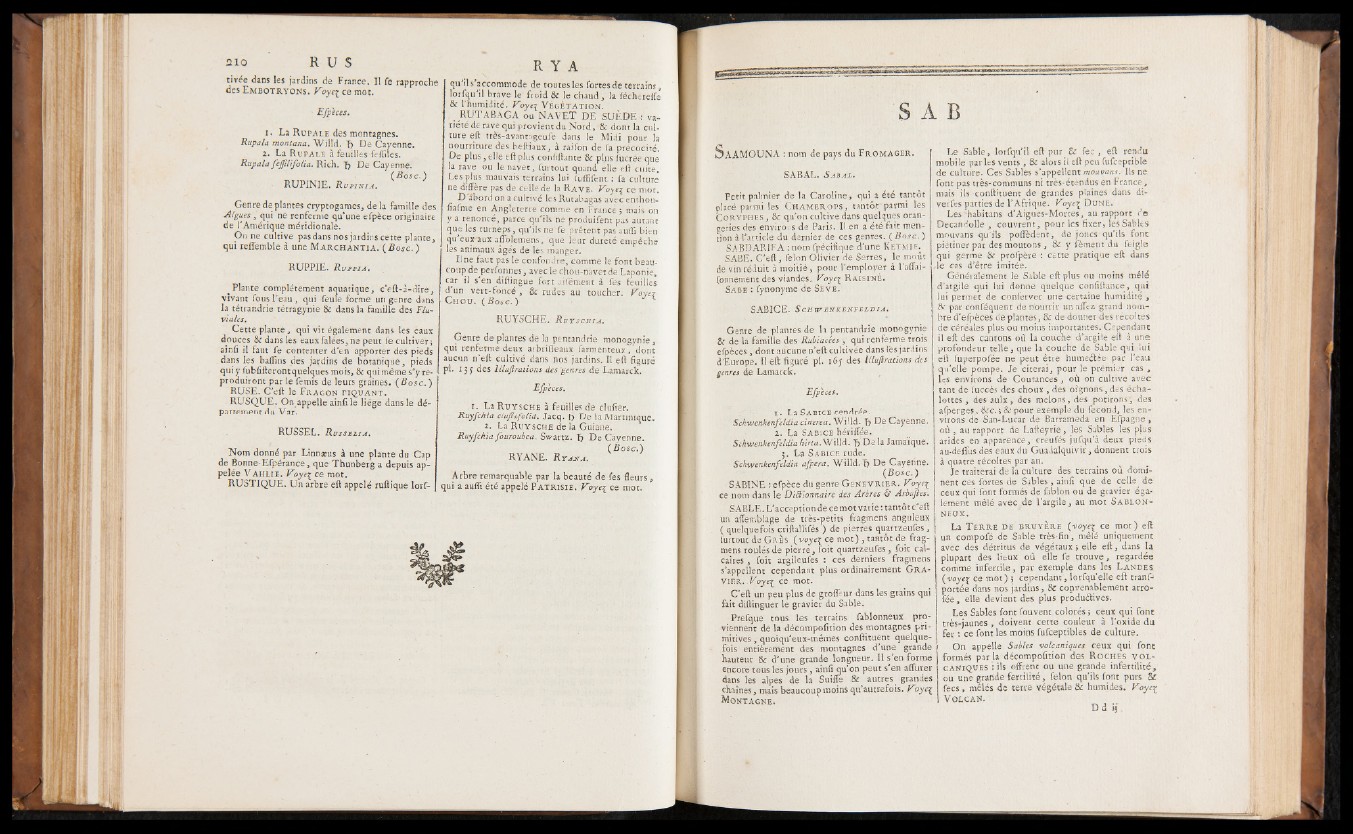
2 1 0 R U S
tivée dans les jardins de France. Il fe rapproche
des Embotryons. Wajjm ce mot.
Efpeces.
1. La Rupale des montagnes.
Rupala montana. Willd. f) De Cayennè.
2. La R upale à feuilles (effiles.
Rupala fejfilifotia. Rich. De Cayenne.
(B o s c .)
RUPJNIE. R u p in ia .
Genre de plantes cryptogames, delà famille des
Algues, qui ne renferme qu’une efpèce originaire
de l’Amérique méridionale.
On ne cultive pas dans nos jardins cette plante,
qui reffemble à une March antia. ( B o s c .)
RUPPIE. R up p ia .
Plante complètement aquatique, c*eft-â-dire,
vivant fous l ’eau , qui feule forme un genre dans
la tétrandrie tétragynie & dans la famille des Fluviales.
Cette plante, qui vit également dans les èaux
douces & dans les eauxfalées, ne peut fe cultiver j
ainfi il faut fe contenter d’en apporter des pieds
dans les baffins des jardins de botanique, pieds
qui y fubfifterontquelques mois, & qui même s’y reproduiront
par le femis de leurs graines, (B o s c .)
RUSE. C ’eft le Fragon piquant.
RUSQUE. On appelle ainfi le liège dans le département
du Var.
RUSSEL. R us se z ia.
Nom donné par Linnæus à une plante du Cap
de Bonne-Efpérance, que Thunberg a depuis appelée
V a.h l i i. Voye% ce mot.
RUSTIQUE. Un arbre eft appelé ruftique lorf-
R Y A
qu’il s’accommode de toutes les fortes de terrains,
lorsqu'il brave le froid & le chaud , la féchereffe
& l’humidité, Voye^ VÉGÉTATION.
RUTABAGA ou N A V E T DE SUÈDE< variété
de rave qui provient du Nord, & dont la culture
eft très-avantngeufe dans le Midi pour la
nourriture des beftiaux, à raifon de fa précocité.
De plus, elle eft plus confiftante & plus fucrée que
la rave ou le navet, furtout quand elle eft cuite.
Les plus mauvais terrains lui luffifent. : fa culture
ne différé pas de celle de la Ra v e . Voye^ ce mot.
D abord on a cultivé les Rutabagas avec enthou-
fîafme en Angleterre comme en France> mais on
y a renoncé, parce qu’ ils ne produifent pas autant
que les turneps, qu’ils ne fe prêtent pas auffi bien
qu eux aux affolemens, que leur dureté empêche
les animaux âgés de les manger.
Une faut pas le confondre, comme le font beaucoup
de personnes, avec le chou-navet de Laponie,
car il, s’en diftingue fort aifément à fês feuilles
d un vert-foncé, & rudes au toucher. Voyez
C hou. ( B osc. ) 1
RUYSCHE. R u y s ch ia .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie,
qui renferme deux arbrifleaux farmenteux, dont
aucun n’eft cultivé dans nos jardins. Il eft figuré
pl. 135 des llluftrations des'genres de Lamarck.
Efpeces.
.1. La Ruysche à feuilles de clufier.
Ruyfchia clufi&folia. Jacq.D De la Martinique.
2. La Ruysche de la Guiane'.
Ruyfchia fouroubea. Swartz. De Cayenne.
(B o s c .)
R Y ANE. R y a n a .
Arbre remarquable par la beauté de fes fleurs,
qui a auffi été appelé Patrisie. Voye^ ce mot.
S a AMOUNA : nom de pays du Fromager.
SABAL. S a b a l .
Petit palmier de la Caroline, qui a été tantôt
placé parmi les Chamerops, tantôt'parmi les
Coryphes , & qu’on cultive dans quelques orangeries
des environs de Paris. Il en a été fait mention
à l’article du dernier de ces genres. (B o s c .)
SABDARIFA : nom fpécifique d’une Ketmie.
SABE. C ’eft, félon Olivier de Serres, le moût
de vin réduit à moitié, pour l’employer à l'affai-
fonnement des viandes. Voye£ Raisiné.
Sabe : fynon-yme de Sève.
SABICE. S CH W ENKENFELDIA.
Genre de plantes de h pentandrie monogynie
& de la famille des Rubiacées; qui renferme trois
efpeces, dont aucune n’ eft cultivée dans l'es jardins
d’Europe. Il eft figuré pl. i6y des llluftrations des
genres de Lamarck.
Efpeces.
1. La Sabice cendrée.
Schwenkenfeldia cinerea. Willd. fj De Cayenne.
2. La Sabice hériffée.
Schwenkenfeldiahirta. Willd. fj Delà Jamaïque.
3. La Sabice rude.
Schwenkenfeldia afpera. Willd. I? De Cayenne.
- - (B o s c .)
SABINE : efpèce du genre G enevrier. Voye%
ce nom dans le DiHionnaire des Arbres & Arbuftes.
SABLE. L’ acception de ce mot varie : tantôt c’eft
un affemblage de très-petits fragmens anguleux
( quelquefois criftallifés ) de pierres quartzeufes,
furtout de Grès ( voye\ ce mot) , tantôt de frag-
mens roulés de pierre, foit quartzeufes, foit calcaires
, foit argileufes : ces derniers fragmens
s’appellent cependant plus ordinairement Gr a vier.
. Voye% ce mot.
C ’eft un peu plus de groffie ur dans les grains qui
fait diftinguer le gravier du Sable.
Prefque tous les terrains fablonneux pro-
, viennent de la décompofition des montagnes primitives
, quoiqu’eux-mêmes conftituent quelquefois
entièrement des montagnes d’ une grande
Le Sable, lorfqu’ il eft pur & fec , eft rendu
mobile parles vents , & alors il eft peu Cufceptible
de culture. Ces Sables s’appellent mouvans. Ils ne
font pas très-communs ni très-étendus en France,
mais ils conftituent de grandes plaines dans di-
verfes parties de l’Afrique. Voye\ Dune.
L e sNhabitans d’Aigues-Mortes, au rapport de
Decandolle , couvrent, pour les fixer, les Sables
mouvans qu'ils poffèdent, de joncs qu’ils font
piétiner par des moutons , & y fèment du feigle
qui germe & profpère : cette pratique eft dans
de cas d’êrre imitée.
hauteur & d’ une grande longueur. Il s’en forme
encore tous les jours, ainfi qu’on peut s’ en affûter
dans les alpes de la Suiffe & autres grandes
chaînes, mais beaucoup moins qu’ autrefois. Voye\
Montagne.
Généralement le Sable eft plus ou moins mêlé
d’argile qui lui donne quelque confiftance, qui
lui permet de conferver une certaine humidité ,
& par conféquent de nourrir un affez grand nombre
d’efpèces de plantes, & de donner des récoltes
de céréales plus ou moins importantes. Cependant
il eft des cantons oii la couche d’argile eft 2 une
profondeur telle, que la couche de Sable qui. lui
eft fuperpofée ne peut être humeétée par l’eau
qu’elle pompe. Je citerai, pour le prémier cas ,
les environs de Cou t a n c e s o ù on cultive avec
tant de fuccès des choux , des oignons, des écha-
lottes, des aulx, des melons, des .potirons; des
afperges, &c. j & pour exemple du fécond, les environs
de San-Lucar de Barrameda en Efpagne,
o ù , au rapport de Lafteyrie, lés Sables les plus
arides en apparence, creufés jufqu’à deux pieds
au-deffus des eaux du Guadalquivir, donnent trois
à quatre récoltes par an.
Je traiterai de la culture des terrains où dominent
ces fortes de Sables, ainfi que de celle de
ceux qui font formés de fablon ou de gravier également
mêlé avec de l’argile, au mot Sablonneux.
La T erre de bruyère (voye^ ce mot) eft
un compofé de Sable très-fin, mêlé uniquement
avec des détritus de végétaux > elle eft, dans la
plupart des lieux où elle fe trouve, regardée
comme infertile, par exemple dans les Landes
( voyei ce mot) } cependant , lorfqu’elte eft tranfe
portée dans nos jardins, & convenablement arro-
fé e , elle devient des plus produ&ives.
Les Sables font fouvent colorés ; ceux qui font
très-jaunes, doivent cette couleur à l ’oxide du
fer : ce font les moins fufceptibles de culture.
On appelle Sables volcaniques ceux qui font
formés parla décompofition des R oches v o l caniques
: ils offrent ou une grande infertilité,
ou une grande fertilité, félon qu’ils font purs &
fe c s , mêlés de terre végétale & humides. Voye%
V olcan.
D d i f .