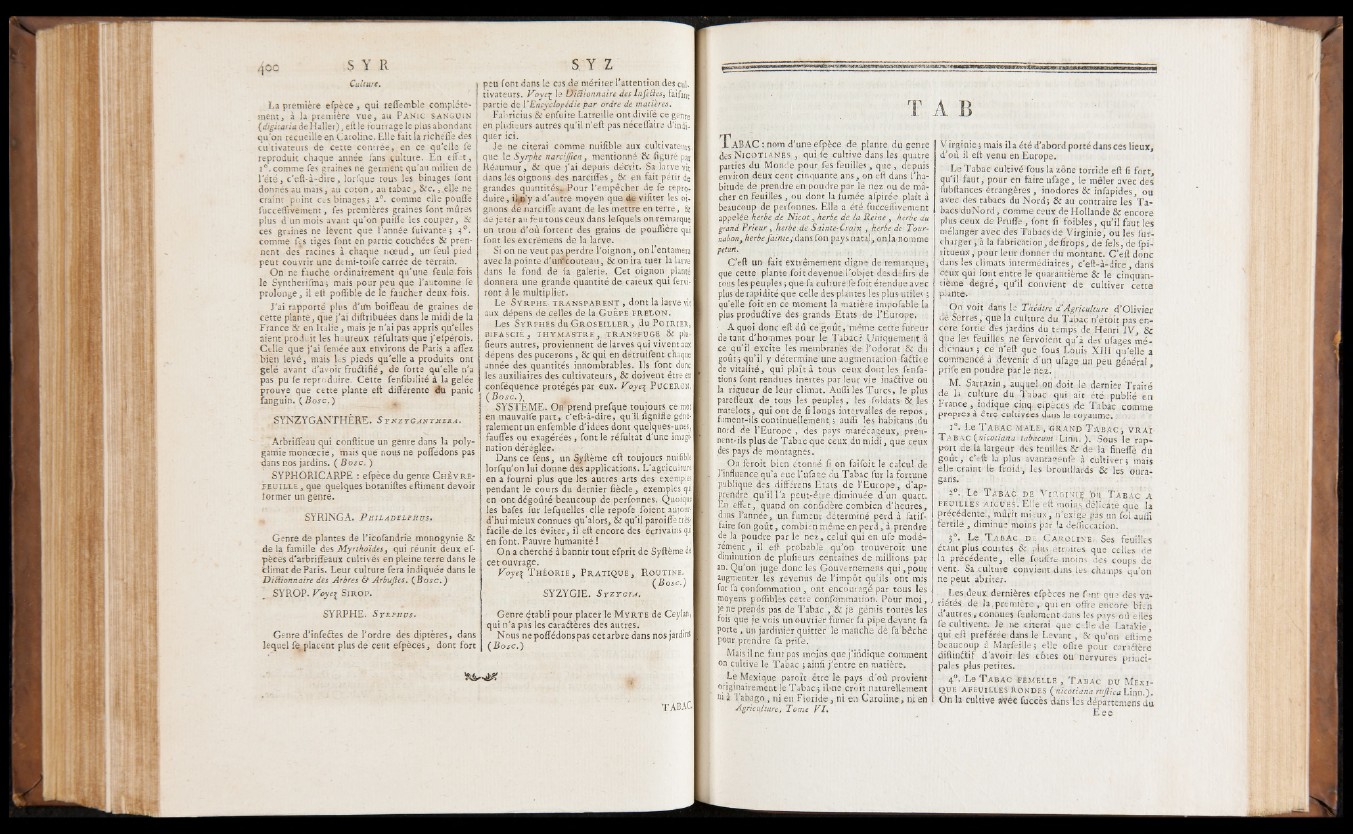
S Y R
Culture.
La première efpèce , qui refiemble complètement,
à la première vue, au Panic sanguin
( digitaria de Haller) , eft le fourrage le plus abondant
qu'on recueille en Caroline. Elle fait ïa richéïïe des
cutivateurs de cette contrée, en ce qu’elle fe
reproduit chaque année fans çulture. En effet,
i° . comme fes graines ne germent qu’au milieu de
l 'é t é , c’eft-à-dire, lorfque tous les binages font
donnés au mais, au coton, au tabac, &c.,_el]e ne
craint point cc-s binages5 20. comme elle pouffe
fuccefiivement, fes premières graines font mûres
plus d ’un mois avant qu'on puifle les couper, &
ces graines ne lèvent que l'année fui vante j $°.
comme fes tiges font en partie couchées & prennent
des racines à chaque noeud, un feul pied
peut couvrir une demi-toife carrée de terrain.
On ne fauche ordinairement qu’une feule fois
le Syntherifmaj mais pour peu que l ’automne fe
prolonge, il elt poffible de le faucher deux fois.
J’ai rapporté plus d’ ifn boifleau de graines de
cette plante, que j’ ai diftribuées dans le midi de la
France & en Italie, mais je n'ai pas appris qu’elles
aient produit les heureux réfultats que j’efpérois.
Celle que j’ ai femée aux environs de Paris a affez
bien le vé , mais les pieds qu’elle a produits ont
gelé avant d’ avoir fructifié, de forte qu’ elle n’a
pas pu fe reproduire. Cette fenfibilité à la gelée
prouve que cette plante eft différente du panic
fanguin. ( B o sc .)
SYNZYGANTHÈRE. S ynzyganthera.
Arbriffeau qui conftitue un genre dans la polygamie
monoecie, mais que nous ne pofledons pas
dans nos jardins. ( Bosc. )
SYPHORICARPE : efpèce du genre Chèvrefeuille,
que quelques botaniftes eftiment devoir
former un genre.
SYRINGA. P hiladrlphus.
Genre de plantes de l’ icofandrie monogynie &
de la famille des Myrtkoides, qui réunit deux ef-
pèees d’arbriffeaux cultivés en pleine terre dans le
climat de Paris. Leur culture fera indiquée dans le
Dictionnaire des Arbres & Arbuftes. (B o s c .)
SYROP. Voyez Sirop.
SYRPHE. S Y RF H ü S.
Genre d’ infeétes de l’ordre des diptères, dans
lequel fe placent plus de cent efpèces, dont fort
peu font dans le cas de mériter l’attention des cultivateurs.
Voye% le Dictionnaire des Infeétes, faifant
partie de YEncyclopédie par ordre de matières.
Fahricius & enfuite Latreille ont divifé ce genre
en plnfieurs autres qu’il n’eft pas néceflaire d’indi-1
quer ici.
Je ne citerai comme nuifible aux cultivateurs.1
que ,1e Syrphe narcijften , mentionné & figuré par ■
Réaumur, & que j’ ai depuis décrit. Sa larve vit I
dans les oignons des narciffes, 8c en fait périr de I
grandes quantités* Pour l’empêcher de fe repro-1
duire, ilggjy a d’autre moyen que de vifiter les oi. I
gnons de narcifle avant de les mettre en terre, & I
de jeter au feu tous ceux dans lefquels on remarque I
un trou d’où fortent des grains de pouflière qui I
font les excrémens de la larve.
Si on ne veut pas perdre l’oignon, on l’ entamera I
avec la pointe d’un^couteau, & on ira tuer la larve I
dans le fond de fa galerie. Cet oignon planté I
donnera une grande quantité de caïeux qui fervi* I
ront à Je. multiplier.
Le Syrphe- transparent , dont la larve yit I
aux dépens de celles de la Guêpe frelon.
Les Syrphes du Groseiller, ,du Poirier, I
BIFASCIÉ , THYMASTRE,. TRANSFUGE plu* I
fleurs autres, proviennent de larves qui vivent aux I
dépens des pucerons, 8ç qui en détruifent chaque I
année des quantités innombrables. Ils font donc I
les auxiliaires des cultivateurs, & doivent être en I
conféquence protégés par eux. Voyez Puceron. I
( Bosc. )x
, SYSTEME. On’ prend prefque toujours ce mot I
en mauvaife part, c’ eft-à-dire, qu'il fignifie géné- I
râlement un enfemble d’idées dont quelques-unes, I
faufies ou exagérées, font le réfultat d’une imagi- I
nation déréglée.
Dans ce fens, un Syftème eft toujours nuifible I
lorfqu’on lui donne des applications. L ’ a g ricu ltu re I
en a fourni plus que les autres arts des exemples I
pendant le cours du dernier fiècle, exemples qui I
en ont dégoûté beaucoup de personnes. Q uoiq ue I
les bafes fur lefquelles elle repofe l'oient aujour- I
d’ hui mieux connues qu’ alors, & qu’il p aroifle.très- I
facile de les éviter, il eft encore des écrivains qui I
en font. Pauvre humanité !
On a cherché à bannir tout efprit de Syftème de I
cet ouvrage.
Voyez T héorie, Pra tiqu e, Routine. I
(B os c.) I
SYZYGIE. S y z y g i a .
Genre çtabli pour placer le My r t e de Ceylan, I
qui n’a pas les caradërés des autres.
Nous ne pofledons pas cet arbre dans nos jardins-1
(B o s c .)
ta b a c ,
T A B
T a BAC : nom d’une efpèce de plante du genre
des Nicoti ânes , qui fe cultive dans les quatre
parties du Monde pour fes feuilles, q ue, depuis
environ deux cent cinquante ans, on eft dans l’habitude
de prendre en poudre par le nez ou de mâcher
en feuilles, ou dont la fumée afpirée plaît à
beaucoup de perfonnes. Elle a été fuccefiivement
appelée herbe de Nicot, herbe de la Reine , herbe du
grand Prieur, herbe.de Sainte~Crpzx , herbe de Tour-
nabony herbe faince; dans fon pays natal, onja nomme
petun.
C ’eft un fait extrêmement digne de remarque j
que cetre plante foit devenue,l’.objet des defirs de
tous les peuples -, que fa culture.fefoit étendue avec
plus de rapidité que celle des-plantes les plus utiles 5
qu’elle foit en ce moment la matière impofable la
plus productive des grands Etats de l’Europe.
A quoi donc eft dû ce goû t, même cette fureur
de tant d’hommes pour, le Tabac ? Uniquement à
ce qu’ il excite les membranes de l’odorat & du
goût ; qu’ il y détermine une augmentation faétice
de vitalité, qui plaît à tous ceux dont les fenfa-
tions font rendues inertes par leur vie inaétive ou
la rigueur de leur climat. Auffi les Turcs, le plus
parefleux de tous les peuples, les foldats & les
matelots, qui ont de fi longs intervalles de repos,
fumenr-ils continuellement j auffi les habitans du
nord de l’Europe , des pays marécageux, prennent
ils plus de Tabac que,ceux du midi, que ceux
des pays de montagnes.
O.n fer oit bien étonné fi on faifoit le calcul de
J’influence qu’a eue l’ufaee du Tabac fur la fortune
publique des différens Etats de l’Europe, d’apprendre
qu’il l'a peut-être.diminuée d ’un quart.
En effet, quand on confidère combien d’heures,
dans l’année, un fumeur déterminé perd à fatif-
faire fon goût, combien même en perd, à prendre
de la poudre par le nez, celui' qui en ufe modérément
, il eft probable qu’on trouveroic une
diminution de piufieurs centaines de millions par
an. Qu’ on juge donc les Gouvernemens qui , pour
augmenter les revenus de l’ impôt qu’ ils ont mis
fur fa confommation, ont encouragé par tous les ,
moyens poflïbles cette confommation. Pour moi, ,
je ne prends pas de Tabac!, & je gémis toutes les
fois que je vois un ouviiér fumer fa pipe, devant fa
porte , un jardinier quitter le manche de fa'bêche
pour.prendre fa prife.
Mais il ne faut pas moins que j’ indique comment
on cultive le Tabac > ainfi j’entre en matière.
Le Mexique paroît être le pays d'où provient
originairement le Tabac.,; il*ne croît naturellement
ni à Tabago., n.i en Floride, ni ën Caroline , ni;eh
Agriculture. Tome VI.
Virginie j mais il a été d’abord porté dans ces lieux,
d’où il eft venu en Europe.
Le Tabac cultivé fous la zone torride eft fi fort
qu’il faut, pour en faire ufage, le mêler avec des
fubftances étrangères, inodores & infapides, ou
avec des tabacs du Nords & au contraire les Ta-
bacs’duNord, comme ceux de Hollande & encore
plus ceux de Prüfle , font fi foibles, qu’il faut les
mélanger avec des Tabacs de Virginie, ou les fur-
charger, à la fabrication,defîrops., de fels,de fpi-
ritueùx, pour leur donner du montant. C ’eft donc
dans les climats intermédiaires, c’eft-à-dire, dans
ceux qui font entré le quarantième & le cinquantième
degré, qu’ il convient de cultiver cette
plante*
Qn voit dans le Théâtre d‘Agriculture d’Olivier
dé Serres, que la culture du Tabac n’étoit pas encore
fortie des jardins du..temps' de Henri IV , &
que les feuilles ne fervoiënt qu’à des ufages médicinaux
j c e ‘p’eft que fous Louis XIII quelle a
commencé à devenir d’un ufage un peu général,
prifç en poudré par le ne;z.
M. Sarrazin, auquel-on doit le dernier Traité
de la culture du Tabac qui ait été .publié en
France, indique cinq efpèces ,de Tabac comme
propres à être cultivées dans le royaume.. >
i° . Le T abac male1, ‘grand T abac,, v r a i -
T abac (nicotiana tabacwni Lirin. ) . Sous le rapport
deTa largeur des feuilles & de là fineffè du
goû t, c’eft la plus; avantage ufe à cultiver \ mais
elle craint lë froid , les brouillards & les ouragans,
"
2°. Le T abac de V i.RGiNi'É pli T ab a c a
feuilles 'AI:güfÀ. Elle eft moins délicaté que la
précédente!, mûrit mieux, n’exige pas un fol auffi
fertile , diminue moins j?ar la defficcacion.
'30. Le T a b a c . de.'.Caroline., Ses feuilles
étant plus courtes & plus étroites que celles de
la précédente, elle fiouffre moins des coups de
vent. Sa culture convient dans les champs qu’on
ne peut abriter.
_ Les;deux: dernières efpèces ne font que des variétés
de la.première , qui en offre encore bien
d’autres * connues feulement dans les pays ou elles
fe cultivent. Je ne citerai que c .lie de Latakie,
qui eft préférée datas de Levant, & qu’ on eftime
beaucoup 2 Marfeille; elle offre pour caractère
diftindtif d avoir les côtes ou nervures principales
plus petites.
4°. Le T abac femelle , T abac du Mexique
AFEUilleS rond.es (nicotiana rufiica Linn.).
On la cultive afvèc üuceès dans les départemens du
E e e