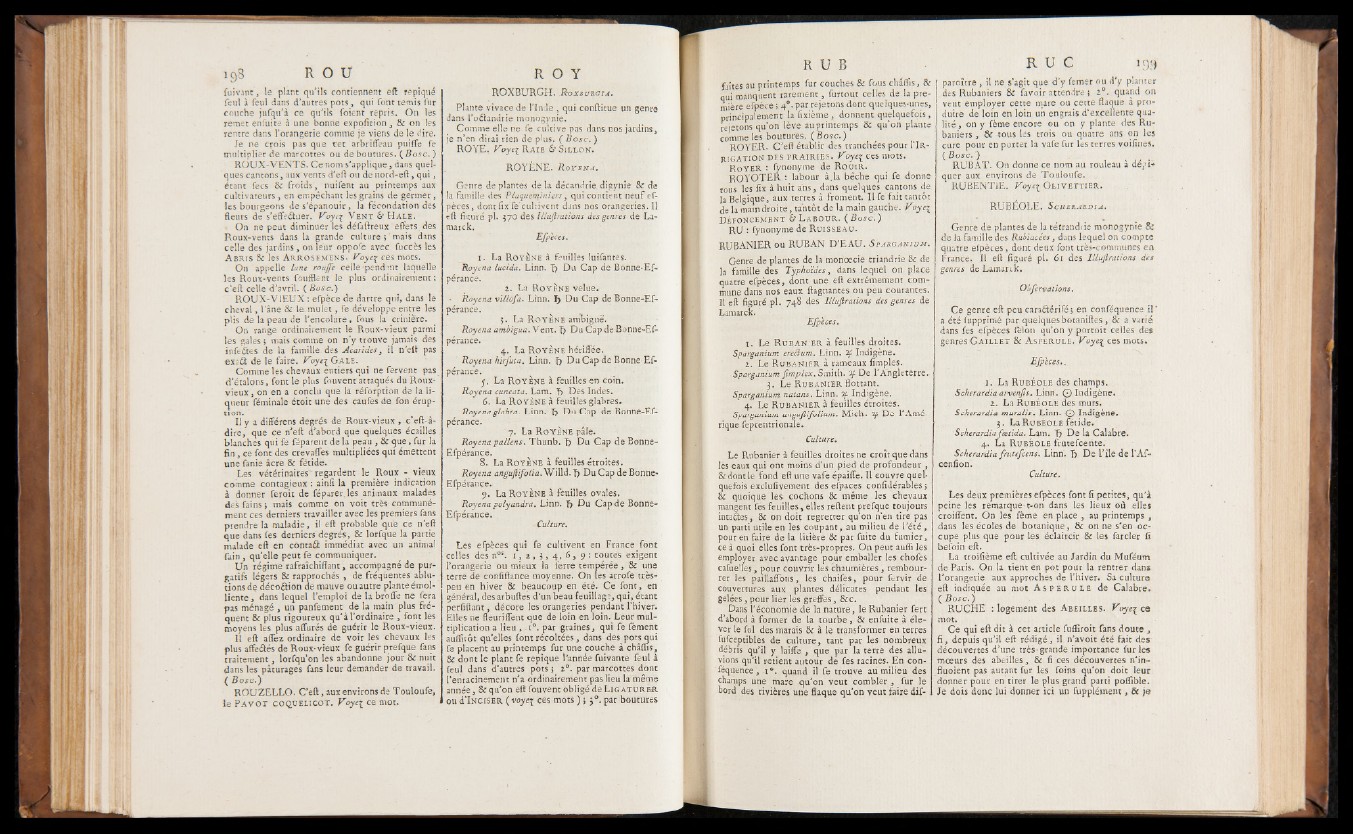
fuivant, le plant qu’ ils contiennent eft repiqué
feul à feul dans d’autres pots, qui font remis fur
couche jufqu’à ce qu’ ils foient repris. On les
remet enfuite à une bonne expofition, & on les
rentre dans l’orangerie comme je viens de le dire.
Je ne crois pas que cet arbriffeau puiffe fe
multiplier de marcottes ou de boutures. ( B o sc . )
ROUX-VENTS. Cenom s’applique, dans quelques
cantons, aux vents-d’eft ou de nord-eft, q u i,
étant fecs & froids, nuifent au printemps aux
cultivateurs, en empêchant les grains de germer,
les bourgeons de s’épanouir, la fécondation des
fleurs de s’effeétuer. Voyez V ent & H a l e .
• On ne peut diminuer les défaftreux effets, des
Roux-vents dans la grande culture > ' mais dans
celle des jardins, on leur oppofe avec fuccès les
A bris & les A r ro sem èns- Voyez ces mots.
On appelle lune roujfe celle pendmt laquelle
les Roux-vents foufflent le plus ordinairement :
c ’eft celle d’avril. ( Bosc.)
ROUX-VIEUX : efpèce de dartre qui, dans le
cheval, l'âne & le_mulet, fe développe entre les
plis de la peau de l’éncolure, fous la crinière.
On range ordinairement le Roux-vieux parmi
les gales ; mais comme on n'y trouve jamais des
infeétes de la famille des Âcarides3 il n’elt pas
exad de le faire. Voyez Ga l e .
Comme les chevaux entiers qui ne fervent pas
d’étalons, font le plus fouvent attaqués du Roux-
v ieux , on en a conclu que la réforption de la liqueur
féminale étoit une des caufes de fon éruption.
Il y a différens degrés de Roux-vieux , c ’ eft-à-
dire, que ce n’eft d’abord que quelques écailles
blanches qui fe féparent de la peau , & que , fur la
fin, ce font des crevaffes multipliées qui émettent
une fanie âcre & fétide.
Les vétérinaires' regardent le Roux - vieux
comme contagieux : ainfi la première indication
à donner feroic de féparer.les animaux malades
desfainsj mais comme on voit très-communément
ces derniers travailler avec les premiers fans
prendre la maladie, il eft probable que ce n'eft
que dans fes derniers degrés, & lorfque la partie
malade eft en contaéf immédiat avec un animal
fain, qu’elle peut fe communiquer.
Un régime rafraïchiflant, accompagné de purgatifs
légers & rapprochés , de fréquentes ablu-
tionsdç décoction de mauve ou autre plante émolliente
, dans lequel l’emploi de la broffe ne fera
pas ménagé, un panfement de la main plus fréquent
& plus rigoureux qu’ à l’ordinaire , font les
moyens les plus allurés de guérir le Roux-vieux.
Il eft affez ordinaire de voir les chevaux les
plus affe&és de Roux-vieux fe guérir prefque fans
traitement, lorfqu’on les abandonne jour & nuit
dans les pâturages fans leur demander de travail.
( B o sc .)
ROUZELLO. C ’eft, aux environs de Touloufe,
le P a v o t c o q u e l i c o t . Voyez ce mot.
ROXBURGH. Ro x to sa iA.
Plante vivace de l’Inde , qui conftitue un genre
dans l’odtandrie monogynie.
Comme elle ne fe cultive pas dans nos jardins,
je n’en dirai rien de plus. ( Bosc. )
ROYE. Voyez Ra ie & Sillon .
ROYÈNE. R o y e k a .
Genre de plantes de la décandrie digynie & de
la famille des Plaqueminiers 3 qui contient neuf efpèces,
dont fix fe'cultivenr dans nos orangeries. Il
eft figuré pl. 370 des lllufirations des genres de Lamarck.
Efpèces.
i . La Royène à feuilles luifantes.
Royena lucida. Linn. T? Du Cap de Bônne-Ef-
pérance.
2. La Royène velue.
• Royena villofa. Linn. ï> Du Cap de Bonne-Ef-
pérance.
3. La Ro y Ène ambiguë’.
Royena ambigua. Vent. T? Du Cap de Bonne-Ef-
pérance.
4. La Royène hériffée.
Royena hirfuta. Linn. f) Du Cap de Bonne Ef-
pérance.
y. La Roy èn e à feuilles en coin.
Royena cuneata. Lam. T> Des Indes.
6 . La Royène à feuilles glabres.
Royena glabra. Linn. Ij Du Cap de Bonne-Ef-
pérance.
7. La Royène pâle.
Royena pallens. Thunb. T? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
8. La Royène à feuilles étroites.
Royena angufiifolia.WiWd.f) Du Cap de Bonne-
Efpérance.
9. La R oyène à feuilles ovales.
Royena polyandra. Linn. I7 Du Cap de Bonne-
Efpérance.
Culture.
Les efpèces qui fe cultivent en France font
celles des n°*. 1 , 2 , 3 ,4 , 6 , 9 : toutes exigent
l’orangerie ou mieux la ferre tempérée, & une
terre de confiftance moyenne. On les arrofe très-
peu en hiver & beaucoup en été. Ce font, en
général, des arbuftes d’un beau feuillage, qui, étant
perfiftant, décore les orangeries pendant l’hiver.
Elles ne fleuriffent que de loin en loin. Leur multiplication
a lieu , i°. par graines, qui fe fèment
auffirôt qu’elles font récoltées, dans des pots qui
fe placent au printemps fur une couche à châfïis,
& dont le plant fe repique l'année fuivante feul à
feul dans d’autres pots j 2°. par marcottes dont
l'enracinement n’ a ordinairement pas lieu la même
année, & qu’on eft fouvent obligé de Lig a tu r e r
ou d’iNCiSER ( voyez ces mots )} 50. par boutures
R U B
faites au printemps fur couches & fous châflis, &
qui manquent rarement, furtout celles de la première
efpèce ; 4®. par rejetons dont quelques-unes,
principalement la fixième , donnent quelquefois,
rejetons qu’on lève au printemps & qu’on plante
comme les boutures. (B o s c .)
ROYER. C ’eft établir des tranchées pour I’Ir-
rigation des prairies. Voyez ces mots*
Royer : fynonyme de Rouir.
KOYOTER : labour à.la bêche qui fe donne
tous les fix à huit ans, dans quelques cantons de
la Belgique, aux terres à froment. Il fe fait tantôt
de la main droite, tantôt de la main gauche. Voyez
Défoncement & L abour. (B o s c .)
RU : fynonyme de Ruisseau.
RUBANIER ou RUBAN D’E AU. S p a r g an ium .
Genre de plantes de la morioecie triandrie fte de
la famille des Typhoïdes, dans lequel on place
quatre efpèces, dont une eft extrêmement commune
dans nos eaux ftagnantes ou peu courantes.
Il eft figuré pl. 748 des lllufirations des genres de
Lamarck.
Efpèces.
1. Le Ruban:er à feuilles droites.
Sparganium ereïïum. Linn. Indigène.
2. Le Rubanier à rameaux fimples.
Sparganium fimplex. Smith. De l’Angleterre.
3. Le Rubanier flottant.
Sparganium natans. Linn. ^ Indigène.
4. Le Rubanier à feuilles étroites.
Sparganium angufiifolium. Mich. If De l’Amérique
feptentrionale.
Culture.
Le Pxubanier à feuilles droites ne croît que dans
les eaux qui ont moins d’un pied de profondeur ,
& dont le fond eft une vafe épaiffe. Il couvre quelquefois
exclufivement des efpaces confidérables j
& quoique les cochons & même les chevaux
mangent fes feuilles, elles relient prefque toujours
intaâes, & on doit regretter qu’on n’en tire pas
un parti utile en les coupant, au milieu de l ’é té ,
pour en faire de la litière & par fuite du fumier,
ce à quoi elles font très-propres. On peut aulfi les
employer avec avantage pour emballer les chofes
cafuelles, pour couvrir les chaumières, rembourrer
les pailiaffons, les chaifes, pour fervir de
couvertures aux plantes délicates pendant les
gelées, pour lier les greffes, & c .
Dans l’économie de la nature, le Rubanier fert
d’abord à former de la tourbe, & enfuite à élever
le fol des marais & à le transformer en terres
filfceptibles de culture, tant par les nombreux
débris qu’il y laiffe , que par la terre des allu-
vions qu’il retient autour de fes racines. En conséquence,
1®. quand il fe trouve au milieu des
champs une mare qu’on veut combler , fur le
bord des rivières une flaque qu’on veut faire dif-
R U C 199
paroïtre , il ne s’agit que d’y femer ou d’y planter
des Rubaniers & favoir attendre} 2°. quand on
veut employer cette mare ou cette flaque à produire
de loin en loin un engrais d’ excellente quali
té , on y fème encore ou on y plante des Rubaniers
, & tous lés trois ou quatre ans on les
cure pour en porter la vafe fur les terres voifines.
(B o s c .)
RUBAT. On donne ce nom au rouleau à dépiquer
aux environs de Touloufe.
RUBENT1E. Voyez Olivettier.
RUBÉOLE. ScHERARDIA.
Genre de plantes de la tétrandrie monogynie &
de la famille des Rubiacées, dans lequel on compte
quatre efpèces, dont deux font très-communes en
France. Il eft figuré pl. 61 des lllufirations des
genres de Lamarck.
Obfervàtions.
Ce genre eft peu cara&ériféi en conféquence il*
a été fupprimé par quelques botaniftes, & a varié
dans fes efpèces félon qu’on y portoit celles des
genres Gaillet & A spérule. Voyez ces mots.
Efpèces...
1. La Rubéole des champs.
Scherardia arvenfis. Linn. 0 Indigène.
2. La Rubéole des murs.
Scherardia muralis. Linn. 0 Indigène.
3. La Rubéole fétide.
Scherardia foetida. Lam. T} De la Calabre.
4. La Rubéole frutefcerite.
Scherardia frutefcens. Linn. T> De l’ île de l’A f-
Les deux premières efpèces font fi petites, qu'à
peine les remarque-t-on dans les lieux où elles
croiffent. On les fème en place , au printemps ,
dans les écoles de botanique, & on ne s’ en occupe
plus que pour les éclaircir & les farder fi
befoin eft.
La troifième eft cultivée au Jardin du Muféum
de Paris. On la tient en pot pour la rentrer dans
l’orangerie aux approches de l’hiver. Sa culture
eft indiquée au mot A s p érul e de Calabre.
( B o sc .)
RUCHE : logement des A beilles. Voyez cô
mot.
C e qui eft dit à cet articje fuffiroit fans d ou te ,
fi, depuis qu’il eft rédigé, il n’avoit été fait des
découvertes d’une très-grande importance furies
moeurs des abeilles, & fi ces découvertes n’in-
fluoient pas autant fur les foins qu’on doit leur
donner pour en tirer le plus grand parti poffible.
Je dois donc lui donner ici un fupplément, & je