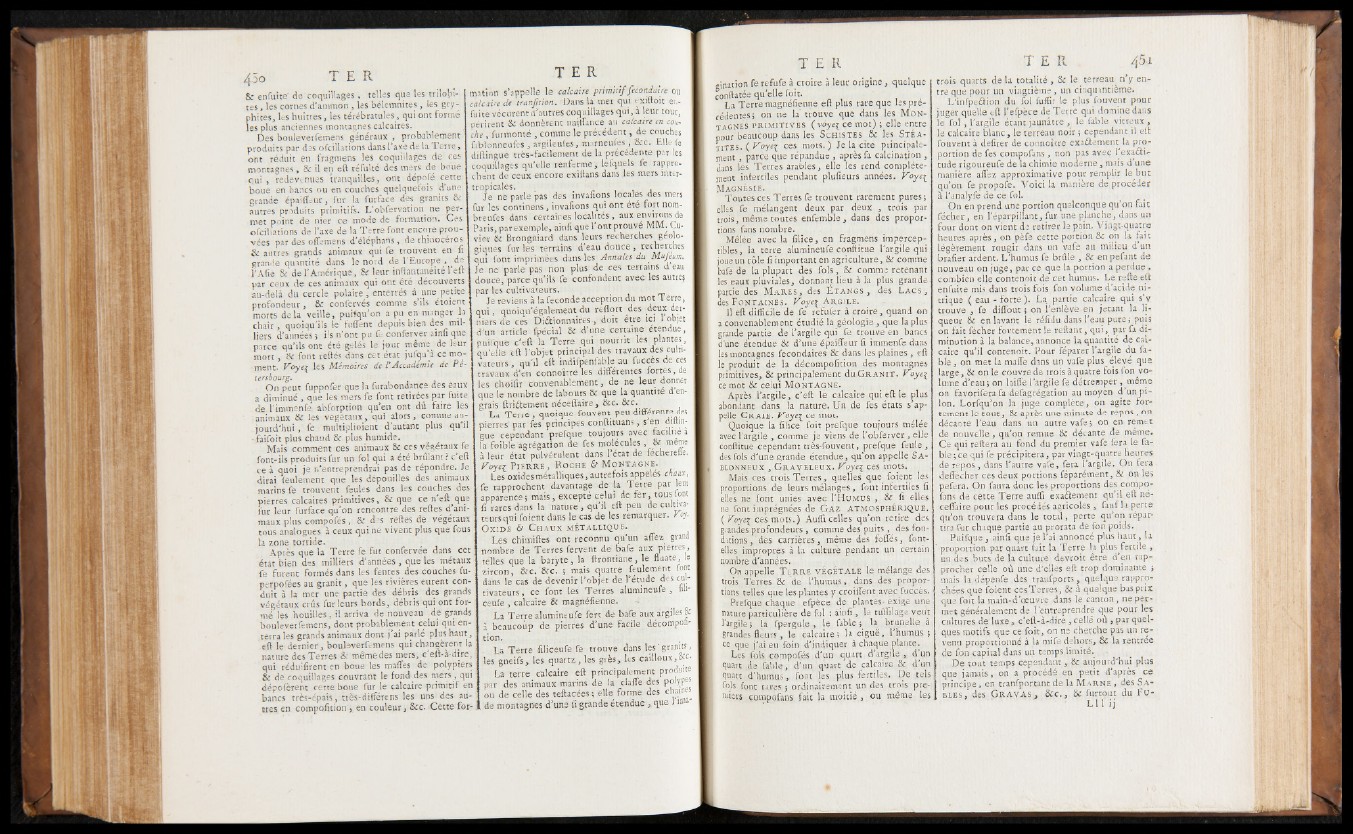
& en fuite" de coquillages, telles que les trilobi-
te s , les cornes d’ammon , les bélemnites, les gry-
phi tes, les huîtres, les térébratules, qui ont formé
les plus anciennes montagnes calcaires.
Des bouleverfemens généraux , probablement
produits par des ofcillations dans 1’ axe de la T e rre,
ont réduit en fragmens les coquillages de ces
montagnes , & il en eft réfulté des mers de boue,
qui , redevenues tranquilles, ont dépofé cette1
boue en bancs ou en couches quelquefois d une
grande épaiffeur, fur la furface des granits &
autres produits primitifs. L’obfervation ne permet
point de nier ce mode de formation. Ces
ofcillations de l’axe de la Terre font encore prouvées
par des offemens d’éléphans, de rhinocéros
& autres grands animaux qui fe trouvent en fi
grande quantité dans le nord de l’Europe, de
l’Afie & de l’Amérique, 8c leur inftantanéité Teft
par ceux de ces animaux qui ont eté^ découverts
au-delà du cercle polaire, enterrés à une petite
profondeur, & confervés comme s’ils étoient
morts delà v eille, puisqu’on a pu en manger la
chair, quoiqu'ils le fuffent depuis bien des milliers
d’années 5 ils n’ont pu fe conferver ainfi que
parce qu’ ils ont été gelés le jour même^ de leur
m or t, de font reftés dans cet état jufqu’ à ce mo-,
ment. Voyeç les Mémoires de VAccadémie de Pe-
lersbourg.
On peut fuppofer que la furabondance des eaux
mntion s’appelle le calcaire primitif fecortdaire ou
calcaire de tranfetion. 'Dans la mer qui exiftoit er,«
fuite vécurent d’ autres coquillages qui, à leur tour,
périrent & donnèrent naiffance au calcaire en couche
a diminué, que les mers fe font retirées par fuite
de l’immenfe abforption qu’en ont dû faire les
animaux & les végétaux, qui alors, comme aujourd'hui
, fe multiplioient d’autant plus qu’il
-faifoit plus chaud & plus humide. '
Mais comment ces animaux & ces végétaux fe
font-ils produits fur un fol qui a été bruiant ? c eft
ce à quoi je n’entreprendrai pas de repondre. Je
dirai feulement que les dépouilles des animaux
marins fe trouvent feules dans les couches des
pierres calcaires primitives, & que ce n’ eft que
fur leur furface qu’on rencontre des reftes d’animaux
plus compofés, 5 c des reftes de végétaux
tous analogues à ceux qui ne vivent plus que fous
ta zone torride.
Après que la Terre fe fut confervée dans cet
état bien des milliers d’années , que les métaux
fe furent formés dans les fentes des couches fu-
perpofées au granit, que les rivières eurent conduit
à la mer une partie des débris des grands
végétaux crûs fur leurs bords, débris qui ont formé
les houilles, il arriva de nouveau de grands
bouleverfemens, dont probablement celui qui enterra
les grands animaux dont j’ ai parle plus haut,
eft le dernier, bouleverfemens qui changèrent la
nature des Terres & même des mers, c eft-à-dire,
qui réduifirent en boue les maffes de polypiers
& de coquillages couvrant le fond des ùtërs} qui
dépofèrent cette boue fur le calcaire primitif en
bancs très-épais, très-diffèrens les uns des autres
en comp ofitionen couleur, 8 cc. -Cette for*
, furmonté , comme le précédent, de couches
fablonneufes , argileufes, m:<rneufes, & c . Elle fe
diftingue très-facilement de la précédente par les
coquillages qu’elle renferme, lefquels fe rapprochent
de ceux encore exiftans dans les mers intertropicales.
.
Je ne parle pas des invafions locales des mers
fur les continens, invafions qui ont été fort nom-
breufes dans certaines localités , aux environs de
Paris, par exemple, ainfi que l’ ont prouvé MM. Cuvier
8c Brongniard dans leurs recherches géologiques
fur les terrains d’eau douce, recherches
qui font imprimées dans les Annales du Mufeum.
Je ne parle pas non plus de ces terrains d eau
douce, parce qu’ ils fe confondent avec les autie§
par les cultivateurs.
Je reviens à la fécondé acception du mot Terre,
q u i, quoiqu’également du reflort ^des deux derniers
de ces Di&ionnaires -, doit être ici l’objet
d’un article fpécial & d’ une certaine étendue,
puifque c’eft la Terre qui nourrit les plantes,
qu’elle eft l ’objet principal des travaux des cultivateurs
, qu’il eft indifpenfable au fuccès de ces
travaux d’en connoître les différentes fortes, de
les choifir convenablement, de ne leur donner
que le nombre de labours & que la quantité d en*
1 grais ftriétement néceffaire, & c . &c.
I La T e r r e , quoique fouvent peu differente des
pierres" par fes principes conftituans, s en diftingue
cependant prefque toujours avec facilite à
la foible agrégation de fes molécules, 8c meme
à leur état pulvérulent dans 1 état de fécherefie.
Voye^ Pierre , Roche & Montagne.
Les oxides métalliques, autrefois appelés chaux,
fe rapprochent davantage de la Terre par leur
apparence j mais, excepté celui de fe r , tous font
fi rares dans la nature, qu’ il eft peu de cultivateurs
qui foient dans le cas de les remarquer. Vg
Oxide & C haux métallique.
Les chimiftes ont reconnu qu’ un affez grand
nombre de Terres fervent de bafe aux pierres J
telles que la baryte, la ftrontiane, le fluate, le
zircon, 8 cc. & c . ; mais quatre feulement font |
dans le cas de devenir l’objet de l’étude des cultivateurs,
ce font les Terres alumineufe, «li-
ceufe, calcaire U magnéfienne.
La Terre alumineufe ferc de bafe aux argiles &
à beaucoup de pierres d’une facile décompoli'
tion.
La Terre -filiceufe fe trouve dans les ‘ granits,
les gneifs, les quartz, les grès, les cailloux,&c»
La terre calcaire eft principalement produite
par des animaux marins de la claffe des pptyPe*
ou de celle des teftacées ; elle forme des chaînes
. de montagnes d’une fi grande étendue , : que 1 ima'
T E R T E R 45i
gination fe refufe à croire à leur origine, quelque
conftatée quelle foit.
La Terre magnéfienne eft plus rare que les précédentes
; on ne la trouve que dans les Montagnes
primitives ( voyez ce mot) ; elle entre
pour beaucoup dans les Schistes & les Stéa-
tites. ( Voyei ces mots.) Je la cite principalement
, parce que répandue , après fa calcination ,
dans les Terres arables, elle les rend complètement
infertiles pendant plufieurs années. Voye[
Magnésie.
Toutes ces Terres fe trouvent rarement pures j
elles fe mélangent deux par deux , trois par
trois, même toutes enfemble, dans des proportions
fans nombre.
Mêlée avec la filice, en fragmens imperceptibles,
la terre alumineufe conftitue l’argile qui
joue un rôle fi important en agriculture, & comme
bafe de la plupart des fols , & comme retenant
les eaux pluviales, donnant lieu à la plus grande,
partie des Mar es , des Ét a n g s , des La c s ,
des Fontaines. Voye% Argjle.
11 eft difficile de fe refufer à croire, quand on
a convenablement étudié la géologie, que la plus
grande partie de l’ argile qui fe trouve en bancs
d’une étendue & d’une épaiffeur fi immenfe dans
les montagnes fecondaires 8c dans les plaines , eft
le produit de la décompofition des montagnes
primitives, & principalement du Gr a n it . Voye1
ce mot & celui Montagne.
Après l’argile, c ’eft le calcaire qui eft le plus
abondant dans la nature. Un de fes états s’appelle
C ra ie. Voye£ ce mot.
Quoique la filice foit prefque toujours mêlée
avec l’argile , comme je viens de l’obferver , elle
conftitue cependant très-fouvent, prefque feule,
des fols d’une grande étendue, qu’on appelle Sa blonneux
, Graveleux. Voyt\ ces mots.
Mais ces trois Terres, quelles que foient les
proportions de leurs mélanges, font infertiles fi
elles ne font unies avec I’Humus , & fi elles
ne font imprégnées de Gaz atmosphérique.
( Foyei ces mots.) Aufficelles qu’on retire des
grandes profondeurs , comme des puits, des fondations
, dès carrières, même des foffés, font-
elles impropres à la culture pendant un certain
nombre d’années.
On appelle T erre végétale le mélange des
trois Terres 8c de l’humus, dans des proportions
telles que les plantes y croiffent avec fuccès.
Prefque chaque efpèce de plantes-exige une
nature particulière de fol : ainfi, le tuffilage veu't
l’argile 5 la fpergule , le fable ; la brunelle a
grandes fleurs, le calcaire ; la ciguë, l’humus ;
ce que j’ ai eu foin d’ indiquer à chaque plante.
Les fols, compofés d’ un quart d’argile , d’un
quart de fable, d’un quart de calcaire 8c d’un
: quart d’humus, font les plus fertiles. De ;tels
i fols font rares j ordinairement un des trois pre-
' nûers çompofans fait la moitié , ou même les
trois quarts de la totalité, & le terreau n’ y entre
que pour un vingtième , un cinquantième.
L'infpe&ion du fol fuffir le plus fouvent pour
juger quelle eft l’efpèce de Terre qui domine dans
le f o l , l’argile étant jaunâtre , le fable vitreux,
le calcaire blanc, le terreau noir ; cependant il eft
fouvent à defirer de connoître exactement la proportion
de fes çompofans , non pas avec l’exaCti-
tude rigoureufe de la chimie moderne, mais d’une
manière affez approximative pour remplir le but
qu’on fe propofe. Voici la manière de procéder
à i’ analyfe de ce fol.
On en prend une portion quelconque qu’on fait
fécher, en l’éparpillant, fur une planche, dans un
four dont on vient de retirer le pain. Vingt-quatre
heures après, on pèfe cette portion 8 c on la fait
légèrement rougir dans un vafe au milieu d’ un
brafier ardent. L ’humus fe brûle , & en pefant de
nouveau on juge, par ce que la portion a perdue *
combien elle contenoit de cet humus. Le refte eft
enfuite mis dans trois fois fon volume d’acide nitrique
( eau - forte ). La partie calcaire qui s’ y
trouve , fe diffout > on l’enlève en jetant la liqueur
8c en lavant le réfîdu dans l’eau pure ; puis
on fait fécher fortement le reftant, qui, par fa diminution
à la balance, annonce la quantité de calcaire
qu’ il contenoit. Pour féparer l’argile du fable
, on met la maffe dans un vafe plus élevé que
large, 8c on le couvre de trois à quatre fois fon volume
d’eau; on laiffe l ’argile fe détremper, même
on favorifera fa defagrégation au moyen d’un pilon.
Lorfqu’on la juge complète, on agite fortement
le tou t, 8c après une minute de repos, on
décante l’eau dans un autre vafe; on en remet
de nouvelle, qu’on remue & décante de même.
Ce qui reftera au fond du premier vafe fera le fable;
ce qui fe précipitera, par vingt-quatre heures
de repos, dans l’autre vafe, fera l'argile. On fera
deffécher ces deux portions féparément, & on les
pefera. On faura donc les proportions des compo-
fans de cette Terre auffi exactement qu’ il eft né-
ceffaire pour les procédés agricoles , fauf la perte
qu’on trouvera dans le total, perte qu’on répartira
fur chaque partie au prorata de fon poids.
Puifque, ainfi que je l’ai annoncé plus haut, la
proportion par quart fait la Terre la plus fertile ,
un des buts de la culture devroit être d’en rapprocher
celle où une d’elles eft trop dominante ;
mais la dépenfe des tranfports, quelque rapprochées
que foient cesTerres, & à quelque bas prix
que foit la main-d’oeuvre dans le canton, ne permet
généralement de l ’entreprendre que pour les
cultures de luxe, c’eft-à-dire , celle où , par quelques
motifs que ce foit, on ne cherche pas un revenu
proportionné à la mi fe dehors, 8c la rentrée
de fon capital dans un temps limité. -
De tout temps cependant, 8c aujourd’hui plus
que jamais, on a procédé en petit d’après ce
principe, en tranfportant de la M arne , des Sa b
l e s , des G r a v a s , & c. , 8c furtouc du Fu-
L l l i j