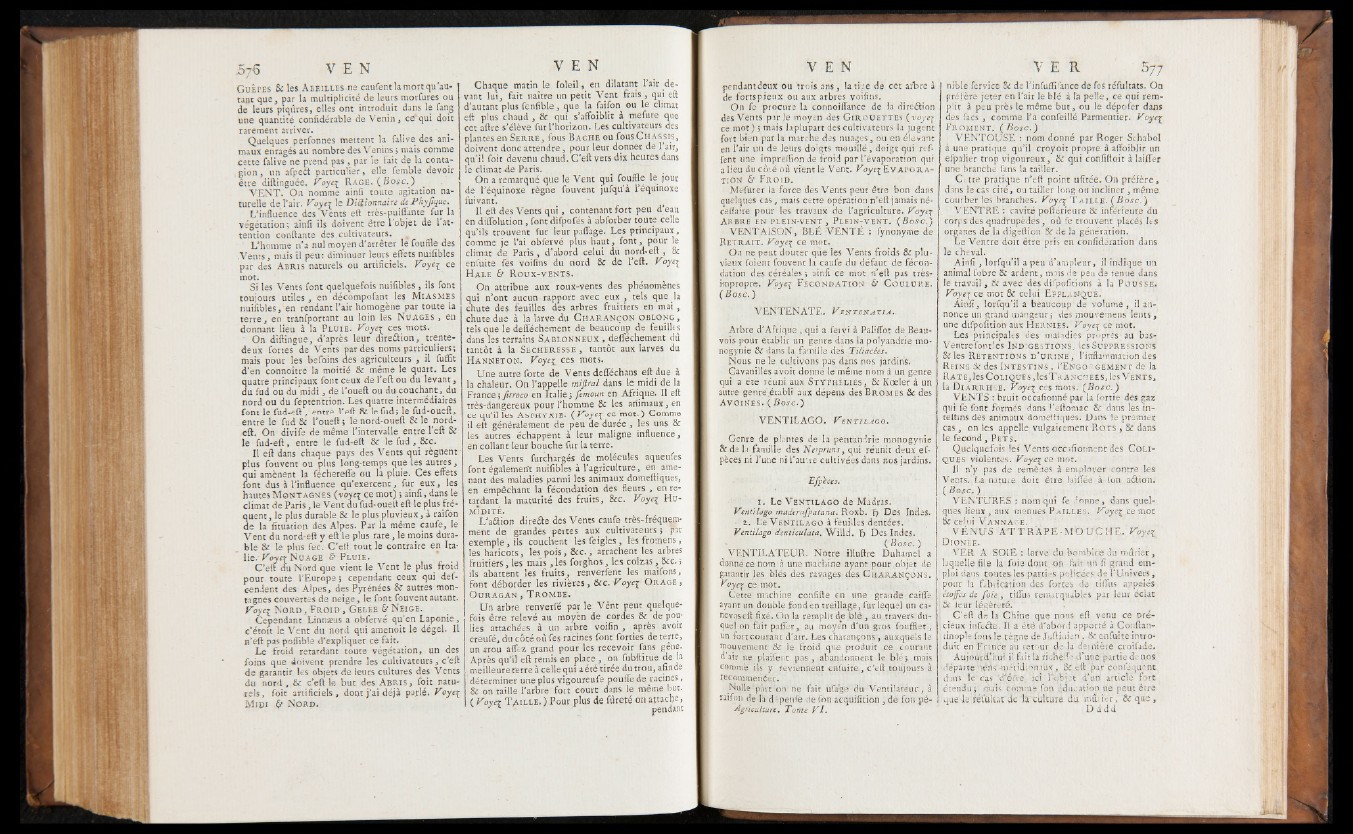
G uêpes & les A beilles ne caufent la mort qu‘autant
que 3 par la multiplicité de leurs morfures ou
de leurs piqûres, elles ont introduit dans le fang
une quantité confidérable de V en in , ce qui doit
rarement arriver.
Quelques perfonnes mettent la falive des animaux
enragés au nombre des Venins ; mais comme
cette falive ne prend pas , par le fait de la contagion
, un afoett particulier, elle femble devoir
être diftinguée. Voyez R a g e . {B o s e .)
V E N T . On nomme ainfi toute agitation naturelle
de l’air. Voyez le Diâionnaire de Phyfique.
L’ influence des Vents eft très-puiffante fur la
végétation ; ainfi ils doivent être 1 objet de 1 attention
confiante d e s . cultivateurs. #
L’homme n’ a nul moyen d’arreter le fouffle des
.Vents, mais il peut diminuer leurs effets nuifibles
par des A bris naturels ou artificiels. Voyez ce
mot.
Si les Vents font quelquefois nuifibles, ils font
toujours utiles , en décompofant les Mia sm e s
nuifibles, len rendant l’air homogène par toute la
te r re , en tranfportant au loin les N uages , en
donnant lieu à la Plu ie . Voyez ces mots.
On diftingue, d’après leur diredtion, trente-
deux fortes de Vents par des noms particuliers;
mais pour les befoins des agriculteurs , il fuffit
d’en connoître la moitié & même le quart. Les
quatre principaux font ceux de l’eft ou du levant,
du fud ou du midi, de l’oueft ou du-couchant, du
nord ou du feptentrion. Les quatre intermédiaires
font le fud-eft , entre l’ eft & le fud; le fud-oueft,
entre le fud & l’ oueft ; le nord-oueft & le nord-
eft. On divife de même l’ intervalle entre l’eft &
le fud-eft, entre le fud-eft & l e fu d ,& c .
Il eft dans chaque pays des Vents qui régnent
plus fouvent ou plus long-temps que lés autres,
qui amènent la féchereffe ou la pluie. Ces effets
font dus à l’influence qu’exercent, fur eux , les
hautes Montagnes (voyez ce mot) ; ainfi, dans le
climat de Paris, le Vent du fud-oueft eft le plus fréquent,
le plus durable & le plus pluvieux, à raifon
de la fituation des Alpes. Par la même caufe, le
Vent du nord-eft y eft le plus rare, le moins durable
& le plus fec. C ’ell tout le contraire en Ita-
lie/ Voyez Nu age & Plu ie .
C ’eft du Nord que vient le Vent le plus froid
pour, toute l’Europe ; cependant ceux qui def-
c-endent des Alpes, des Pyrénées & autres montagnes
couvertes de neige, le font fouvent autant.
Voyez Nord , F r o id , G elée & N eige.
Cependant Linnaeus a obfervé qu’en Laponie,
c’étoit le Vent du nord qui amenoit le dégel. Il
n’eft pas poffible d’ expliquer ce fait.
Le froid retardant toute végétation, un des
foins que doivent prendre les cultivateurs, c'eft
de garantir les objets de leurs cultures des Vents
du nord , & c’eft le but des A b r i s , foit naturels,
foit artificiels, dont j ’ai déjà parlé, Voyez
Midi £ N o r d .,
Chaque matin le fo le il, en dilatant l’ air devant
lu i, fait naître un petit Vent frais, qui eft
d’autant plus fenfible, que la faifon ou le climat
eft plus chaud, & qui s’affoiblit à mefure que
cet aftre s’élève fur l’ horizon. Les cultivateurs des
plantes en Se r r e , fous Bâ che ou fous C i-ia s sis,
doivent donc attendre, pour leur donner de l’ air,
qu’il foit devenu chaud. C ’eft vers dix heures dans
j le climat de Paris.
On a remarqué que le Vent qui fouffle te jour
de l’équinoxe règne fouvent jufqu’à l’équinoxe
fuivant. . ~ -
Il eft des Vents q u i , contenant fort peu d eau
en diiïolution , font difpofés à abforber toute celle
qu’ils trouvent fur leur paffage. Les principaux,
comme je l’ai obfervé plus haut, font, pour le
climat de Paris , d’ abord celui du nord-eft , &
enfuite fes voifins du nord & de l’eft. Voyez
Ha le & R oux-v e n t s .
On attribue aux roux-vents des phénomènes
qui n’ ont aucun rapport avec e u x , tels queda
chute des feuilles des arbres fruitiers en m a i,
chute due à la larve du C h a r a n ç o n o b lo n g ,
tels que 1e defféchement de beaucoup de feuilles
dans les terrains Sab lonneux , defféchement dû
tantôt à la Se ch er e s se , tantôt aux larves du
Ha n n e to n . Voyez ces mots.
Une autre forte de Vents defféchans eft due à
la chaleur. On l’appelle miftral dans 1e midi de la
France ; firroco en Italie.; femoun en Afrique. Il eft
très-dangereux pour l’ homme & tes animaux, en
ce qu’ il les A s ph yx ie . (Voyez ce mot.) Comme
il elt généralement de peu de durée , les uns &
les autres échappent à leur maligne influence,
en collant leur bouche fur la terre.
Les Vents furchargés de molécules aqueufes
font également nuifibles à l’agriculture, en amenant
des maladies parmi tes animaux domettiques,
en empêchant la fécondation des fleurs , en retardant
la maturité des fruits, & c . Voyez Hum
id it é .
L’a&ion direfte des Vents caufe t rès - fréquemment
de grandes pertes aux cultivateurs ; par
exemple , ils couchent les feigles, les fromens,
tes haricots, les pois, & c . , arrachent les arbres
fruitiers, les maïs ,le s forghos, tes colzas, & c .;
ils abattent les fruits, renverfent tes maifons,
font déborder tes rivières, & c . V o y e zO rage ,
O u r a g a n , T r om b e .
Un arbre renverfé par 1e Vent peut quelquefois
être relevé au moyen de cordes & de pou*
. lies attachées à un arbre voifin , après avoir
creufé, du côtéoù fes racines font forties de terre,
un trou affez grand pour les recevoir fans gene.
Après qu’il eft remis en place, on fubftitue de la
meilleure terre à celle qui a été tirée du trou, afin de
déterminer une plus vigoureufe pouffe déracinés,
& on taille l’arbre fort court dans le même but.
C Voyez T a il l e . ) Pour plus de fûrepé on attache,
v J 1 pendant
•pendantdeux ou trois ans, la th e de cet arbre à
de fortspieux ou aux arbres yoifins.
On fe procure la connoiffance de la dire&ion
des Vents par le moyen des G ir o u e t t e s ( voyez
ce m ot); mais laplupart des cultivateurs la jugent
fort bien par la marche des nuages, ou en élevant
en l’air un de leurs doigts mouillé, doigt qui ref-
fent une imprèffion de froid par l’évaporation qui
a lieu du côté où vient 1e Vent. Voyez Ev a p o r a tion
& Fr o id ..
Mefurer la force des Vents peut être bon dans
quelques cas, mais cette opération n’ eft jamais né-
ceffaire pour les travaux de l’agriculture. Voyez
A rbre en plein-v e n t , Plein-v e n t . ( B o s c .)
V E N T A 1SON, BLÉ V EN T É ; fynonyme de
Re t r a it . Voyez ce mot,
On ne peut douter que tes Vents froids & pluvieux
foient fouvent la caufe du défaut de fécondation
des céréales ; ainfi ce mot n’ eft pas très-
impropre. Voyez Fé co n d a t io n & C o u lu r e .
( Bosc. )
V EN T EN A T E . Ventenatia.
Arbre d’Afrique , qui a feivi à Paliffot de Beau-
vois pour établir un genre dans la polyandrie mono
gy nie & dans la famille des Tiliacées.
Nous ne le cultivons pas dans nos jardins.
Cavanilles avoit donné le même nom d un genre
qui a été réuni aux St y ph é l ie s , & Koeler à un
autre genre établi aux dépens des Bromes & des
Av o in e s . ( B o sc .)
VEN TILAGO . Ventilâgo.
Genre de plantes de la pentandrie monogynie .
& de la famille des Nerpruns, qui réunit deux ef-
pèces ni l’une ni i’au:re cultivées dans nos jardins.
Efpeces.'
i . Le V en tilâgo de Madras.
Ventilâgo mademfpatana. Roxb. h Des Indes.
- i . Le V entilâgo à feuilles dentées.
Ventilâgo denticulata. WiWd. T) Des Indes.
(B o s c .)
VENTILATEUR. Notre illuftre Duhamel a
donné ce nom à une machine ayant pour objet de
garantir les blés des ravages des C h a r a n ç o n s .
Voyez ce mot-
Cette machine confifte en une grande caiffe
ayant un double fond en treillage, fur lequel un ca-
nevaseft fixé. On la remplit de blé , au travers duquel
on fait paffer, au moyen d’ un gros foufflet,
un fort courant d’air. Les charançons", auxquels le
mouvement & je froid que produit ce courant
d’air ne plaifent pas , abandonnent le blé;.,mais
comme ils y reviennent enfuite,, c ’eft .toujours à
recommencer.
.Nulle part on ne fait ufa^gé du Ventilatéur, à
raifon de la dépenfè defon acquisition , de foiVpé-
Agriculture. Tome VI.
nible fervice Sc de l’infuffifance de Tes réfultats. On
préfère jeter en l’air 1e blé à la pelle, ce qui remplit
à peu près 1e même but, ou 1e dépofer dans
des facs , comme l’a confeillé Parmentier. Voyez
Froment. ( B osc. )
VENTOÜSE : nom donné par Roger Schabol
à une pratique qu’il croyoit propre à affoiblir un
efpalier trop vigoureux, & qui confiftoit à laiffer
‘ une branche fans la tailler.
Ce tte pratique n’eft point ufitée. On préfère,
dans le cas cité, ou tailler long ou incliner, même
courber les branches. Voyez T aille. ( B osc.)
VENTRE : cavité poftérieure & inférieure du
corps des quadrupèdes , où fe trouvent placés les
organes de la digeftion & de la génération.
Le Ventre doit être pris en confédération dans
1e cheval.
Ainfi , lorfqu’il a peu d’ampleur, il indique un
animal fobre & ardent, mais de peu de tenue dans
le travail, & avec des difpofitions à la Pousse,
Voyez ce niot & celui EFFLANQUÉ.
Ainfi, lorfqu’il a beaucoup de volume, il annonce
un grand mangeur ; des mouvemens lents ,
une dîfpofition aux Hernies. Voyez ce mot-
Les principales des maladies propres au bas-
Ventre font les Indigestions, les Suppressions
& les Rétentions d’urine, l’inflammation des
Reins & des Intestins , ^Engorgement de la
Rate, les C oliques, les T ranchées, les V ents,
la Diarrhse. Voyezjees mots. ( B o s c . )
VENTS : bruit occafionné par la fortie des gaz
qui fe font formés dans l’eftomac &r dans les i.n-
teftins des animaux domeftiques. Dans le premier
cas, on les appelle vulgairement Rots , & dans
le fécond, Pets.
Quelquefois les Vents occafionnent des C oliques
violentes. V o y s z ce mot.
Il n’y pas de remèdes à employer contre les
Vents.'La nature doit être laiffée à fon aétion.
( B o s c , )
VENTURES : nom qui fe donne , dans quelques
lieux, aux menues Pailles. Voyez ce mot
& celui V annage.
VÉNUS AT T RAPE- MO UÇ H E . Voyez
DroNÉE.
VER A SOIE : larve du borribice du mûrier,
laquelle file la foie dont on fait un fi grand emploi
dans toutes les parties policées de l’Univers,
pour la fabrication des fortes de tiffus appelés
étoffes de foie , tiffus remarquables par leur éclat
3c ieur légèreté.
; C’eft de la Chine que nous eft venu ce pré-
jcieux infeète. Il a été d’abord apporté à Conftan-
tinople fous le .règne de Juftiuien , & enfuite introduit
en France au retour dé jà dernière croifade.
Aujourd’hui il fait la ri ohé fie d’une partie do nos
• départe nërts''méridionaux, & eft par çonféquont
dans le cas 'd’êne. ici l’objet d’un article fort
étendu; mais comme fon éducation ne peut être
que te réfiikat de là culture du mûrier, & que ,
Dddd