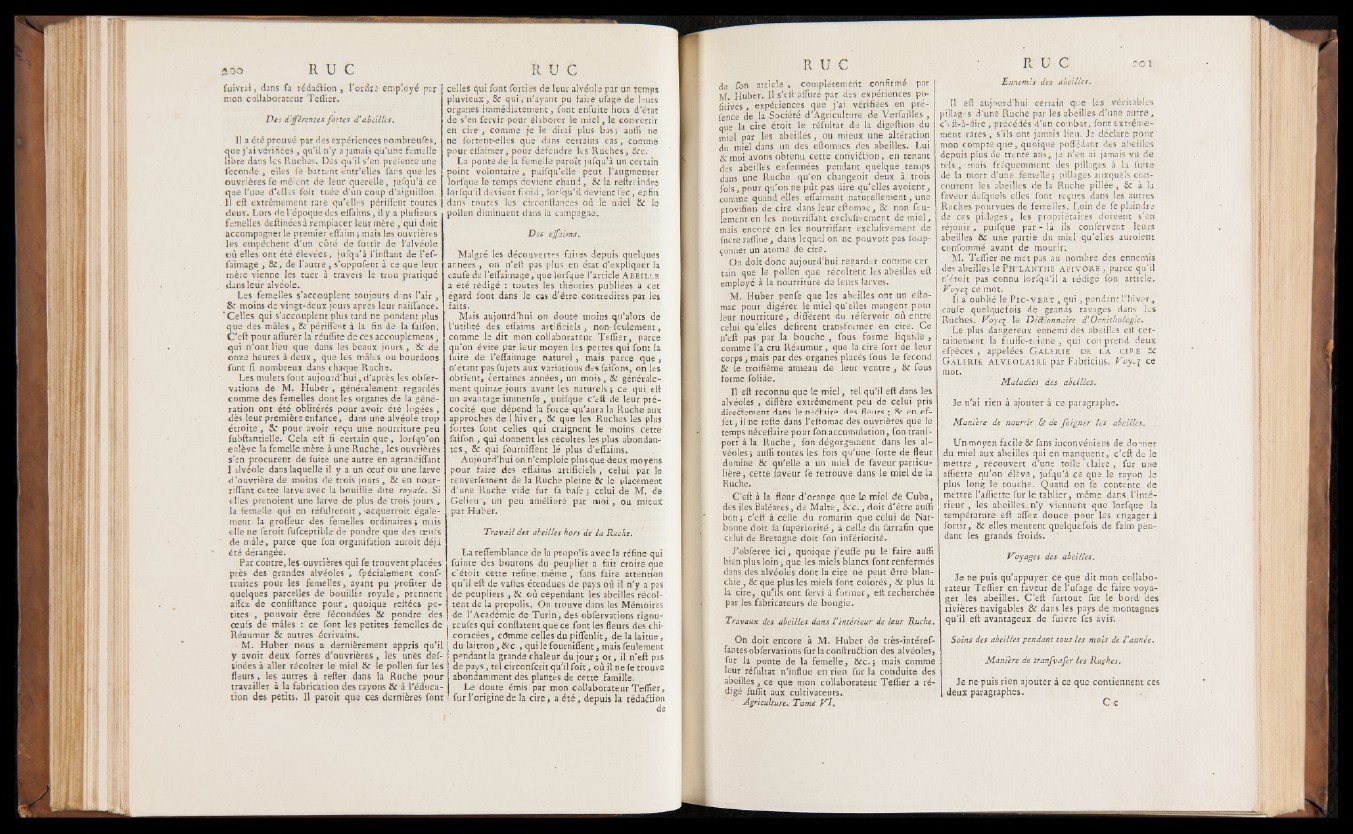
Cuivrai, dans fa rédaétion , l’ordre employé par
mon collaborateur Teflier..
D e s d iffé r en te s f o r t e s <£ a b e i lle s .
Il a été prouvé par des expériences nombreufes,
que j'ai vérifiées , qu'il n'y a jamais qu'une femelle.
libre dans les Ruches. Dès qu'il s'en préfente une
fécondé , elles fe battent entr'elles fans que les
ouvrières fe mêlent de leur querelle, jufqu’à ce
que l'une d'elles foit tuée d’un coup d'aiguillon.
11 eft extrêmement raté qu'elles périfient toutes
deux. Lors de l’époque des eflaims, il y a plufieut s
femelles deftinéesà remplacer leur mère ,‘qui doit
accompagner le premier eflaim j mais les ouvrières
les empêchent d'un côté de fortir de l’alvéole
où elles ont été élevées, jufqu’à.l'inftant de l'ef-
fâitnage , de l'autre, s'oppofent à ce que leur
mère vienne les tuer à travers le trou pratiqué
dans leur alvéole.
Les femelles s’accouplent toujours dans l’air ,■
& moins de vingt-deux jours après leur nàiffance.
‘Celles qui s'accouplent plus tard ne pondent plus
que des mâles , & périfient à la fin de la faifon.
C'eft pour alTurer la réuflite de ces accouplemens,
qui n'ont lieu que dans les beaux jours , & de
onze heures à deux, que les mâles ou bourdons
font fi nombreux dans chaque Ruche.
Les mulets font aujourd'hui, d'après les observations
de M. Huber , généralement regardés,
comme des femelles dont les organes de la génération
ont été oblitérés pour avoir été logées,
dès leur première enfance, dans une alvéole trop
étroite, &: pour avoir reçu une nourriture peu
fubftantielle. Cela eft fi certain que, lorfqu'on
enlève la femelle mère à une Ruche, les ouvrières
s’en procurent de fuite une autre en agrandiffant
1 alvéole dans laquelle il y a un oeuf ou une larve
d'ouvrière de moins de trois jours, & en nour-
rifiant cette larve avec la bouillie dite r o y a le . Si
elles prenoient une larve de plus de trois jours ,
la femelle qui en réfulreroit, »acquerroit également
la grofleur des femelles ordinaires > mais
elle ne feroit fufceptible1 de pondre que des oeufs
de mâle, parce que fon organifation auroit déjà !
été dérangée.
Par contre, les ouvrières qui fe trouvent placées
près des grandes alvéoles , fpécialement conf-
truites pour les femelles, ayant pu profiter de
quelques parcelles de bouillie royale, prennent
allez de confiftance pour, quoique reliées pe-
tites , pouvoir être fécondées & pondre des
oeufs de mâles : ce font les petites femelles de
Réaumur & autres écrivains.
M. Huber nous a dernièrement appris qu'il
y avoir deux fortes d'ouvrières, les unes aef-
tinées à aller récolter le miel & le pollen fur les
fleurs, les autres à relier dans la Ruche pour
travailler à la fabrication des rayons & à l'éducation
des petits. Il paroît que ces dernières font
celles qui font forties de leur alvéole par un temps
pluvieux, & qui j n'ayant pu faire ufage de leurs
organes immédiatement, font en fuite hors d’état
de s’en fervir pour élaborer le miel, le convertir
en cire, comme je le dirai plus bas j aufli ne
ne fortent-elles que dans certains cas, comme
pour elfaimer, pour défendre les Ruches, & c.
La ponte de la femelle paroît jufqu’à un certain
point volontaire, puifqu'elle peut l’augmenter
lorfque le temps devient cfiaud, & la reftreindre
lorfqu'il devient froid, lorfqu’il devient fec, enfin
dans toutes les circonftances où le miel & le
pollen diminuent dans la campagne.
D e s effa im s .
Malgré les découvertes faites depuis quelques
années, on n'eft pas plus en état d’expliquer la
caufe de l’e fiai mage, que lorfque l'article A beille
a été rédigé : toutes les théories publiées à cet
égard font dans le cas d'être contredites par les
faits. Mais aujourd’hui on doute moins qu'alors de
l'utilité des eflaims artificiels, non-feulement,
comme le dit mon collaborateur Tefiier, parce
qu'on évite par leur moyen les pertes qui font la
fuite de l'effaimage naturel, mais parce que,
n'étant pas fujets aux variations des faifons, on les
obtient, certaines années, un mois, & généralement
quinze jours avant les naturels j ce qui eft
un avantage immenfe , puifque c'eft de leur précocité
que dépend la force qu’aura la Ruche aux
approches de 1 hiver, & que les Ruches les plus
fortes font celles qui craignent le moins cette
faifon , qui donnent les récoltes.les plus abondantes,
& qui fourniflent lé plus d’effaims.
Aujourd'hui on n'emploie plus que deux moyens
pour faire des effaims artificiels, celui par le
| renversement de la Ruche pleine & le placement
d’une Ruche vide fur fa bafe ; celui de M. de
Gelieti un peu amélioré par moi, ou mieux
par Huber.
T r a v a i l d es a b e ille s h o r s d e la R u c h e .
La reflemblance de la propolis avec là réfine qui
fuinte des boutons du peuplier a fait croire que
c'étoit cette réfine même , fans faire attention
qu’il eft de vafles étendues de pays où il n'y a pas
de peupliers , & où cependant les abeilles récoltent
de la propolis. On trouve dans les Mémoires
de l'Académie de Turin, des obfervations rigou-
reufes qui conftatent que ce font les fleurs des chî-
coracées, cômme celles du piflenlit, de la laitue ,
du laitron, &c., qui le fourniflent, mais feulement
pendant la grande chaleur du jour; or, il n’eft pas
de pays, tel circonfcrit qu'il foit, où il ne fe trouve
abondamment des. plantes de cette famille.
Le doute émis par mon collaborateur Teflier,
fur l'origine de h cire, a été, depuis la rëdaéliôn
de
R U C
E de fon article , complètement confirmé par - n n em is d e s a b e i lle s .
M. Huber. Il s’eft afluré par des expériences po-
fitives, expériences que j'ai vérifiées en présence
de la Société d’Agriculture de Verfailles ,
que la cire étoit le réfultat de la digeftion du
miel par les abeilles, ou mieux une altération
du miel dans un des eftomacs des abeilles. Lui
& moi avons obtenu cette coriviétion, en tenant
des abeilles enfermées pendant quelque temps
dans une Ruche qu'on changeoit deux à trois
fois, pour qu’on ne pût pas dire qu'elles avoient,
comme quand elles eflaiment naturellement, une
provifion de cire dans leur eftomae, & non feulement
en les nourriffa'nt exclufivement de miel,
mais encore en les nourriflant exclufivement de
fucre raffiné , dans lequel on ne. pouvoit pas foup-
çonner un atome de cire.
On doit donc aujourd'hui regarder comme cer
tain que le pollen que récoltent les abeilles eft
employé à la nourriture de leurs larves.
M. Huber penfe que les abeilles ont un efto-
mac pour digérer le miel qu'elles mangent pour
leur nourriture, différent du réfervoir ou entre
celui qu’elles défirent transformer en cire. Ce
n’eft pas par la bouche, fous forme liquide ,
comme l'a cru Réaumur, que la cire fort de leur
corps, mais par des organes placés fous le fécond
& le troifième anneau de leur ventre, & fous
forme folide.
Il eft reconnu que le miel, tel qu'il eft dans les
alvéoles , diffère extrêmement peu de celui pris
directement dans le neétaire des fleurs ; & en .effet,
il ne refte dans l’eftomac des ouvrières que le
temps néceffaire pour fon accumulation, fon tranf-
port à la Ruche, fon dégorgement dans les alvéoles;
aufli toutes les fois qu'une forte de fleur
domine & qu'elle a un miel de faveur particulière,
cette faveur fe retrouve dans le miel de la
Ruche.
C’eft à la fleur d’orange que le miel de Cuba,
des îles Baléares, de Malte, S c c . , doit d’être aufli
bon ; c'eft à celle du romarin que celui de Narbonne
doit fa fupériorité, à celle du farrafin que
celui de Bretagne doit fon infériorité.
J'obferye ici, quoique j'euffe pu le faire aufli
bien plus loin, que les miels blancs font renfermés
dans des alvéoles dont la cire ne peut être blanchie,
& que plus les miels font colorés, & plus la
la cire, qu'ils ont fervi à former, eft recherchée
par les fabricateurs de bougie.
T r a v a u x d es a b e i lle s d a n s V in t é r ie u r d e leu r R u c h e .
On doit encore à M. Huber de très-intéref-
fantes obfervations fur la conftruCtion des alvéoles,
fur la ponte de la femelle, &c.; mais comme
leur'réfultat n'influe en rien fur la conduite des
abeilles, ce que mon collaborateur Teflier a rédigé
fuffit aux cultivateurs. .
A g r ic u ltu r e . T o m e V I .
Il eft aujourd’hui certain que les véritables
pillage s d’une Ruche par les abeilles d'une autre,
c'eft-à-dire, précédés d'un combat:, font extrêmement
rares, s’ils ont jamais lieu. Je déclare pour
mon compte que, quoique poffedant des abeilles
depuis plus de trente ans, je n'en ai jamais vu de
tels , - mais fréquemment des pillages à la fuite
de la mort d’une femelle ; pillages auxquels, concourent
les abeilles de la Ruche pillée, & à la
faveur defquels elles font reçues dans les autres
Ruches pourvues de femelles. Loin de fe plaindre
ces pillages, les propriétaires doivent s’en
réjouir, puifque par - là ils confervent leurs
abeilles & une partie du miel qu'elles auroient
confomm’é avant de mourir:
M. Teflier ne met pas au nombre des ennemis
des abeilles le Phtlanthe a p ivo r e , parce qu’il
n’étoit pas connu lorfqu’il a rédigé fon article.
V o y e \ ce mot.
11 a oublié le Pic-v e r t , qui, pendant l'hiver,
caufe quelquefois de grands ravages dans les
Ruches. Voyeç le Dictionnaire d ’ Ornithologie.
Le plus dangereux ennemi des abeilles eit certainement
la fauffe-teigne, qui con prend deux
efpèces , appelées Galerie de la cire 6c
Galerie alvéolaire par Fabricius. V o y . i ce
mot.
M a la d i e s d e s a b e i lle s .
Je n’ai rien à ajouter à ce paragraphe.
M a n i è r e d e n o u r r ir & de f o ig n e r l e s a b e i lle s .
Un moyen facile &r fans inconvéniens de donner
du miel aux abeilles qui en manquent, c’eft de le
mettre , recouvert d’une toile claire , fur une
afliette qu’on élève, jufqu’à ce que le rayon le
plus long le touche. Quand on fe contente de
mettre l'afliette fur le tablier, même dans l’intérieur
, les abeilles, n’y viennent que lorfque la
température eft allez douce pour les engager à
fortir, & elles meurent quelquefois de faim pendant
les grands froids.
V o y a g e s d e s a b e i lle s .
Je ne puis qu’appuyer ce que dit mon collaborateur
Teflier en faveur de.l'ufage de faire voyager
les abeilles. C'eft furtout fur le bord des
rivières navigables & dans les pays.de montagnes
qu’il eft avantageux de fuivre fes avis.
S o in s d e s a b e i lle s p en d a n t to u s le s m o i s d e l 'a n n é e .
M a n i è r e d e t r a n jv a fe r l e s R u c h e s .
Je ne puis rien ajouter à ce que contiennent ces
deux paragraphes.
C c
]