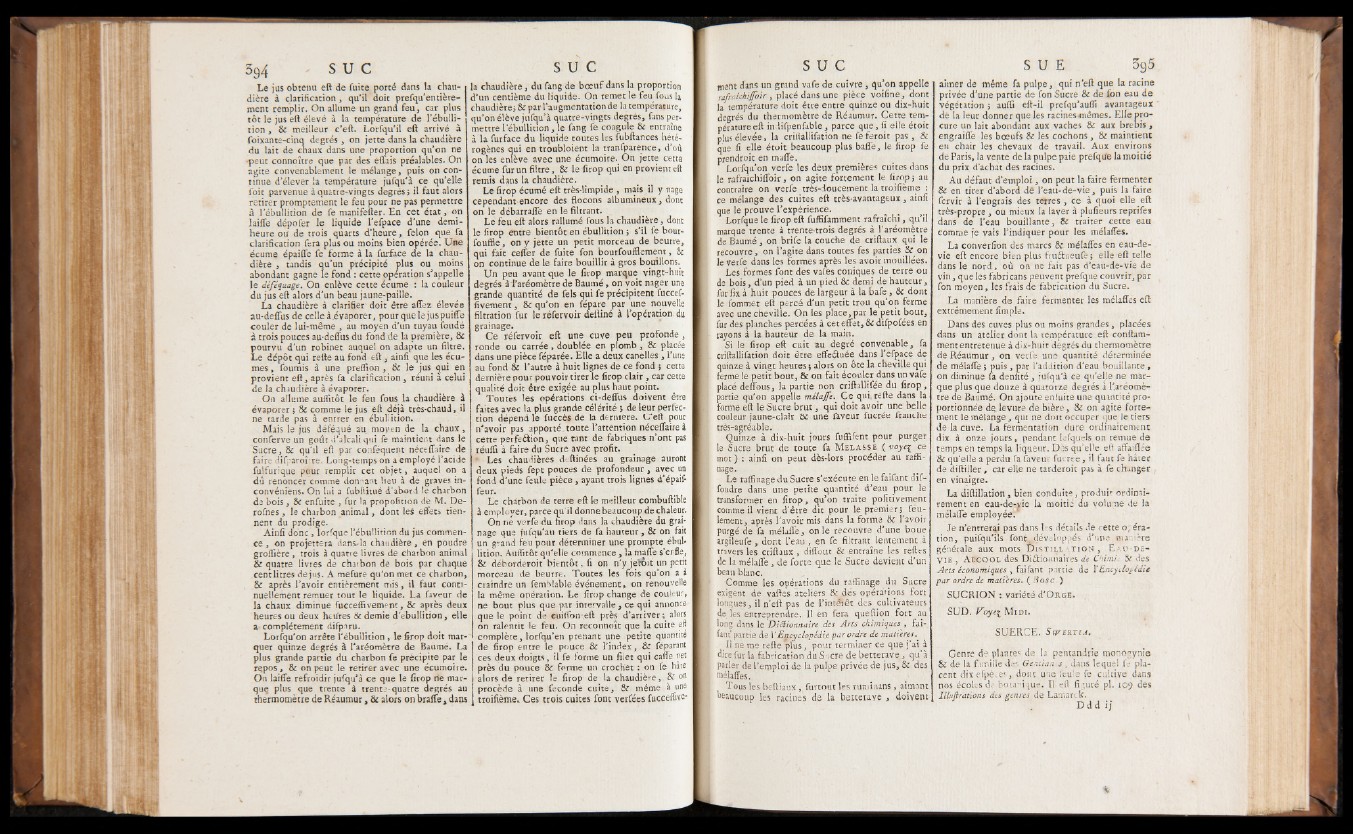
Le jus obtenu eft de fuite porté dans la chaudière
à clarification, qu’ il doit prefqu’entière-
ment remplir. On allume un grand feu, car plus
tôt le jus eft élevé à la température de l’ébullition
, & meilleur c’eft. Lorfqu’il eft arrivé à
foixante-cinq degrés , on jette dans la chaudière
du lait de cnaux dans une proportion qu’on ne
•peut connoître que par des effais préalables. On
agite convenablement le mélange, puis on continue
d’élever la température jufqu’ à ce qu’elle
foit parvenue à quatre-vingts degrés; il faut alors
retirer promptement le feu pour ne pas permettre
à l ’ébullition de fe manifefter. En cet é ta t, on
laiffe dépofer le liquide l’efpace d’une demi-
heure ou de trois quarts d’heure, félon que fa
clarification fera plus ou moins bien opérée. Une
écume épaiffe fe forme à la furface de la chaudière
, tandis qu’ un précipité plus ou moins
abondant gagne le fond : cette operation s’appelle
le déféquage. On enlève cette écume : la couleur j
du jus eft alors d’un beau jaune-paille.
La chaudière à clarifier doit être affez élevée
au-deflus de celle à.évaporer, pour que le juspuiffe
couler de lui-même , au moyen d’ un tuyau foudé
à trois pouces au-deflus du fond de la première, &
pourvu d’un robinet auquel on adapte un filtre.
Le dépôt qui relte au fond e f t , ainfi que les écumes
, fournis à une preflion , & le jus qui en
provient eft, après fa clarification, réuni à celui
de la chaudière à évaporer.
On allume auflitôt le feu fous la chaudière à
évaporer ; & comme le jus eft déjà très-chaud, il
ne tarde pas à entrer en ébullition.
Mais le jus déféqué au moyen de la chaux,
conferve un goût d’alcali qui fe maintient dans le
Sucre, & qu’ il eft par conféquent néceflaire de
faire difparoître. Long-temps on a employé l’ acide
fulfurique pour remplir cet o b je t, auquel on a
dû renoncer comme donnant lieu à de graves in-
convénièns. On lui a fubftitué d’abord le charbon
de bois , & enfuite , fur la propofuion de M. De-
rofnes, le charbon animal, dont les effets tiennent
du prodige.
Ainfi donc, lorfque l’ébullition du jus commenc
e , on projettera dansda chaudière, en poudre
groflière, trois à quatre livres de charbon animal
& quatre livres de charbon de bois par chaque
cent litres de jus. A mefure qu'on met ce charbon,
& après l’avoir entièrement mis, il faut continuellement
remuer tout le liquide. La faveur de
la chaux diminue fucceffivement, & après deux
heures ou deux heures & demie d'ebullition, elle
a complètement difparu.
Lorfqu’on arrête l’ébullition , le firop doit marquer
quinze degrés à l’aréomètre de Baumé. La
plus grande partie du charbon fe précipite par le
repos, & on peut le retirer avec une écumoire.
On laiffe refroidir jufqu*a ce que le firop rie marque
plus que trente à trente-quatre degrés au
thermomètre de Réaumur, & alors on braffe* dans
la chaudière, du fang de boeuf dans la proportion
d’ un centième du liquide. On remet le feu fous la
chaudière^ & par l’augmentation de la température,
qu’on élève jufqu’à quatre-vingts degrés, fans permettre
l'ébullition, le fang fe coagule & entraîne
à la furface du liquide toutes les fubftances hétérogènes
qui en troubloient la tranfparence, d’où
on les enlève avec une écumoire. On jette cette
écume fur un filtre, & le firop qui en provient eft
remis dans la chaudière.
Le firop écumé eft très-limpide , mais il y nage
cependant encore des flocons albumineux, dont
on le débarraffe en le filtrant. _
Le feu eft alors rallumé fous la chaudière, dont
le firop entre bientôt en ébullition ; s’ il fe bour-
fouffle, on y jette un petit morceau de beurre,
qui fait ceffer de fuite fon bourfoufflement, &
on continue de le faire bouillir à gros bouillons.
Un peu avant que le firop marque vingt-huit
degrés à l’aréomètre de Baumé, on voit nager une
grande quantité de fels qui fe précipitent fuccef-
fivement, & qu’on en fépare par une nouvelle
filtration fur le réfervoir deftiné à l’opération- du
grainage.
C e réfervoir eft une cuve peu profonde ,
ronde ou carrée, doublée en plomb, & placée
dans une pièce féparée. Elle a deux canelles , l’une
au fond & l’autre à huit lignes de ce fond ; cette
dernière pour pouvoir tirer le firop clair, car cette
qualité doit être exigée au plus haut point.
Toutes les opérations ci-deffus doivent être
faites avec la plus grande célérité > de leur perfection
dépend le fuccès de la dernière. C ’eft pour
n’ avoir pas apporté.toute l’attention néceflaire à
cette perfection, que tant de fabriques n’ont pas
réufli à faire du Sucre avec profit.
* Les chaudières deftinées au grainage auront
deux pieds fept pouces de profondeur, avec un
fond d’une feule pièce , ayant trois lignes d’ épaif-
feur. •
Le charbon de terre eft le meilleur combuftible
à employer, parce au il donne beaucoup de chaleur.
On ne verfe du firop dans la chaudière du grainage
que jufqu’au tiers de fa hauteur, & on fait
un grand feu pour déterminer une prompte ébullition.
Auflitôt qu’elle commence , la maffe s’erfle,
& déborderoit bientôt, fi on n'y jeîôit un petit
morceau de beurre. Toutes les fois qu’on a à
craindre un femblable événement, on renouvelle
la même opération. Le firop change de couleur,
ne bout plus que par intervalle , ce qui annonce-
que le point de euiflbn-.eft près d’arriver ; alors
on ralentit le feu. On reconnoît que la cuite eft
complète, lorfqu’en prenant une petite quantité
de firop entre le pouce & l’index, & féparant
ces deux doigts, il fe forme un filet qui caffe net
près du pouce & forme un crochet : on fe hâte
alors de retirer le firop de la chaudière, & °n
procède à une fécondé cuite , & même a une
troiftème.. Ces trois cuites font verfées fucceflivement
dans un grand vafe de cuivre, qu*on appelle
rafraîchijfoir , placé dans une pièce voifine, dont
la température doit être entre quinze ou dix-huit
degrés du thermomètre de Réaumur. Cette température
eft indifpenfable, parce que, fi elle étoit
plus élevée, la criliallifation ne feferoit pas , &
que fi elle étoit beaucoup plus baffe, le firop fe
prendroit en maffe.
r Lorfqu’on verfe les deux premières cuites dans
le rafraïchiffoir, on agite fortement le firop ; au
contraire on verfe très-doucement la troifième :
ce mélange des cuites eft très-avantageux, ainfi
que le prouve l’expérience.
Lorfque le firop eft fuffifamment rafraîchi, qu’il
marque trente à trente-trois degrés à l’aréomètre
de Baumé, on brife la couche de criftaux qui le .
recouvre, on l’agite dans toutes fes parties & on
le verfe dans les formes après les avoir mouillées.
Les formes font des vafes coniques de terre ou
de bois, d’un pied à un pied & demi de hauteur,
fur fix à huit pouces de largeur à la bafe, & dont
le fommet eft percé d’ un petit trou qu’on ferme
avec une cheville. On les place, par le petit bout,
fur des planches percées à cet effet, & difpofées en
rayons à la hauteur de la main.
Si le firop eft cuit au degré convenable, fa
criftallifation doit être effectuée dans l’efpace de
quinze à vingt heures ; alors on ôte la cheville qui
ferme le petit bout, & on fait écouler dans un vafe
placé deffous, la partie non criftallifée du firop,
partie qu’on appelle mélajfe. C e qui; refte dans la
forme eft le Sucre b ru t, qui doit avoir une belle
couleur jaune-clair & une faveur fucrée franche
très-agréable.
Quinze à dix-huit jours fuffifent pour purger
le Sucre brut de toute fa Mêlasse ,( voye[ ce
mot ) : ainfi on peut dès-lors procéder au raffinage.
Le raffinage du Sucre s’exécute en Je faifant dif-
foudre dans une petite quantité d’eau pour le
transformer en firop, qu’on traite pofitivement
comme il vient d’être dit pour le premier; féu-
lement, après l’avoir mis dans la forme & l’avoir
purgé de fa mélaffe, on le recouvre d’ une boue
argileufe , dont l’eau , en fe filtrant lentement i
travers les criftaux , diffout & entraîne les reftes
de la mélaffe, de forte que le Sucre devient d’ un
beau blanc.
Comme les opérations du raffinage du Sucre
exigent de vaftes ateliers & dés opérations fort
longues, il n’eft pas de l’intérêt des cultivateurs
de les entreprendre. Il en fera queftion fort au
long dans le DiSbionnaire des Arts chimiques , Faifant
partie de l'Encyclopédie par ordre de matières.
Il ne me refte plus, pour terminer ce que j’ ai à
dire fur la fabrication du Sucre de betterave, qu’à
parler de l’ emploi de la pulpe privée de jus, & des
mélaffes.
Tous les beftiaux, furtout les rutuinans, aimant
beaucoup les racines de la betterave , doivent
aimer de même fa pulpe, qui n'eft que la racine
privée d’une partie de fon Sucre & de fon eau de
végétation ; auffi eft-il prefqu’auffi avantageux
dè la leur donner que les racines .mêmes. Elle procure
un lait abondant aux vaches & aux brebis ,
engraiffe les boeufs & les cochons, & maintient
en chair les chevaux de travail. Aux environs
de Paris, la vepte de la pulpe paie prefqtfe la moitié
du prix d’achat des racines.
Au défaut d’emploi, on peut la faire fermenter
& en tirer d’ abord dé l’eau-de-vie, puis la faire
fervir à l’engrais des terres, ce à quoi elle eft
très-propre, ou mieux la laver à plufieurs reprifes
dans de l’eau bouillante, & traiter cette eau
comme je vais l’indiquer pour les mélaffes.
La converfion des marcs & mélaffes en eau-de-
vie eft encore bien plus fruCtueufe ; elle eft telle
dans le nord, où on ne fait pas d’eau-de-vie de
vin, que les fabricans peuvent prefque couvrir, par
fon moyen, les frais de fabrication du Sucre.
La manière de faire fermenter les mélaffes eft
extrêmement fimple.
Dans des cuves plus ou moins grandes, placées
dans un atelier dont la température eft conftam-
ment entretenue à dix-huit degrés du thermomètre
de Réaumur, on verfe une quantité déterminée
de mélaffe; puis, par l'addition d’eau bouillante,
on diminue fa denfité, jufqu'à ce qu’elle ne marque
plus que douze à quatorze degrés a l’aréomètre
de Baumé. On ajoute enfuite une quantité proportionnée
de. levure de bière, & on agite fortement
le mélange, qui ne doit occuper que le tiers
de la cuve. La fermentation dure ordinairement
dix à onze jours, pendant lefquels on remue de
temps en temps la liqueur. Dès qu’elle eft affaiflée
& qu’elle a perdu fa faveur facrée, il faut fe hâter
de diftiiler, car elle ne tarderoit pas à fe changer
en vinaigre.
La diftillation, bien conduite, produit ordinairement
en eau-de-^/ie la moitié du volume de la
mélaffe employée'.
Je n’entrerai pas dans les détails de cette o; éra-
tion, puifqu’ils font.^développés d’une manière
générale aux mots D i s t il l a t io n , E a u -de-
v ie , A l c o o l des Dictionnaires de Chimie & des
Arts économiques y faifant partie de XEncyclopédie
par ordre de matières. ( S ose.}
SUCRION : variété d’ORGE.
SUD. Voye[ Mid i .
SUERCE. S w er t ia .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
& de la famille des Ge.itians , dans lequel fe placent
dix efpè.es, dont une feule fe cultive dans
nos écoles de botanique. Il eft figuré pl. 109 des
lllufl ratio ns des genres de Lamarck.
D d d i j