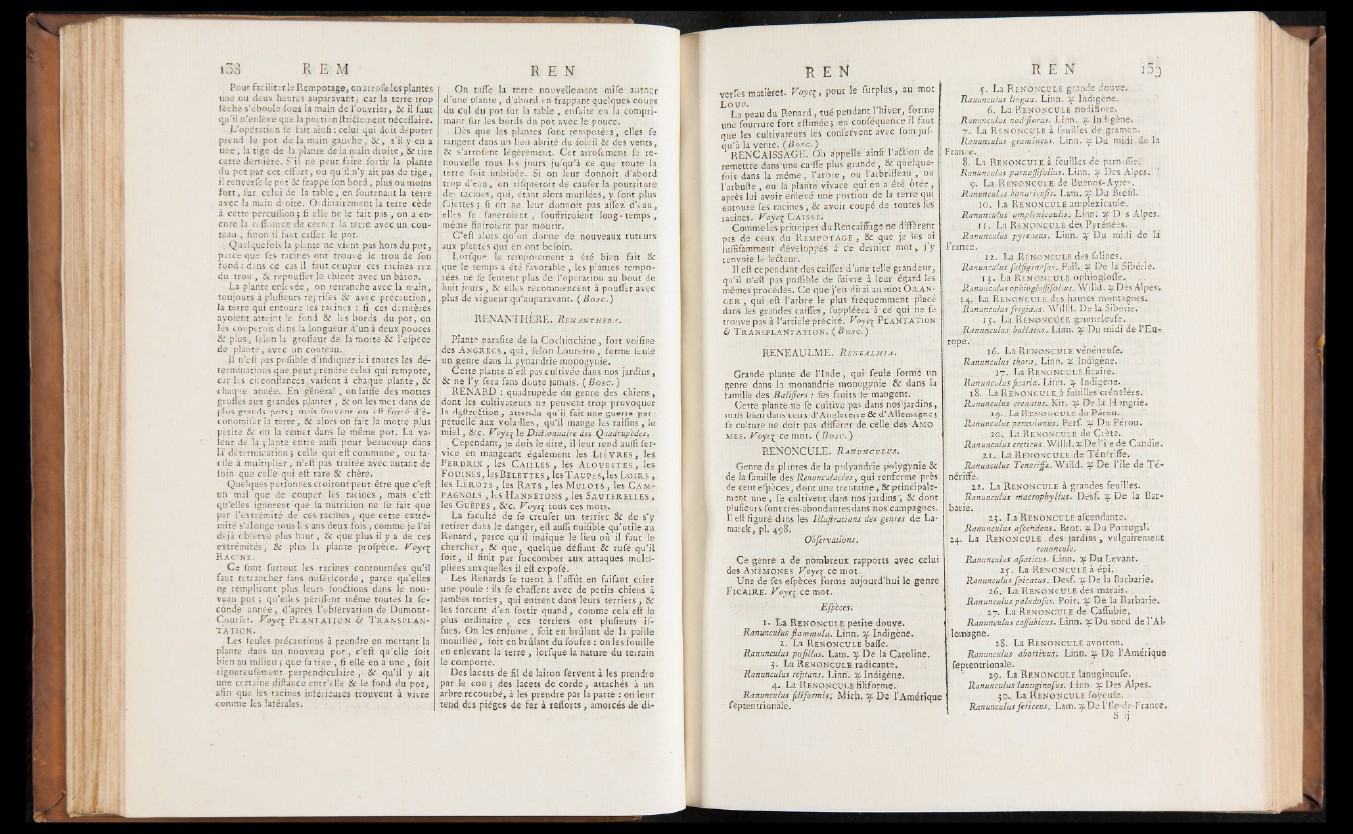
Pour faciliter le Rempotage., oirairofeJes-plantes
une ou deux heures auparavant j car la terre trop
fèche s'éboule fous la main de l'ouvrier, & il faut
qu'il n’enlève que la portionRriéleirienc néceffaire.
L’opération fe fait ainfî : celui qui doit dépoter
prend le pot de la main gauche , &, s’il y en a
une, la tige de la plante de la main droite, & tire
cette dernière. S’il ne peut faire fortir la plante
du pot par cet effort3 ou qu'il n’y ait pas de tige,
il renverfe le pot & frappe fo.n bord, plus ou moins
fort, fur celui de la table, en foutenantla terre
avec la main droite. Oïdinairement la terre cède
à cette percuflion j fi elle ne le fait pas , on a encore
la rt.ffoivrce de cerner la terre avec un couteau
, finon il fautxaffer le pot.
Quelquefois la plante ne vient pas hors du pot,
parce que fes racines ont trouvé le trou de fon
fond : dans ce cas il faut .couper ces racines rez
du trou, & repouffer le chicot avec un bâton.
La plante enlevée, on retranche avec la main,
tpujours à plufieurs reprifes & avec précaution,
la terre qui entoure les racines : fi ces dernières
avoient atteint le fond & les bords du pot, on
les couptroi.t dans la longueur d’un à deux pouc.es,
& plus, félon la groffeur de la motte & l’efpèce
de plante, avec un couteau.
Il n’efî pas poflible d’indiquer ici toutes les déterminations
que peut prendre celui qui rempote,
car les cii confiances , varient à chaque plante, &
chaque année. En générai , on laiffe des mottes
greffes aux grandes plantes, & on les met dans de
plus grands pots 5 mais fou vent on eft forcé d’ë-
conomifer la terre, & alors on fait la motte plus
petite & on la remet dans le même pot. La valeur
de la plante entre auffi pour beaucoup dans
ET détermination 5 celle qui eft commune, ou facile
à multiplier, n’eft pas traitée avec autant de
foin que celle qui eft rare & chère.
Quelques perfonnes croiront peut-être que c’eft
un mal que de couper les racines , mais c’eft
qu’elles ignorent que la nutrition ne fe fait que
par l’extrémité de ces racines, que cette extrémité
s’alonge tous ks ans deux fois, comme je l’ai
déjà cbfervé plus haut, & que plus il y a de ces
extrémités, & plus li plante profpèie. V o y e %
Racine.
Ce font furtout les racines contournées qu’il
faut retrancher fans miférieprde, parce qu’elles
n,e rempliront plus leurs fondions dans le nouveau
pot j qu’elks péri fient même toutes la fécondé
année, d’après l’obferyation de Dumont-
Courfer. Voyei Plantation & T ransplant
a t io n .
Les feules précautions à prendre en mettant la
plante dans un nouveau pot, c’eft qu’elle foit
bien au milieu j que fa tige, fi elle en a une , foit
rigoureufemeot perpendiculaire, & qu’il y ait
une certaine diftance entr’elle & le fond du pot,
afin que les racines inférieures trouvent à vivre
comme les latérales«
On taffe la terre nouvellement mife autour
d’une plante, d'abord eh frappant quelques coups
du cul du pot fur la table , enfuite en la comprimant
fur les bords du pot avec le pouce.
Dès que les plantes font rempotées, elles fe
rangent dans un lieu abrité du -fo lé il & des vents,
,& s’arrofent légèrement. Cet arroftment fe renouvelle
tons ks jours jufqu’à ce que toute la
terre foit imbibée. Si 011 leur donnoit d’abord
trop d’eau, on tifqueroit de caufer la pourriture
des racines, qui, étant alors mutilées, y font plus
fujettes j fi on ne leur donnoit pas allez d’eau,
elles fe faneroient , fouffriroient long-temps,
même finiroient par mourir.
C’eft alors qu’on donne de nouveaux tuteurs
aux plantes qui en ont"befoin.
Lorfque le rempotement a été bien fait &
que le temps a été favorable, les plantes rempotées
ne fe (entent plus de l’opération au bout de
huit jours , & elles recommencent à pouffer avec
plus de vigueur qu’auparavant. ( B o s c . )
RENANTHÈRE. R e n a n t h e r a .
Plante parafite de là Cochinchine, fort voifine
des Angreçs, qui, félon Lqureiro, forme feule
un genre dans la gynandrie mQnogyme.
Cette plante n’eft pas cultivée dans nos jardins,
& ne l’y fera fans doute jamais. ( B o s c . )
RENARD : quadrupède du genre (Jes chiens,
dont les cultivateurs ne peuvent trop provoquer
la d^ftrudUon, attendu qu’il fait une guerre perpétuelle
aux volailles, qu’il mange Jes raifins, le
miel , &.C. oye%_ le D i c t io n n a i r e d es Q u a d ru p è d e s«
s Cependant, je dois le dire, il leur rend aufli fer-
vice en mangeant également les Liè v r e s , les
Pe r d r ix , les C ail l e s , les A louettes, les
Fouines, les Belettes, les T aupes, les Loirs ,
les Lérots , les Rats , les Mulots , les C ampagnols
, ks Hannetons , les Sauterelles ,
les Guêpes , &x. Voye[ tous ces mots.
La faculté de fe creufer un terrier & de s’y
retirer dans le danger, eft aufli nyifible qu’utile au
Renard, parce qu’il indique le lieu où il faut le
chercher, & que, quelque défiant & rufé qu’il
foit, il finit par fuccomber aux attaques multipliées
auxquelles il eft expofé. ;
Les Renards fe tuent a l’affût en faifant crier
une poule : ils fe chaffént avec de petits chiens à
jambe-s torfes, qui entrent dans leurs terriers, &
les forcent d’en fortir quand, comme cela eft le
plus ordinaire , ces terriers ont plufieurs if-
fueSi On les enfume., foit en brûlant de la paille
mouillée, foit en brûlant du foufre : on les fouille
en enlevant la terre, lorfque la nature du terrain
le comporte.
Des lacets de fil de laiton fervent à les prendre
parle cou j .des lacets de corde, attachés à un
arbre recourbé, à les prendre par la patte : on leur
tend des pièges de fer à refforts, amorcés de divertes
matières. Voyej , pour le furplus, au mot
La peau du Renard, tué pendant l'hiver, forme
une fourrure fort eftimée > en conféquehce il faut
que les cultivateurs les confervent avec fonrjuf- |
qu'à la Vente. (B 'o sc .) . . * . ,
R ENCAISSAGE. Oh appelle ainli 1 aétion de
remettre dans'une ca'iîe plus grande, & quelque- s
fois dans ta même, l'arbre, ou l’arbriffeair, ou ;
l'arbufte , ou la planté vivace qui en a été o te e , 1
après lui avoir enlevé unè portion de la tërrerqui :
entoure fes racines, & avoir coupé de toutes fes“ ;
racineis. Voye^ C a is s e ; ^ i
Gommé les principes du Rencaiffage ne diffèrent j
pas de ceux du Rempotage , & que je lès ai >
luffifamthënt développés 1 ce dernier mot, j’y |
renvoie lé lefteurv
Il eft cependant des caiffes-d’une tellé grandeur, j
qu’ il n’eft pas poflible de fuivre à leur égard les j
mêmes procédés. Ce que j’en dirai ait mot O r a n - i
g er , qui eft l’arbre lé plus fréquemment placé
dans les grandes caïffes, fuppîéera à .cë qui ne fe
trouve pas à l’article précité. Voye\ PLaNTATion {
& T ransplantation.. ( B osc.)
RENEAULME. R e n e a lm i a .
Grande plante de l’Inde, qui feule formé un
genre dans la monandrie monogynie & dans la
famille des BaUJîers'r fe’s fruits fe-mangent.
Cette plante nè fé cultive pas dans nos;jardins,
mai$ bien dans ceux d* Angle terre & d’ Allemagne j
fa culture ne doit pas différer de celle' des Amo
MES. Voyeç ce mot. ( Bosc. )
RENONCULE. R anunculus .
Genre de plintes de la polyandrie polygynie &
de la famille des RenoncuUcées3 qui renferme'près
de centefpèces, dont une trentaine, & pfincipale-
ment une , fe cultivent dans nos jardins i & dont
plufieurs font très-abondantes dans nos campagnes.
Il eft figuré dans les lllufirations des genres de La-
marck, pl. 498;
Observations.
Ce-genre a de nombreux rapports avec celui
des Anémones Voye\ ce mot.
Une de fes efpè.ces forme aujourd’hui le genre
Ficaire. Voye^ ce mot.
EJpeceSi
i* La Renoncule petite douve.
Ranunculus flamrnula. Linn. 2j: Indigène.
2. La Renoncule baffe.
Ranunculus pufillus. Lam. of De la'Caroline..
3. La Renoncule radicante.
Ranunculus réptans. Linh. 2f Indigène.
4. La RenoncuJÆ filiforme.
Ranunculus filiformis; Mich. ^ De l'Amérique
' feptenirionâle.
f. La Renoncule grande douve.
R a n u n c u lu s l in g u a . Linn, i f Indigène.
6 . La Renoncule nodiflore.
R a n u n c u lu s n o d lfio r u s . Linn, i f Indigène.
7. La Renoncule à feuilles de gramen.
R a n u n c u lu s g ram iiïe u s , Linn. 2f Du midi de la
France.,
8. La Renoncule, à. feuilles de parn. ffieV
R a n u n c u lu s p a r n a jf ifo liu s . Linn. Tf Des Alpes. ’
9. La Renoncule de Buenoi-Ayre«.
R a n u n c u lu s b o n a r ie n fis . Lam. ^ Du Bcéfil.
10. La Renoncule amplexicaule.
R a n u n c u lu s a m p le x i c a u li s . Linpi 2f D-'S Alpes.
11 . La Renoncule des Pyrihées.
R a n u n c u lu s p y r e n e u s , Linn. sl' Du midi de là
France.
11. La Renoncule des fa lines.
R a n u n cu lu s 'f a l j î g i no f u s , P'à\\. 2c Dé jâ Sibérie.
13. La Renoncule ophiogloffe.
R a n u n c u lu s o p h io g lo jjifo l:u s . ÀVilld. S^Dès Alpesv
,. 14. La Renoncule.des hautes montagnes.
R a n u n c u lu s f r ig id u s . w illd. De la Sibérie.
15. La Renoncule grumeleufe.
R a n u n c u lu s b u lla tu s^.-Lihn, 7f Du midi de l’Europe.
1^. La Renoncule vènéneüfe. .
R a n u n c u lu s 'th o r a . Linn. ^.Indigène.
. 17. La Renoncule ficaire.
R a n u n c u lu s f ic a r ia , Linn. sif Indigène.
18. La RE n OnculéJ- Feüï 1 lés’ crénelées.
R a n u n c u lu s ç r en a tu s . Kit. Sf De là Hongrie.
1.9. La Renoncule du Pérou..
R a n u n c u lu s p e r u y ia n u s . Perf. 7f Du Pérou.
.. 20. Lia .-Renoncule de Crète.
Ra nu n cu .lu 's c reticu's. Willd.2f De l’î:e dé Candie.
21. Là Renoncule de Ténériffe.
R a n u n c u lu s T e n e r ijf s .. Willd;. "if Dé l’ile dé Té-
I nériffe. 22. La Renoncule à grandes feuilles.
R a n u n cu lu s m 'a c r o p h y llu s . Desf. sf De la Bar-
Ibarie.
23. La RENONCULE afcendante.
R a n u n c u lu s a fe e t id e n s . Brot. ^Du Portugil.
I24. La Renoncule des jardins, vulgairement
. r en o n c u le .
R a n u n cu lu s a fia t ic u s . Linn. 2f. Du Levant.
25. La Renoncule à épi.
R a n u n cu lu s f p i c a t u s . Desf. sf De la Barbarie#
26 . La Renoncule des marais.
R a n u n c u lu s p a lu d o fu s . Poir. o f De la Barbarie.
27. La Renoncule de Caffubie.
R a n u n c u lu s c a jfu b icu s . Linn. % Du nord de l'Allemagne.
28. La Renoncule avorton.
R a n u n cu lu s abo rtiv us :. Linn. Of De 1!Amérique
féptêritrionale.
* 29. La Renoncule lanugineufe.
R a n u n c u lu s la n u g in o fu s . L.inh. Of Des Alpes.
30., La Renoncule foÿeufe.
R a n u n c u lu s f e r i ç e u s . Lam.sf De l’Ile-de-France#
S ij