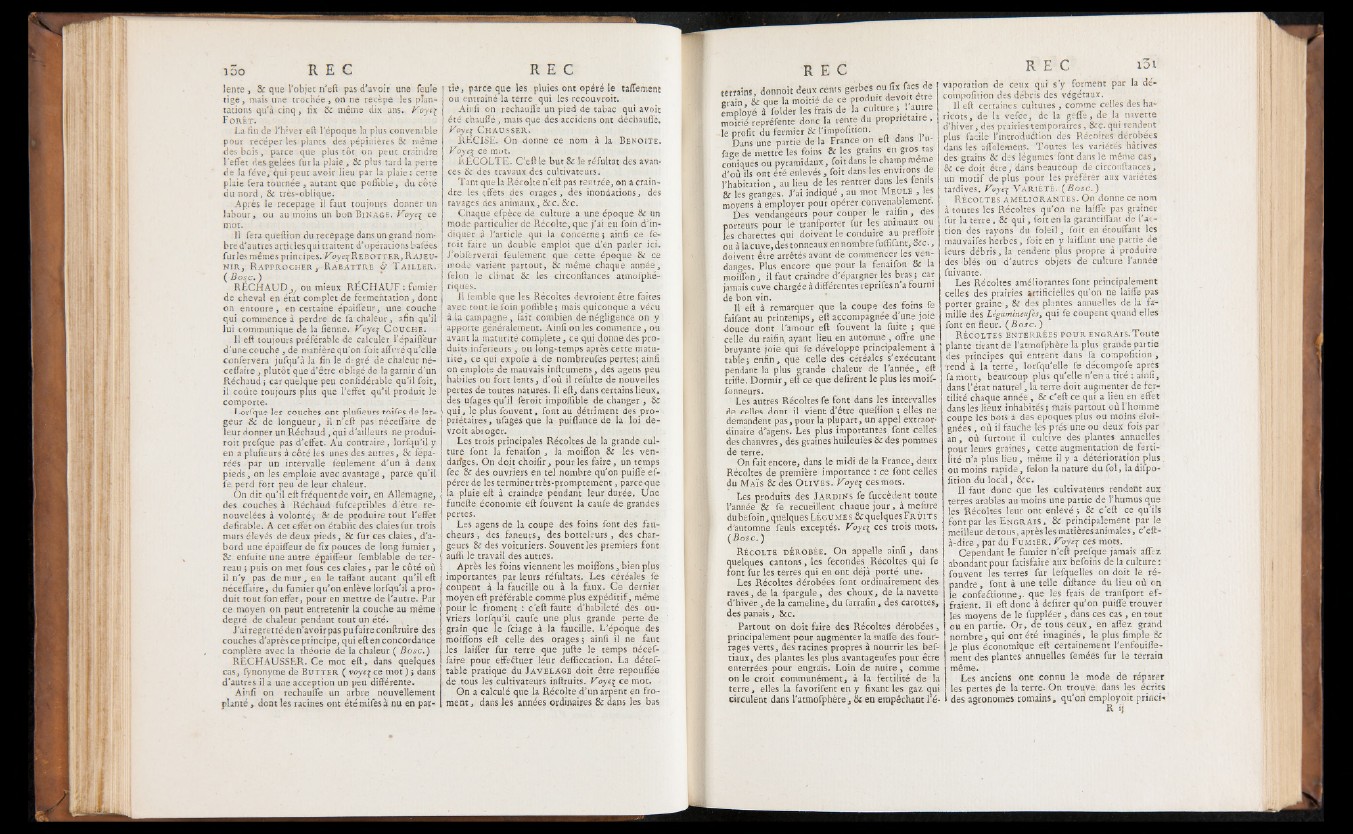
len te } & que l’objet n’eft pas d’avoir une feule
tig e , mais une trochée, on ne recèpe les plantations
qu’à cinq, fix & même dix ans. Voye\
Foret.
La fin de l’hiver eft l’époque la plus convenable
pour recéper les plants des pépinières & même
des bois, parce que plus tôt, on peut craindre
l ’effet des gelées fur la plaie, & plus tard la perte
de la fève, qui peut avoir lieu par la plaie : cette
plaie fera tournée, autant que pofîîble, du côté
du nord, & très-oblique.
Après le recepage il faut toujours donner un
labour, ou au moins un bon Binage. Voye^ ce
mot.
Il fera queftion du recepage dans un grand nombre
d’autres articles qui traitent d’opérations bafées
furies mêmes principes. Voye^Rebotter, Rajeun
ir , Rapprocher Rabattre & T ailler.
( B o se. )
RÉCHAUD 3/ ou mieux RÉCHAUF : fumier
de cheval en état complet de fermentation, dont
on entoure, en certaine épaifleur, une couche
qui commence à perdre de fa chaleur, afin qu’il
lui communique de la fienne. Voyeç C ouche.
Il eft toujours préférable de calculer l’épaiffeur
d’ une couche, de manière qu’on fort affûté qu’elle
confervera jufqu’ à la fin le de gré de chaleur né-
ceflaire, plutôt que d’être obligé de la garnir d'un
Réchaud j car quelque peu confïdérable qu’il foit,
il coûte toujours plus que l’effet qu’ il produit le
comporte.
Lorfque les couches ont plufieurs toifes de largeur
& de longueur, il n’eft pas néceffaire de
leur donner un Réchaud, qui d’ailleurs ne produi-
roit prefque pas d’effet. Au contraire, lorsqu’il y
en a plufieurs à côté les unes des autres, & fépa-
reés par un intervalle feulement d’ un à deux
pieds, on les emploie avec avantage, parce qu’il
fe perd fort peu de leur chaleur.
On dit qu’ il eft fréquentde voir, en Allemagne,
des couches à Réchaud fufceptibles d ’être renouvelées
à volonté^ & de produire tout l’effet
defirable. A cet effet on établit des claies fur trois
murs élevés de deux pieds, & fur ces claies, d’abord
une épaiffeur de fix pouces de long fumier,
& enfuite une autre épaiffeur femblable de terreau
; puis on met fous ces claies, par le côté où
il n’y pas de mur, en le taffant autant qu’il eft
néceffaire, du fumier qu’ on enlève lorfqu’il a produit
tout fon effet, pour en mettre de l’autre. Par
ce moyen on peut entretenir la couche au même
degré de chaleur pendant tout un été.
J’ai regretté de n’avoir pas pu faire conftruire des
couches d’après ce principe, qui eft en concordance
complète avec la théorie de la chaleur ( Bo&Cé}
RECHAUSSER. C e mot e ft, dans quelques
cas, fynonyme de Butter ( voyeçce mot ) ; dans
d’autres il a une acception un peu différente.
Ainfî on réchauffé un arbre nouvellement
planté, dont les racines ont étémifesà nu en pai>
tie , parce que les pluies ont opéré le taffement
ou entraîné la terre qui les recouvroit.
Ainfî on réchauffé un pied de tabac qui avoit
été chauffé, mais que des accidens ont déchauffé.
Voye^ C hausser.
RECISE. On donne ce nom à la Benoîte.
Voyefc ce mot.
RÉ CO LTE . C ’eftle but & le réfultat des avances
& des travaux des cultivateurs.
Tant que la Récolte n’eft pas rentrée, ©n a craindre
les effets des orages, des inondations, des
ravages des animaux, &c. &c.
Chaque efpèce de culture a une époque & un
mode particulier de Récolte, que j’ ai eu foin d’indiquer
à l’article qui la concerne j ainfî ce fe-
roit faire un double emploi que d'en parler ici.
J’obferverai feulement que cette époque & ce
mode varient partout, & même chaque année,
félon le climat & les circonftances atmofphé-
riques.
Il femble que les Récoltes devroient être faites
avec tout le foin poflîble j mais quiconque a vécu
à la campagne, fait combien de négligence on y
apporte généralement. Ainfî on les commence, ou
avant la maturité complète, ce qui donne des produits
inférieurs, ou long-temps après cette maturité,
ce qui expofe à de nombreufes pertes; ainfî
on emploie de mauvais inftrumens, dés agens peu
habiles ou fort lents, d’où il réfulte de nouvelles
pertes de toutes natures. Il eft, dans certains lieux,
des ufages qu’il feroit impoflible de changer , &
q u i, le plus fouvent, font au détriment des propriétaires,
Ufages que la puiffance de la loi de-
vroit abioger.
Les trois principales Récoltes de la grande culture
font la fenaifon , la moiffon & les ven-
darfges. On doit choifir, pour les faire, un temps
fec & des ouvriers en tel nombre qu’ on puiffe ef-
pérer de les terminer très-promptement, pareeque
la pluie eft à craindre pendant leur durée. Une
funefte économie eft fouvent la caufe de grandes
pertes.
Les agens de la coupe des foins font des faucheurs
, des faneurs, des botteleurs, des chargeurs
& des voituriers. Souvent les premiers font
aufli le travail des autres.
Après les foins viennent les moiffons, bien plus
importantes par leurs réfultats. Les céréales fe
coupent à la faucille ou à la faux. Ce dernier
moyen eft préférable comme plus expéditif, même
pour le froment : c ’eft faute d’habileté des ouvriers
lorfqu’il caufe une plus grande perte de
grain que le feiage à la faucille. L’époque des
moiffons eft celle des orages 5 ainfî il ne faut
les laiffer fur terre que jufte le temps néceffaire
pour effectuer leur defliccation. La détectable
pratique du Jayelage doit être repouffée
de tous les cultivateurs inftruits. Voyeç ce mot.
On a calculé que la Récolte d’ un arpent en froment,
dans les années ordinaires & dans les bas
Æ
terrains, donnoit deux cents gerbes ou fix facs de
erain, 8c que la moitié de ce produit devoir etre
employé à fotder les frais de la cultures . autre
mo i t i é repréfente donc la rente du proprietaire,
le profit du fermier 8c l’impofition.
Dans une partie de la France on eft dans 1 u-
fage de mettre les foins 8c les grains en gros tas
coniques ou pyramidaux, foitdans le champmeme
d'où ils ont été enlevés, foit dans les environs de
l’habitation, au lieu de les rentrer dans les ternis
Se les granges. J’ai indiqué , au mot Meule , les
moyens à employer pour operer.convenablement.
Des vendangeurs pour couper le ramn, des
porteurs pour le tranfporter fur les' animaux ou
les charettes qui doivent le conduire au preffoir
ou à la cuve, des tonneaux en nombre fuffifant, 8cc.,
doivent être arrêtés avant de commencer les vendanges.
Plus encore que pour la fenaifon & la
moiffon, il faut craindre d’épargneries bras; car
jamais cuve chargée à différentes reprifes n a fourni
de bon vin.
Il eft à remarquer que la coupe des foins fe
faifantau printemps, eft accompagnée d’une joie
•douce dont l'amour eft fouvent la fuite ; que
celle du taifin, ayant lieu en automne, offre une
bruyante joie qui fe développe principalement à
table; enfin, que celle des céréales s'exécutant
pendant la plus grande chaleur de t’annee, eft
trifle. Dormir, eft ce que défirent le plus les moif-
fonneurs.
Les autres Récoltes fe font dans les intervalles
de celles dont il vient d’être queftion ; elles ne
demandent pas, pour la plupart, un appel extraordinaire
d*agens. Les plus importantes, font celles
des chanvres, des graines huileufes & des pommes
de terre.
On fait encore, dans le midi de la France, deux
Récoltes de première importance : ce font celles
du Maïs 8c des Olives. Voyej- ces mots.
Les produits des Jardins fe fuccèdent toute
l’année 8c fe recueillent chaque jou r , à mefure
dubefoîn, quelques Légumes ècquelques Fruits
d’automne feuls exceptés. Voyei ces trois mots.
(R o s e .)
Récolte dérobée. On appelle ainfî, dans
quelques cantons, ies fécondés Récoltes qui fe
font fur les terres qui en ont déjà porté une.
Les Récoltes dérobées font ordinairement des
raves, de la fpargule, des choux, de la navette
d’hiver, de la cameline, du farrafin, des carottes,
des panais, Sec.
Partout on doit faire des Récoltes dérobées,
principalement pour augmenter la maffe des fourrages
verts, des racines propres à nourrir ies bef-
tiaux, des plantes les plus avantageufes pour être
enterrées pour engrais. Loin de nuire, comme
on le croit communément, à la fertilité de la
terre, elles la favorifent en y fixant les gaz qui
circulent dans l’atmofphère, 8c en empêchant l’évaporation
de ceux qui s'y forment par la dé-
compofition des débris des végétaux.
Il eft certaines cultures, comme celles des haricots,
de la vefee, de la geffe, de la navette
d’hiver, des prairies temporaires, & c . qui rendent
plus facile l’introduéHon des Récoltes dérobées
dans les affolemens. Toutes les variétés hâtives
des grains & des légumes font dans le même cas,
8c ce doit être, dans beaucoup de circonftances ,
un motif de plus pour les préférer aux variétés
tardives. Voye^ VARIÉTÉ. (Rose.)
Récoltes améliorantes. On donne ce nom
à toutes les Récoltes qu’on ne laiffe pas grainer
fur la terre, Se q u i, foit en la garantiffant de l’action
des rayons du fole il, foit en étouffant les
mauvaises herbes, foit en y laiflànt une partie de
leurs débris, la tendent plus propre à produire
des -blés ou d’ autres objets de culture l’année
fuivante.
Les Récoltes améliorantes font principalement
celles des prairies artificielles qu’on ne laiffe pas
porter graine , & des plantes annuelles de la famille
des Légumineufes, qui fe coupent quand elles
font en fleur. (R o ic . )
Récoltes enterrées pour engrais. Toute
plante tirant de l’atmofphère la plus grande partie
des principes qui entrent dans fa compofition ,
Tend à la terre, lorfqu’elle fe décompofe après
fa mort, beaucoup plus qu’elle n’en a tiré ; ainfi,
dans l’état naturel, la terre doit augmenter de fertilité
chaque année, & c’ eft ce qui a lieu en effet
dans les lieux inhabités ; mais partout où l'homme
coupe les bois à des époques plus ou moins éloignées
, où il fauche les prés une ou deux fois par
an, où furtout il cultive des plantes annuelles
pour leurs graines, cette augmentation de fertilité
n‘a plus lieu, même il y a détérioration plus.
ou moins rapide, félon la nature du fo i, la difpo-
fition du local, Sec.
II faut donc que les cultivateurs rendent aux
terres arables au moins une partie de l'humus que
les Récoltes leur ont enlevé ; 8c c'eft ce qu’ils
font par les Engrais, Se principalement p a r le
meilleur de tous, après les matières animales, c’eft-
à-dire, par du Fumier. Voyej ces mots.
Cependant le fumier n'eft prefque jamais affez
abondant pour fatisfaire aux befoins de la culture :
fouvent les terres fur lefquelles on doit le répandre
, font à une telle diftance du lieu où on
le confectionne, que les frais de tranfport e ffraient.
Il eft donc à defîrer qu’ on puiffe trouver
les moyens de le fuppléer, dans ces c a s , en tout
ou en partie. O r , de tous ceux , en affez grand
nombre, qui ont été imaginés, le plus fimple 8c
le plus économique eft certainement l’enfouiffe-
ment des plantes annuelles feméés fur le terrain
même.
Les anciens ont connu le mode de réparer
les pertes (le la terre. On trouve dans les écrits
des agronomes romains, qu’ on employoit princi-
R ij