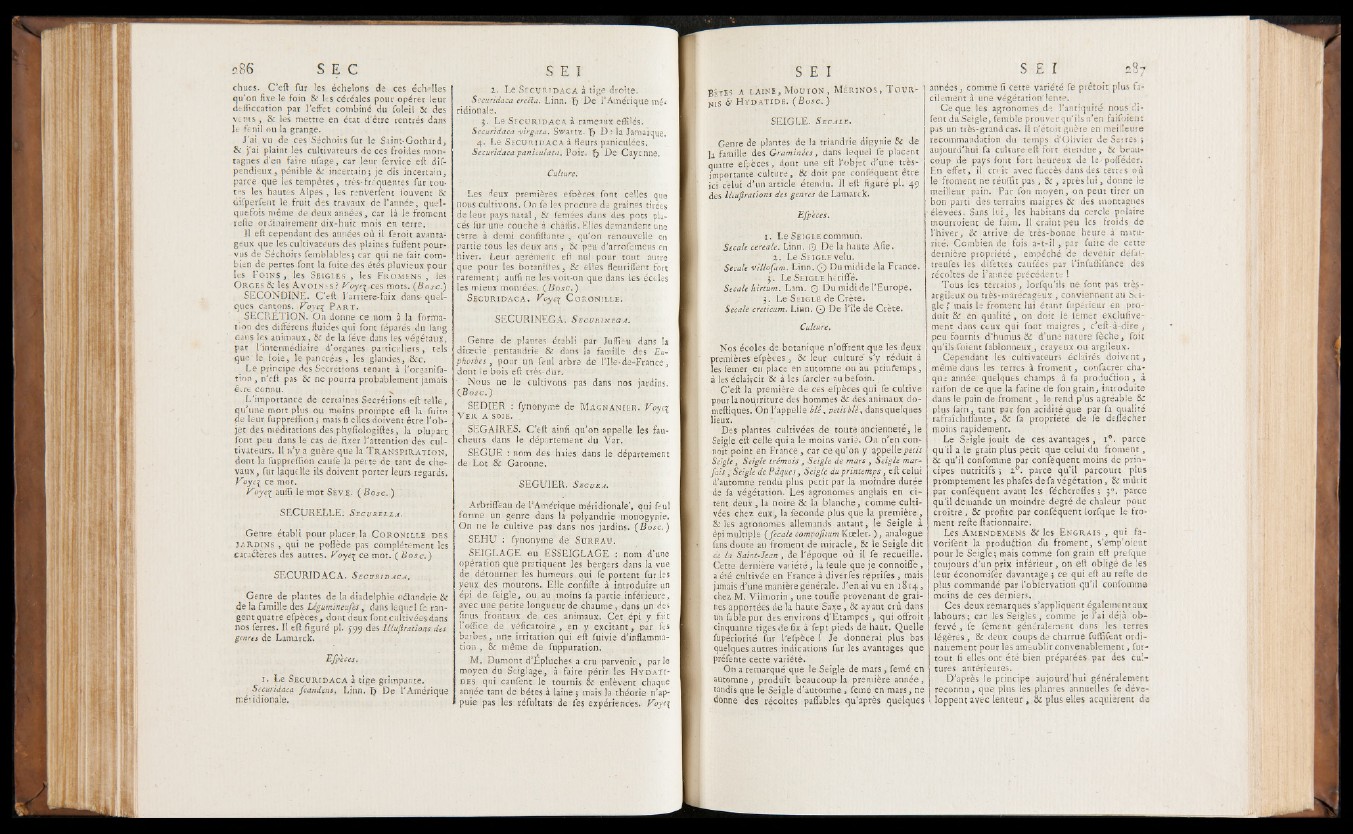
286 S E C
chues. C ’eft fur les échelons de ces échelles
qu’on fixe le foin & les céréales pour opérer leur
deflïccation par l ’effet combiné du foleil & des
v en ts , & les mettre en état d’être rentrés dans
le fenil ou la grange.
J’ai vu de ces Séchoirs fur le Saint-Gothard,
& j'ai plaint lés cultivateurs de ces froides montagnes
d’en faire ufage, car leur fervice eft dispendieux,
pénible & incertainj je dis incertain,
parce que les tempêtes, très-frequentes fur toutes
les hautes Alpes , les renverfent fouvent &
difperfent le fruit des travaux de l’année, quelquefois
même de deux années, car là le froment
refte ordinairement dix-huit mois en terre.
Il eft cependant des années où il feroit avantageux
que les cultivateurs des plaines fuflent pour*,
vus de Séchoirs Semblables} car qui ne fair combien
de pertes font là fuite des étés pluvieux pour
les Foins, les Seigles, les Eromens , les
Orges & les Avoines? Voye^ ces mots. (Bose.)
SECONDINE. C ’eft l’arrière-faix dans- quelques
cantons. P^oyeç Part.
SECRETION. On donne ce nom à la formation
des différens fluides qui font Séparés du fang
dans les animaux-, & de la fève dans les végétaux,
par l ’intermédiaire d’organes particuliers, tels
que le foie, le pancréas , les glandes, &c.
Le principe des Secrétions tenant à l’organifa-
tion, n’éft pas & ne pourra probablement jamais
êire connu. N
L ’importance de certaines Secrétions eft telle,
qu’une mort plus ou moins prompte eft la fuite
de leur fuppreflion ; mais fi elles doivent être l’objet
des méditations des, phyfiologiftes, la plupart
font peu dans le cas de fixer l’attention des cultivateurs.
Il n’y a guère que la Transpiration,
dont la fuppreflion caufe la perte de tant de chevaux,
fur laquelle ils doivent porter leurs regards.
Koye[ ce mot.
Koye^ aufïi le mot SÈVE. ( Bôsc. )
SECURELLE. S e c ur e l l a .
Genre établi pour placer la Coronille des
jardins , qui ne poflède pas complètement les
caractères des autres. Voye% ce mot. ( B osc. )
SE CURIDACA. S e c ur id a c a ,
Genre de plantes de la diadelphie oCtandrïe &
de la famille des Légumineufes3 dans lequel fe rangent
quatre efpèces, dont deux font cultivées dans
nos ferres. Il eft figuré pi. 599 des illuflraùons des
genres de Lamarck.
Efpeces.
1. Le Securidaca à tige grimpante.
Securidaca feandens. Linn. T? De l’Amérique
méridionale.
S E I
2. Le Securidaca à tige droite.
Securidaca e réel a. Linn. T) De l’Amérique mé«
ridionale.
3. Le Securidaca à rameaux effilés.
Securidaca virgata. Swartz. D î la Jamaïque.
4. Le Securidaca à fleurs paniculées.
Securidacapaniculata. Poir. Jj De Cayenne.
Culture.
Les deux premières efpèces font celles que
nous cultivons. On fe les procure de graines tirées
de leur pays natal, & femées dans des pots placés
fur une couche à châffis. Elles demandent une
terre à demi confiftante , qu’on renouvelle en
partie tous les deux ans , .& peu d’arrofemens en
hiver. Leur agrément eft nul pour tout autre
que pour les botaniftes, & elles fleuri fient fort
rarement} aufii ne les voit-on que dans les écoles
les mieux montées. (B o s c .)
Securidaca, Voye\ C oronille.
SECURINEGA. S e cur ik eg a .
Genre de plantes établi par Juffieu dans la
dioecie pentandrîë & dans la famille des Euphories
, pour un feu! arbre de l’Ile-de-France,
dont le bois eft très-dur.
Nous ne le cultivons pas dans nos jardins.
(Bosc.)'
SEDIER : fynônyme de Magnanier. Voye\
Ver a s o i e . ,
SEGAIRES. C ’eft ainfi qu’on appelle les faucheurs
dans le département du Var.
SEGUE : nom des haies dans le département
de Lot & Garonne.
SEGUIER. S egura.
Arbrifieau de l’Amérique méridionale', qui feul
forme un genre dans la polyandrie monogynie.
On ne le cultive pas dans nos jardins. (B o s c .)
SEHU : fynônyme de Sureau.
SEIGLAGE eu ËSSEIGLAGE : nom d’une
opération que pratiquent les bergers dans la vue
de détourner les humeurs, qui fe portent fur ies
yeux des moutons. Elle confifle à introduire un
épi de feigle, ou au moins fa partie inférieure,
avec une petite longueur de chaume , dans un des
fi nus frontaux de. ces animaux. Cet épi y fait
l’ office de yéficatoire , en y excitant, par fts
barbes, une irritation qui eft fuivie d’inflammation
, & même de fuppuration.
M. Dumont d’Epluches a cru parvenir, par le
moyen du Seiglage, à faire périr les Hydati-
des qui caufent le tournis & enlèvent chaque
année tant de bêtes à laine} mais la théorie n’appuie
pas les réfultats de fes expériences. | p
S E I
Bêtes A laine, Mouton, Mérinos, T ournis
& H y d a t i d e . ( B osc. )
SEIGLE. S ec a l e .
Genre de plantes de la triandrie digynie & de
la famille des Graminées, dans lequel fe placent
quatre efpèces, dont une eft l’objet d’une très-
importante culture, & doit par conféquent être
ici celui d’un article étendu. Il eft figuré pl. 49
des Ihufirations des genres de Lamarck.
■ Efpeces.
1. Le Seigle commun.
Secale cereale. Linn. 0 De la haute Afie.
2. Le S eigle velu.
Secale villofum. Linn. © Du midi de la France.
3. Le Seigle hériffé.
Secale hirtum: Lam. O Du midi de l’Europe.
3. Le Seigle de Crète.
Secale creticum. Liian. © De l’île de Crète.
Culture.
Nos écoles de botanique n’offrent que les deux
premières efpèces, & leur culture s’y réduit à
les femer en place en automne ou au prinfemps,
à les éclaircir & à les farder au befoin.,
C ’eft la première de ces efpèces qui fe cultive
pour lanoütriture des hommes & des animaux do-
meftiques. On l’appelle blé, petit blé, dans quelques
lieux.
Des plantes cultivées de toute ancienneté, le j
Seigle eft celle qui a le moins varié. On n’en con-
noît point en France, car ce qu’on y appelle petit
Seigle y Seigle trémois y Seigle de mars , Seigle mar-
fais y Seigle de Pâques , Seigle du printemps y eft celui
d’automne rendu plus petit par la moindre durée
de fa végétation. Les agronomes anglais en citent
deux, la noire & la blanche, comme cultivées
chez eux, la fécondé plus que la première,
& les agronomes allemands autant, le Seigle à
épi multiple (fecale compojttum Koeler- ) , analogue
fans doute au froment de miracle, & le Seigle dit
de là Saint-Jean, de l’époque où il fe recueille.
Cette dernière variété, la feule que je connoifle,
a été cultivée en France à diverfes reprifes, mais
jamais d’ une manière générale. J’en ai vu en iS 14,
chez M. Vilmorin, une touffe provenant de graines
apportées de la haute Saxe, & ayant crû dans
un fable pur des environs d’Etampes , qui offroit
cinquante tiges de fix à fept pieds dë haut. Quelle
fupériorité fur l’efpèce ! Je donnerai plus bas
quelques autres indications fur les avantages que
préfente cette variété/
On a remarqué que le Seigle de mars, femé en
automne , produit beaucoup la première année,
tandis que lé Seigle d’automne, femé en mars, ne
donne des récoltes pafiables qu’après quelques
S E I 287
années, comme fi cette variété fe puêtoit plus facilement
à une végétation'lente.
C e que les agronomes .de l'antiquité nous di-
fent du Seigle, femble prouver qu’ ils n’ en faifoien:
pas un très-grand cas. Il n’étoit guère en meilleure
recommandation du temps d’Olivier de Ses res }
aujourd’hui fa culture eft fort étendue, £k beaucoup
de pays font fort heureux de le/pofleder.
En effet, il croît avec fuccès dans des terres où
le froment ne réufiît pas, & , après lu i, donne le
meilleur pain. Par fon moyen, on peut tirer un
bon parti des terrains maigres & des montagnes
élevées. Sans lui, les habitans du cercle polaire
mourroient de faim. Il craint peu lés froids de
l’hiver, & arrive de très-bonne'heure à maturité.
Combien de fois a - t - i l, par fuite de cette
dernière propriété, empêché de devenir défaf-
treufes les difettes caufées par l’infuffifance des
récoltes de l’année précédente 1
Tous les terrains , lorfqu’ils ne font pas trè$-
argileux ou très-marécageux , conviennent au Seigle
} mais le froment lui étant fupérieur en produit
& en qualité , on doit le femer exclusive- .
ment dans ceux qui font maigres, c’eft-à-dire ,
peu fournis d'humus & d’ une nature fèche, foie
qu’ils foient fablonneux., crayeux ou argileux.
Cependant les cultivateurs éclairés doivent,
même dans les terres à froment, confacrer chaque
année quelques champs à fa production, à
railon de ce que la farine de fon grain, introduite
dans le pain de froment, le rend p’us agréable &r
plus fain, tant par fon acidité que par fa qualité
rafraîchifiante, & fa propriété de fe de flécher
moins rapidement.
Le Seigle jouit de ces avantages , 1®. parce
qu'il a le grain plus petit que celui du froment,
& qu’il confomme par conféquent moins de principes
nutritifs } 2°. parce qu’ il parcourt plus
promptement les phafes de fa végétation, & mûrit
par conféquent avant les fécherefles ; 3?. parce
qu’il demande un moindre degré de chaleur pour
croître, & profite par conféquent lorfque le froment
refte ftationnaire.
Les Amendemens & les Engrais, qui fa-
vorifent la production (Tu froment, s'emploient
pour le Seigle; mais comme fon grain eft prefque
toujours d’un prix inférieur, on eft obligé de les
leur économifer davantage ; ce qui eft au refte de
plus commandé par l’oblérvation qu’il confomme
moins de ces derniers.
Ces deux remarques s’appliquent également aux
labours; car les Seigles, comme je i’ ai déjà ob-
fe rv é , fe fèment généralement dans les terres
légères , & deux coups de charrue fuffifent ordinairement
pour les ameublir convenablement, fur-
tout fi elles ont été bien préparées par des Cultures
antérieures.
D’après le principe aujourd’hui généralement
reconnu, que plus les plantes annuelles fe développent
avec lenteur, & plus elles acquièrent de