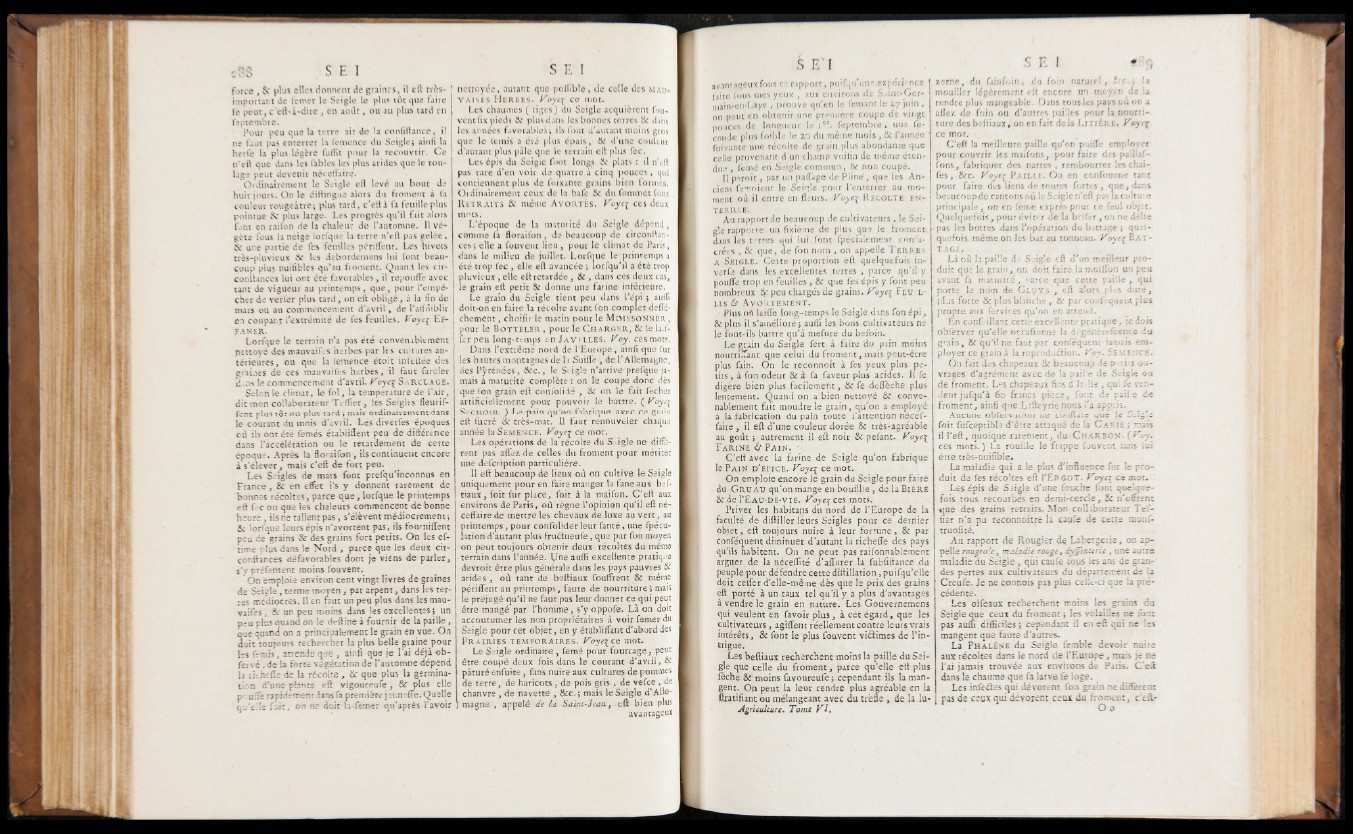
farce , plus elles donnent de graines, il efl très-
important de femer le Seigle le plus tôt que faire
le peut, c eft-à-dire, en août, ou au plus tard en
fîptembre.
Pour peu que la terre ait de la conliftance, il
ne faut pas enterrer la lemence du Seigle $ ainfi la
herfe la plus légère fuflfit pour la recouvrir. Ce
n'eft que dans les fables les plus arides que le roulage
peut devenir nécetfaire.
Ordinairement le Seigle eft levé au bout de
huit jours. On le diftingue alors du froment à fa
couleur rougeâtre; plus tard, c'eft à fa feuille plus
pointue & plus large. Les progrès qu'il fait alors
font en raifon de la chaleur de l'automne. Il végète
fous la neige lorfque la terre n’ eft pas gelée,
& une partie de fes feuilles péri tient. Les hivers
très-pluvieux & les debordemens lui font beaucoup
plus nuifibles qu'au fi ornent. Quand les cir-
conlhnces lui ont été favorables, il re pou fie avec
tant de vigueur au printemps, que, pour l'empêcher
de verfer plus tard, on eft oblige, à la fin de
mars ou au commencement d'avril, de l'affôiblir
en coupant l'extrémité de fes feuilles. Koy*i £f-
FANER.
Lorfque le terrain n'a pas été convenablement
nettoyé des mauvaifes herbes par les cultures antérieures,
ou que la lemence étoit inletiée des
graines de ces mauvaifes herbes, il faut farder
le commencement d'avril. K byeç S a r c l a g e .
Selon le climat, le fo l, la température de l'air,
dit mon collaborateur. Teffier , les Seigles fleurif-
fent plus tôt ou plus tard -, mais ordinairement dans
le courant du mois d'avril. Les diverfes époques
où ils ont été femés établiffent peu de différence
dans l'accélération ou le retardement de cette
époque. Après la floraifon, ils continuent encore
à s'élever, mais c ’eft de fort peu.
Les Seigles de mars font prefqu'in connus en
France, & en effet ils y donnent rarement de
bonnes récoltes, parce q u e , lorfque le printemps
eft fec ou que les chaleurs commencent de bonne
heure, ils ne tallentpas, s'élèvent médiocrement;
8: lorfque leurs épis n'avortent pas, ils fourniffent
peu de grains & des grains fort petits. On les ef-
time plus dans le Nord , parce que les deux cir-
conftances défavorables dont je viens de parler,
s y préfement moins fouveet.
On emploie environ cent vingt livres de graines
de Seigle, terme moyen, par arpent, dans les terres
médiocres. Il en faut un peu plus dans les mauvaifes,
& un peu moins dans les excellentes; un
peu plus quand on le deftine à fournir de la paille,
que quand on a principalement le grain en vue. On
doit toujours rechercher la plus belle graine pour
les femis, attendu que , ainfi que je 1 ai déjà ob-
fe rv é , de la forte végétation de l'automne dépend
la richeffe de la récolte , Se que plus la germination
d'une plante eft vigoureufe, & plus elle
pcuiTe rapidement dans fa première jeuneffe. Quelle
cm'effe fort, on ne doit la .femer qu'après l'avoir
nettoyée, autant que poflible, de celle des mauv
a is e s Herbes. Koye\ ce mot.
Les chaumes ( tiges) du Seigle acquièrent (cuvent
fix pieds Se plus dans les bonnes terres & dans
les années favorables ; ils font d'autant moins gros
que le lemis a été plus épais, & d'une couleur
d'autant plus pâle que le terrain eft plus fec.
Les épis du Seigle font longs & plats : il n’eft
pas rare d'en voir ds quatre à cinq pouces, qui
contiennent plus de foixanee grains bien formés.
Ordinairement ceux de la bafe & du fommet (ont
R e t r a it s & même A v o r t é s . Koye^ ces deux
mots.
L'époque de la maturité du Seigle dépend,
comme fa floraifon, de beaucoup de circonftan-
ces; elle a fouvent lieu, pour le climat de Paris,
dans le milieu de juillet. Lorfque le printemps a
été trop fe c , elle eft avancée ; lorfqu’il a été trop
pluvieux, elle eft retardée, S e , dans ces deux tas,
le grain eft petit Se donne une farine inférieure.
Le grain du Seigle tient peu dans l'épi ; aufli
doit-on en faire la récoire avant fon complet deffé-
chement, choifir le matin pour le Moissonner,
pour le Botteler , pour le C har ge r , Se le biffer
peu long-temps en Javi-lles. Koy. ces mots.
Dans l'extrême nord de l'Europe, ainfi que fur
les hautes montagnes de h Suifl'e, de l’Allemagne,
! des Pyrénées, Sec., le Seigle n'arrive prefque jamais
à maturité complète : on le coupe donc dès
j que fon grain eft consolidé , & on le fait fécher
artificiellement pour pouvoir le battre. ( Koyqr
Séchoir. ) Le pain qu'on fabrique avec ce grain
eft fucré Se très-mat. Il faut renouveler chaque
année la Semence. Koyeç ce mot.
Les opérations de la récolte du S=igle ne diffèrent
pas allez de celles du froment pour mériter
une defeription particulière.
Il eft beaucoup de lieux où on cultive le Seigle
uniquement pour en faire manger la fane-au-x bef-
tiaux, foit fur place, foit à la maifon. C e f t aux
environs de Paris, où règne l’opinion qu’il eft né-
ceffairede mettre les chevaux de luxe au v ert, au
printemps, pour confolider leur fanté, une fpécu-
lation d’autant plus fru&ueufe, que par fon moyen
on peut toujours obtenir deux récoltes du même
terrain dans l'année. Une aufli excellente pratique
devroit être plus générale dans les pays pauvres &
arides, où tant de bsftiaux fouffrent & même
périffent au printemps, faute de nourriture; mais
le préjugé qu'il ne faut pas leur donner ce qui peut
être mangé par l’homme, s'y oppofe. Là on doit
accoutumer les non propriétaires à voir femer du
Seigle pour cet objet, en y établi (Tant d'abord des
Prairies temporaires. Koye^ce mot.
Le Seigle ordinaire, feras pour fourrage, peut
être coupé deux fois dans le courant d'avril, &
pâturé enfuite, fans nuire aux cultures de pommes
de terre, de haricots, de pois gris , de ve fe e , de
chanvre, de navette , & c .; mais le Seigle d'Alle-
] magne , appelé de la Sai/u-Jean, .eft bien plus
avantageux
avantageux fous ce rapport, puifqu'un? expérience
faite Cous mes yeux , aux environs de Sfinr-Ger-
niain-en-Laye , prouve qu'en le feinant le 27 juin,
on petit en obtenir une première coupe de vingt
pouces de longueur le 1cr. feptembre, une fécondé
plus foible le 2.0 du même mois , Se l'année
fuivance une récolte de grain plus abondance que
celle provenant d'un champ voilin de même étendue
, femé en Seigle commun, Se non coupé.
Il paroîc, par un paffage de Pline', que les Anciens
fe-noient le Seigle pour l'enterrer au moment
où il entre en fleurs- Voye£ Récolté en-
TERREE.
Au rapport de beaucoup de cultivateurs, le Seigle
rapporte un fixîème de plus que le froment
dans les terres qui lui font fpéciaiemenc consacrées
, Se que, de fon nom , on appelle T erres
a Seigle. Cette proportion eft quelquefois in-
verfe dans les excellentes terres , parce qu'il y
pouffe trop en feuilles, Se que fes épis y font peu
nombreux Sf. peu chargés de grains. Koye{ Feu . l -
les & A v o r t em e n t .
■ plus oA laiffe long-temps le Seigle dans fon épi,
& plus il s'améliore ; aufli les bons cultivateurs ne
le font-ils battre qu'à mefure du befoin.
Le grain du Seigle fert à faire du pain moins
nourri,Tant que celui du froment, mais peut-être
plus fain. On le reconnoît à fes yeux plus petits
, à fon odeur & à fa faveur plus acides. Il fe
digère bien plus facilement, Se fe deffèche plus
lentement. Quand on a bien nettoyé Se convenablement
fait moudre le grain, qu'on a employé
à la fabrication du pain toute l'attention nécef-
faire, il eft d'une couleur dorée & très-agréabie
au goût ; autrement il eft noir Se pefant. Koye%
Farine & Pa in . -
C ’eft avec la farine de Seigle qu’on fabrique
le Pa in d'épice. Koye[ ce mot.
On emploie encore le grain du Seigle pour faire
du G r u a u qu’on mange en bouillie, de la Bière
& de l'EAu-DE-viE. Voyei ces mots.
Priver les habitans du nord de l'Europe de la
fa.culté de diftiller leurs Seigles pour ce dernier
objet, eft toujours nuire à leur fortune, & par
conféquent diminuer d'autant laricheffe des pays
qu’ils habitent. On ne peut pas raifonnabîement
arguer de la néceffité d’affurer la fubliftance du
peuple pour défendre cette diftillation, puifqu’elle
doit ceffer d’elle-même dès que le prix des grains
eft porté à un taux tel qu’il y a plus d'avantages
à vendre le grain en nature. Les Gouvernemens
qui veulent en favoir plus, à cet égard, que les
cultivateurs, agiffenc réellement contre leurs vrais
intérêts, & font le plus fouvent vi&imes de l'intrigue.
Les beftiaux recherchent moins la paille du Seigle
que celle du froment, parce qu’elle eft plus
fèche Se moins favoureufe ; cependant ils la mangent.
On peut la leur rendre plus agréable en la
gratifiant ou mélangeant avec du trèfle , de la lu*
Agriculture. Tome K l.
z e tn e , du faiufoin, du foin naturel, t ic ; h
mouiller légèrement eft encore un moyen de la
rendre plus mangeable. Dans tous les pays ou on a
allez de foin ou d'autres pailles pour la nourriture
des beftiaux, on en fait delà Lit iè r e . Koye£
ce mot,
C'elt la meilleure paille qu'on puiffe employer
pour couvrir les mai fon s , pour faire des pailiaf-
fons, fabriquer des nattes, rembourrer les chaires
, Sec. Voye\ Pa il l e . On en cohfomme tant
pour faire des liens de toutes fortes , que, dans
beaucoup de cantons où le Seigle n'eft pas la culture
principale, on en lème exprès pour ce feu! objst.
Quelquefois, pour éviter de la b r iftr , on ne délie
• pas les bottes dans l’opération du battage ; quelquefois.
même on les bat au tonneau. K o y e Ba t tage,
Là où h paille de Seigle eft d'un meilleur produit
que le grain, on doit faire la moiffon un peu
avant fa maturité, parce que cette p aille , qui
porte le nom de G lu y 5 , eft alors plus dure,
pi as forte & plus blanche, Se par conféquent plus
propre aux fer vices qu'on en attend.
En confi illant cette excellente pratique, je dois
obferver qu’elle occafionne la dégénérefcence du
g’-ain, & qu'il ne faut par conféquent jamais employer
ce grain à la reproduction. Koy. Sem enc e.
On fait des chapeaux & beaucoup de p-'i'S ouvrages
d’agrément avec de la paire de Seigle ou
de froment. Les chapeaux fins d 'h l i e , qui fe vendent
jufqu’à 60 francs pièce, font de pallie de
froment, ainfi que Lifteyrie nous l'a appris.
Aucune obfervation ne conftate que le Seigle
foit fufceptible d'être attaqué de la C a r ie ; mais
il l'eft, quoique rarement, du C h a r b o n - fKoy.
ces mots. ) La rouille le frappe fou vent lacs lui
être très-nuifible.
La maladie qui a le plus d’influence fur le produit
de fes récoltes eft I'Ergot. Koye% ce mot.
Les épis de Seigle d’ une fouche font quelquefois
tous recourbés en derai-cercle, & n'offrent
que des grains retraits. Mon collaborateur T e f-
fier n'a pu reconnoître la caufe de cette moaf-
truofiié.
Au rapport de Rougier de Labergeris, on appelle
rougeole, maladie rouge, dysenterie , une autre
maladie du S eigle, qui caufe tous les ans de grandes
pertes aux cultivateurs du département de la
Creufe. Je ne connois pas plus celît-ci que la précédente.
Les oifeaux recherchent moins les grains du
Seigle que ceux du froment ; les volailles ne font
pas auffi difficiles ; cependant il en eft qui ne les
mangent que faute d'autres.
La Phalène du Seigle femble devoir nuire
aux récoltes dans le nord de l’Europe, mais je ne
l ’ai jamais trouvée aux environs de Paris. C ’eft
dans le chaume que fa larve fe loge.
Les infeétes qui dévorent fon grain ne diffèrent
[ pas de ceux qui dévorent ceux du froment, c'eli-
O o