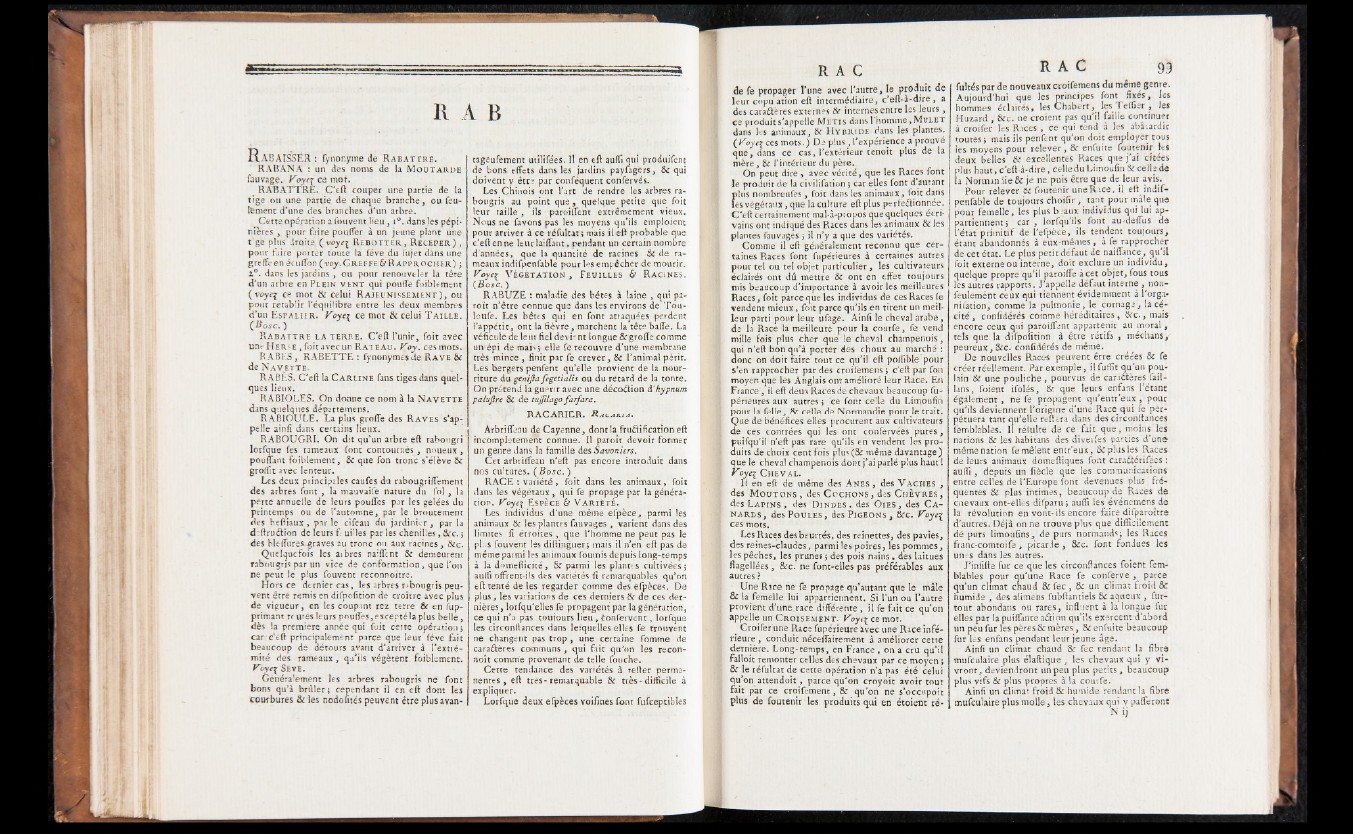
R A B A IS S E R : fynonÿme de Ra b a t t r e .
R ABANA : un des noms de la Moutarde
fauvage. Voye% ce mot.
RABATTRE. C ’ eft couper une partie de la
tige ou une partie de chaque branche, ou feulement
d'une des branches d'un arbre.
Cetteopé.ration a Couvent lieu, i° . dans les pépinières
, pour faire pouffer à un jeune plant une
t'ge plus droite (.voye^ Rebotter, Receper) ,
pour faire porter toute la fève du fujet dans une
greffeen écuffon ( voy. Greffe & R a p p r o ch e r ) 5
2°. dans les jardins , ou pour renouveler 1a têre
d'un arbre en Plein vent qui pouffe foiblement
( voyeç ce mot & celui Rajeunissement), ou
pour rétablir l'équilibre entre les deux membres
d’un Espalier. Voyej ce mot & celui T aille.
( iW . )
Rabattre la terre. C'eft l’unir, foit avec
une Herse , foit avec un Rateau . Voy. ces mots.
R ABUS, R A B E TTE : fynonÿmesde Rave &
de Nave t te .
RABÈS. C'eft la C arline fans tiges dans quelques
lieux.
RABIOLES. On donne ce nom à la Navette
dans quelques départemens.
RABIOULE. La plus groffe des Raves s’appelle
ainfi dans certains lieux.
RABOUGRI. On dit qu'un arbre eft rabougri
lorfque fes rameaux font contournés , noueux,
pouffant foiblement, & que fon tronc s’élève &
groffit avec lenteur.
Les deux principales caufes du rabougriffement
des arbres fo n t , la mauvaife nature du fol , la
perte annuelle de leurs pouffes par les gelées du
printemps ou de l'automne, par le broutement
des beftiaux , par le cifeau du jardinier , par la
dc-ftruétion de leurs E uilles par les chenilles, Sic. ;
des bleffures-graves au tronc ou aux racines, Sic.
Quelquefois les aibres naiflent & demeurent
rabougris par un vice de conformation, que l'on
ne peut le plus fouvent recohnoître.
Hors ce dernier cas, les arbres rabougris peuvent
être remis en difpofition de croître avec plus
de vigueur, en les coupant rez terre & en fup-
primant routes leurs pouffes,exceptélaplus belle,
dès la première année qui fuit cette opération j
car c’eft principalement parce que leur fève fait
beaucoup de détours avant d'arriver à l’extrémité
des rameaux, qu'ils végètent foiblement.
Voyeç Sève.
Généralement les arbres rabougris ne font
bons qu’à briller} cependant il en eft dont les
courbures & les nodofités peuvent être plus avancageufement
utilifées. Il en eft auflî qui produifent
de bons effets dans les jardins paylagèrs, Si qui
doivent y être par conféquent confervés.
Les Chinois ont l’art de rendre les arbres rabougris
au point que, quelque petite que foit
leur taille, ils paroiffent extrêmement vieux.
Nous ne favons pas les moyens qu'ils emploient
pour arriver à ce réfultat} mais il eft probable que
c’ eft en ne leur laiffant, pendant un certain nombre
d’années, que la quantité de racines Si de rameaux
indifpenfable pour les empêcher de mourir.
Voye1 V égétation , Feuilles & Racines.
( S o j c . )
RABUZE : maladie des bêtes à laine , qui pa-
roît n’être connue que dans les environs de Tou-
loufe. Les bêtes qui en font attaquées perdent
l'appétit, ont la fièvre, marchent la tête baffe. La
véficule de leur fiel devif nt longue & groffe comme
un épi de maïs, elle fe recouvre d’une membrane
très-mince , finit par fe crever, & l’animal périt.
Les bergers penfent qu’elle provient de la nourriture
du genifta fegetialis ou du retard de la tonte.
On prétend la guérir avec une décoétion d'kypnum
palujlre Si de tujjtlago far far a.
RACARIER. R acaria.
Arbriffeau de Cayenne, dont la fru&ificatîon eft
incomplètement connue. Il paroît devoir former
un genre dans la famille des Savoniers,.
Cet arbriffeau n'eft pas encore introduit dans
nos cultures. ( B o s c . )
RACE : variété, foit dans les animaux, foit
dans les végétaux, qui fe propage par la génération.
Voye1 Espèce & V ar iété.
Les individus d’une même efpèce, parmi les
animaux & les plantes fauvages , varient dans des
limites fi étroites , que l'homme ne peut pas le
pl.iS fouvent les diftinguerj mais il n’en eft pas de
même parmi les animaux fournis depuis long-temps
à la domefticiré, & parmi les plantes cultivées}
auffi offrent-ils des variétés fi remarquables qu'on
eft tenté de les regarder comme des efpèces. De
plus, les variations de ces derniers Si de ces dernières,
lorfqu’elies fe propagent par la génération,
ce qui n'a pas toujours lie u , Çonfervent, lorfque
les circonftances dans lesquelles elles fe trouvent
ne changent pas trop , une certaine fomme de
caractères communs , qui fait qu’on les recon-
noît comme provenant de telle fouche.
Cette tendance des vartécés à relier permanentes,
eft très-remarquable & très-difficile à
expliquer.
Lorfque deux efpèces voifines font fufceptibles
RAC
de fe propager l'une avec l'autre, le produit de
leur copu ation eft intermédiaire, c*eft-à-dire, a
des caractères externes Si internes entre les leurs ,
ce produit s’appelle Méti s dans l’homme, Mulet
dans les animaux, & Hybride dans les plantes.
([Voye^ ces mots. ) De plus, l'expérience a prouvé
que, dans ce cas, l’extérieur tenoit plus de la
mère, & l'intérieur du père.
On peut dire, avec vérité, que les Races font
le produit de la civilifacion ; car elles font d’autant
plus nombreufes, foit dans les animaux, foit dans
les végéraux , que la culture eft plus perfectionnée.
C'eft certainement mal-à-prouos que quelques écrivains
ont indiqué des Races dans les animaux & les
plantes fauvages j il n’y a que des variétés.
Comme il eft généralement reconnu que certaines
Races font fupérieures à certaines autres
pour tel ou tel objet particulier, les cultivateurs
éclairés ont dû mettre Si ont en effet toujours
mis beaucoup d’importance à avoir les meilleures
Races, foit parce que les individus de ces Races fe
vendent mieux, foit parce qu’ils en tirent un meilleur
parti pour leur ufage. Ainfi le cheval arabe,
de la Race la meilleure pour la courfe, fe vend
mille fois plus cher que le cheval champenois,
qui n'eft bon qu'à porter des choux au marché :
donc on doit faire tout ce qu’ il eft poffible pour
s'en rapprocher par des croifemens} c’eft par fon
moyen que les Anglais ont amélioré leur Race. En
France, il eft deux Races de chevaux beaucoup fupérieures
aux autres} ce font celle du Limoufin
pour la Telle, Si celle de Normandie pour le trait.
Que de bénéfices elles procurent aux cultivateurs
de ces contrées qui les ont confervées pures,
puifqu’il n’eft pas rare qu'ils en vendent les produits
de choix cent fois plus(& même davantage)
que le cheval champenois dont j'ai parlé plus haut!
Voyei C heval.
Il en eft de même des Anes, des V aches , ■
des Moutons , des C ochons, des C hèvres,
des La p in s , des Dindes, des Oie s , des C a n
ard s , des Poules, des Pigeons , & c . Voye£
ces mots.
Les Races des beurrés, des reinettes, des pavies,
des reines-claudes, parmi les poires, les pommes,
les pêches, les prunes} des pois nains, des laitues
flagellées, & c . ne font-elles pas préférables aux
autres?
Une Race ne fe propage qu'autant que le mâle
& la femelle lui appartiennent. Si l’un ou l’autrè
provient d’une.race différente , il fe fait ce qu'on
appelle un C roisement. Voye1 ce mot.
^ Croifer une Race fupérieure avec une Race inférieure
, conduit néceflairement à améliorer cette
dernière. Long-temps, en France, on a cru qu’ il
falloit remonter celles des chevaux par ce moyen}
8c le réfultat de cette opération n’a pas été celui
qu’on attendoit, parce qu'on croyoit avoir tout
fait par ce croifement, & qu’on ne s'occupoit
plus de foutenir les produits qui en étoient ré-
R A C 93
fultés par de nouveaux croifemens du même genre.
Aujourd’hui que les principes font fixés, les
hommes éclairés, les Chabert, les Teffier , les
Huzard , Sic. ne croient pas qu’il faille continuer
à croifer les Races , ce qui tend à les abâtardir
toutes} mais ils penfent qu’on doit employer tous
les moyens pour relever, & enfuite foutenir Es
deux belles & excellentes Races que j’ ai citées
plus haut, c ’eft à-dire, celle du Limoufin Si celle de
la Normandie & je ne puis être que de leur avis.
Pour relever & foutenir une R ace, il eft indifpenfable
de toujours choifîr , tant pour mâle que
pour femelle, les plus beaux individus qui lui appartiennent}
car , lorfqu'ils font au-deffus de
l’état primitif de l’ efpèce, ils tendent toujours,
étant abandonnés à eux-mêmes, à fe rapprocher
de cet état. Le plus petit défaut de naiffance , qu’il
foit externe ou interne, doit exclure un individu,
quelque propre qu’ il paroiffe à cet objet, fous tous
lès autres rapports. J'appelle défaut interne , non-
feulemént ceux qui tiennent évidemment à l'orga-
nifation, comme la pulmonie, le cornage, la céc
ité , confidérés comme héréditaires, Sic. , mais
encore ceux qui paroiffent appartenir au moral ,
tels que la difpofition à être rétifs , méchans/
peureux, &c. confidérés de même.
De nouvelles Races peuvent être créées & fe
créer réellement. Par exemple, ilfuffit qu’un poulain
Si une pouliche , pourvus de car.idlères fail-
lans, foient ifolés, & que leurs enfans l’étant
également, ne fe propagent qu'entr'eux, pour
qu’ils deviennent l’origine d’une Race qui fe perpétuera
tant qu'elle reliera dans des circonftances
femblables. Il rélulte de ce fait que, moins les
nations Si les habitans des divevfes parties d’une
même nation fe mêlent entr’eux, Si plus les Races
de leurs animaux domeftiques font caraétérifées :
auffi, depuis un fiècle que les communications
entre celles de l’Europe font devenues plus fréquentes
& plus intimes, beaucoup de Races de
c.nevaux ont-elles difparu} auffi les événemens dé
la révolution en vont-ils encore faire difparoître
d’autres. Déjà on ne trouve plus que difficilement
dé purs limoafins, de purs normands les Races
franc-comtoife, picarde , Sic. font fondues les
unes dans les autres.
J’infifte fur ce que les circonftances foient femblables
pour qu’une Race fe conferve , parce
qu’un climat chaud & fe c , Si un climat froid &
humide , des alimens fubftantiels Si aqueux , fur-
tout abondans ou rares, influent à la longue fur
elles par la puiffante aécion qu’ ils exercent d'abord
un peu fur les pères & mères, & enfuite beaucoup
fur les enfans pendant leur jeune âge.
Ainfi un climat chaud Si fec rendant la fibre
mufculaire plus élaftique J les chevaux qui y v ivront,
deviendront un peu plus petits, beaucoup
plus vifs Si plus propres à la courfe.
Ainfi un climat froid & humide rendant la fibre
mufculaire plus molle, les chevaux qui y pafferone
N j j
B