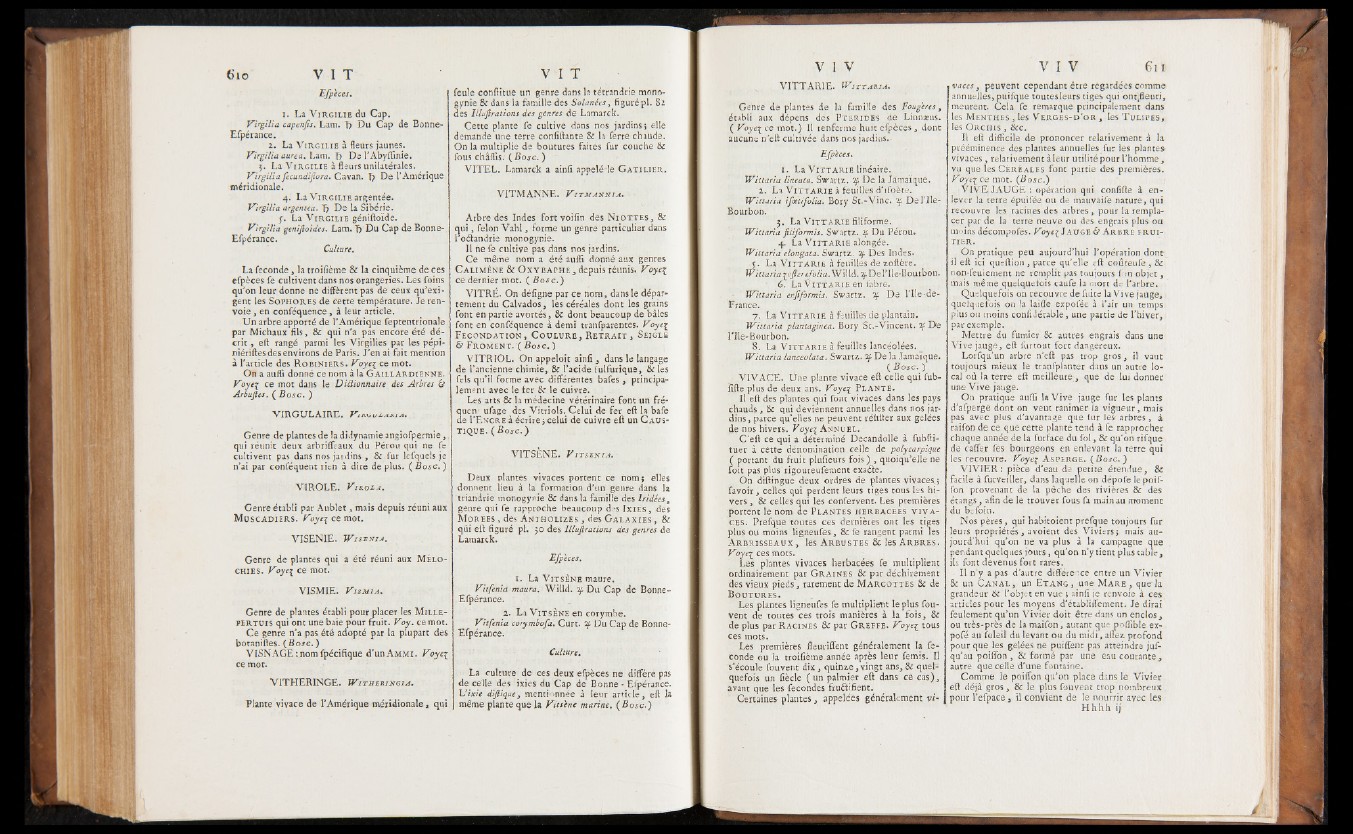
6io V I T
Efpèces.
i . La V irgilie du Cap.
Virgilia capenjis. Lam. "5 Du Cap de Bonne-
Efpérance.
2. La V irgilie à fleurs jaunes.
Virgilia aurea. Lam. De l’Abyflinie.
$. La V irgilie à fleurs unilatérales.
Virgiliafecundifiora. Cavan. I) De l’Amérique,
méridionale.
4. La V irgilie argentée.
Virgilia argentea. De la Sibérie,
y. La V irgilie géniftoïde.
Virgilia geniftoides. Lam. T? Du Cap de Bonne-
Efpérance.
Culture.
La fécondé , la troifîème 8c la cinquième de ces
efpèces fe cultivent dans nos orangeries. Les foins
qu’on leur donne ne diffèrent pas de ceux qu’ex igent
les Sophores de cette température. Je renv
o ie , en conféquence, à leur article.
Un arbre apporté de l’Amérique feptentrionale
par Michaux fils, & qui n’ a pas encore été décrit
., eft rangé parmi les Virgilies par les pépi- i
niériftes des environs de Paris. J’en ai fait mention
à l’article des Robiniers. Voye\ ce mot.
On a aufli donné ce nom à la Gaillardienne. 1
Voye£ ce mot dans le Dictionnaire des Arbres &
Arbufles. (B o s e . )
VIRGULAIR E. V irgular ia .
Genre de plantes de la didynamie angiofpermie,.
qui réunit deux arbriffeaux du Pérou qui ne fe
cultivent pas dans nos jardins , & fur lefquels je
n’ai par conféquent rien à dire déplus. (B o s c .)
VIRO LE. V ir o l a .
Genre établi par Aub let, mais depuis réuni aux
Muscadiers. Voye% ce mot.
VISENIE. W i s e n i a .
Genre de plantes qui a été réuni aux Mélo-
chies. Voye% ce mot.
VISMIE. V i sm ia .
Genre de plantes établi pour placer les Millepertuis
qui ont une baie pour fruit. Voy. ce mot.
Ce genre ri’a pas été adopté par la plupart des
botaniftes. (B o s c . )
VISNAGE:nomfpécifique d’unAMMi. Voyei
ce mot.
VITHERINGE. W ith e r in g ia .
Plante vivace de l’Amérique méridionale j qui
VI T
feule confiitue un genre dans la tétrandrie mono-
gynie & dans la famille des Solanées3 figuré pl. 82
des Illustrations des genres de Lamarck.
Cette plante fe cultive dans nos jardins ; elle
demande une terre confiftante 8c la ferre chaude.
On la multiplie de boutures faites fur couche 8c
fous châflïs. ( Bosc. )
V IT E L . Lamarck a ainfi appelé le Gatilier.
V ITMANNE. V i t man n i a .
Arbre des Indes fortvoifîn des Niottes, 8c
q u i, félon V a h l, forme un genre particulier dans
l’oétandrie monogynie.
Il ne fe cultive pas dans nos jardins.
C e même nom a été aufli donné aux genres
Calimène 8c O xybaphe, depuis réunis. Voye\
ce dernier mot. ( B o s c .)
VITRÉ . On défigne par ce nom, dans le département
du Calvados, les céréales dont les grains
font en partie avortés, 8c dont beaucoup de baies
font en conféquence à demi tranfparentes. Voye%
Fécondation, C oulure, Re t r a it , Seiglb
& Froment. ( B o sc . )
VITRIOL. On appeloit ainfi, dans le langage
de l’ancienne chimie, 8c l’acide fulfurique, & les
fels qu’ il forme avec différentes bafes , principalement
avec le fer 8c le cuivre.
Les arts 8c la médecine vétérinaire font un fréquent
ufage des Vitriols. Celui de fer eft la bafe
de I’Encre à écrire j celui de cuivre eft un C austique.
(B o s c .)
VITSÈNE. VlTSENIA.
Deux plantes vivaces portent ce nom; elles
donnent lieu à la formation d’ un genre dans la
triandrie monogynie 8c dans la famille des lridées%
genre qui fe rapproche beaucoup des Ixies , des
Morees , des Antholizes , des Galaxies , 8c
qui eft figuré pl. 30 des lllufrations des genres de
Lamarck.
Efpèces.
1. La V itsène maure.
Vitfenia maura. Willd. if Du Cap de Bonne-
Efpérance.
2. La V itsène en corymbe.
Vitfenia corymbofa. Curt. if Du Cap de Bonne-
Efpérance.
Culture.
La culture de ces deux efpèces ne diffère pas
de celle des ixies du Cap de Bonne - Efpérance.
Vixie difiique, mentionnée à leur article, eft la
même plante que la Vitsène marine. (B o s c .)
V IT TA R IE . Wi t t a r i a .
Genre de plantes de la famille des Fougères,
établi aux dépens des Pterides de Linnæus.
( Voye% ce mot.) Il renferme huit efpèces, dont
aucune n'eft cultivée dans nos jardins.
Efpèces.
1. La V ittarie linéaire.
Wittaria lineata. Swa rtz. if De la Jamaïque.
2. La V it tarie à feuilles d’ ifoète.
Wittaria ifoètifoüa. Bory St.-Vinc. if D e l’lle-
Bourbon.
3. La V ittarie filiforme.
Wittaria filiformis. Sw'artz. 2f Du Pérou.
4. La V ittarie alongée.
Wittaria elongata. Swartz. if Des Indesƒ.
La V ittarie à feuilles de zoftère.
Wittaria ^cfter&folia. Willd. De l’ Ile-Bourbon.
6. La V ittarie en fabre.
Wittaria enfiformis. Swartz. if De l’Ile-de-
France.
7. La V ittarie à feuilles de plantain.
Wittaria plantaginea. Bory St.-Vincent, if De
l’Ile-Bourbon.
8. La Vittarie à feuilles lancéolées.
Wittaria lanceolata. Swartz. if D e la Jamaïque.
( Bosc. )
V IV A C E . Üne plante vivace eft celle qui fub-
flfte plus de deux ans. Voye% Plante.
Il eft des plantes qui font vivaces dans les pays
chauds, 8c qui deviennent annuelles dans nos jardins,
parce qu’ elles ne peuvent réfifter aux gelées
de nos hivers. Voye\ Annuel» r.
C eft ce qui a déterminé Decandolle à fubfti-
tuer à cette dénomination celle de polycarpique
( portant du fruit plufieurs fois ) , quoiqu’elle ne
foit pas plus rigoureufement exaéle.
On diftingue deux ordres de plantes vivaces.;
favoir, Celles qui perdent leurs tiges tous les hivers
, 8c celles qui les confervent. Les premières
portent le nom de Plantes herbacées v iv a ces.
Prefque toutes ces dernières ont les tiges
plus ou moins ligneufes, 8c fe rangent parmi les
Arbrisseaux, les A rbustes 8c les Arbres.
Voye% ces mots.
Les plantes vivaces herbacées fe multiplient
ordinairement par Graines 8c par déchirement
des vieux pieds, rarement de Marcottes 8c de
Boutures.
Les plantes ligneufes fe multiplient le plus fou-
Vent de toutes ces trois manières à la fois , 8c
de plus par Racines 8c par Greffe. Voye[ tous
ces mots.
Les premières fleuriffent généralement la fécondé
ou la troifîème année après leur femis. Il
s’écoule fouvent d ix , quinze,vingt ans,8c quelquefois
un fiècle ( un palmier eft dans ce cas),
avant que les fécondés fructifient.
Certaine* plantes, appelées généralement vivaces
, peuvent cependant être regardées comme
annuelles, puifque toutes leurs tiges qui ontjfleuri,
meurent. Cela fe remarque principalement dans
les Menthes , les V erges-d 'o r , les T ulipes,
les Orchis , & c.
Il eft difficile de prononcer relativement à la
prééminence des plantes annuelles fur les plantes
vivaces, relativement à leur utilité pour l’homme ,
vu que les Céréales font partie des premières.
I B ce mot. (Bosc.)
V IV E JAUGE : opération qui confifte à enlever
la terre épuifée ou de mauvaife nature, qui
recouvre les racines des arbres, pour la remplacer
par de la terre neuve ou des engrais plus ou
moins décompofés. Voye[ Jauge & A rbre fruitier.
On pratique peu aujourd’hui l’opération dont
il eft ici queftion , parce qu’ elle eft coûreufe, 8c
non-feuiement ne remplit pas toujours fim ob je t,
mais même quelquefois caufe la mort d- l’arbre.
Quelquefois on recouvre de fuite la V ive jauge,
quelquefois on la laiffe expofée à l’ air un temps
plus ou moins confidérable, une partie de l’hiver,
par exemple.
Mettre du fumier 8c autres engrais dans une
V ive jauge, eft furtout fort dangereux.
Lorfqu’ un arbre n’eft pas trop gros , il vaut
toujours mieux le tranfplanter dans un autre local
où la terre eft meilleure, que de lui donner
une V ive jauge.
On pratique auflî la Vive jauge fur les plants
d’afperge dont on veut ranimer Ta vigueur, mais
pas avec plus d’avantage que fur les- arbres, à
raifon de ce que cette plante tend à fe rapprocher
chaque année de la furface du fo l, 8c qu’on rifque
dé cafter fes bourgeons en enlevant la terre qui
les recouvre. Voyeç A sperge. (B o s c .)
V IV IE R : pièce d’eau de petite étendue, 8c
facile à furveiller, dans laquelle on dépofe le poif-
fon provenant de la pêche des rivières 8c des
étangs, afin de le trouver fous fa main au moment
du befoin.
Nos pères, qui habitoient prefque toujours fur
leurs propriétés, avoient des Viviers; mais aujourd’hui
qu’on ne va plus à la campagne que
pendant quelques jours, qu’on n’y tient plus table,
ils font devenus fort rares.
Il n’y a pas d'autre différence entre un Vivier
8c un C a n a l , un Et a n g , une Ma r e , que la
grandeur 8c l’objet en vue ; ainfi je renvoie à ces
articles pour les moyens d’ établiffement. Je dirai
feulement qu’un Vivier doit être dans un enclos,
ou très-près de la maifon, autant que poflible ex-
pofé au foleil du levant ou du midi, allez profond
pour que les gelées ne puiffent pas atteindre juf-
qu’au poiffon, 8c formé par une eau courante,
autre que celle d’ une fontaine.
Comme le poiffon qu’ on place dans le Vivier
eft déjà gros, 8c le plus fouvent trop nombreux
pour l’efpace, il convient de le nourrir avec les
H h h h ij