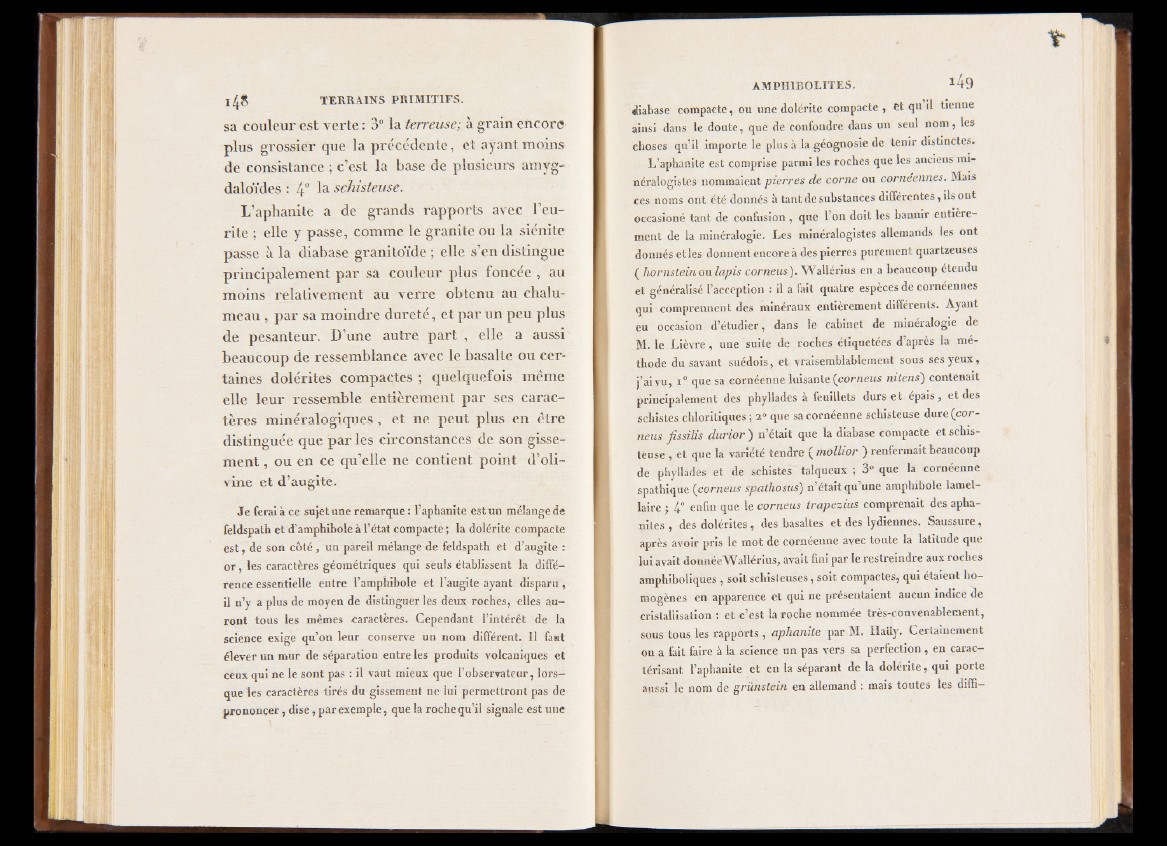
sa couleur est verte : 3° la terreuse; à grain encore
plus grossier que la précédente, et ayant moins
de consistance ; c’est la base de plusieurs amyg-
daloïdes : 4° schisteuse.
L’aphanite a de grands rapports avec l’eu-
rite ; elle y passe, comme le granité ou la siénite
passe à la diabase granitoïde ; elle s’en distingue
principalement par sa couleur plus foncée , au
moins relativement au verre obtenu au chalumeau
, par sa moindre dureté, et par un peu plus
de pesanteur. D’une autre part , elle a aussi
beaucoup de ressemblance avec le basalte ou certaines
dolérites compactes ; quelquefois meme
elle leur ressemble entièrement par ses caractères
minéralogiques, et ne peut plus en être
distinguée que par les circonstances de son gisse-
ment, ou en ce qu’elle ne contient point d’oli-
vine et d’augite.
Je ferai à ce sujet une remarque : l’aphanite est un mélange de
feldspath et d’amphibole à l’état compacte; la dolérite compacte
est, de son côté, un pareil mélange de feldspath et d’augite :
or les caractères géométriques qui seuls établissent la différence
essentielle entre l’amphibole et l’augite ayant disparu,
il n’y a plus de moyen de distinguer les deux roches, elles auront
tous les mêmes caractères. Cependant l’intérêt de la
science exige qu’on leur conserve un nom différent,. Il faut
élever un mur de séparation entre les produits volcaniques et
ceux qui ne le sont pas : il vaut mieux que l’observateur, lorsque
les caractères tirés du gissement ne lui permettront pas de
prononcer, dise, par exemple, que la roche qu’il signale est une
diabase compacte, ou une dolérite compacte , fit qu il tienne
ainsi dans le doute, que de confondre dans un seul nom, les
choses qu’il importe le plus à la géognosie de tenir distinctes.
L ’aphanite est comprise parmi les roches que les anciens minéralogistes
nommaient pierres de corne ou cornéennes. Mais
ce s noms ont été donnés à tant de substances différentes, ils ont
occasioné tant de confusion, que l’on doit les bannir entièrement
de la minéralogie. Les minéralogistes allemands les ont
donnés et les donnent encore à des pierres purement quartzeuses
( hornstein ou lapis corneus ). Wallérius en a beaucoup étendu
et généralisé l’acception : il a fait quatre especes de cornéennes
qui comprennent des minéraux entièrement différents. Ayant
eu occasion d’étudier, dans le cabinet de minéralogie de
M. le Lièvre, une suite de roches étiquetées d’après la méthode
du savant suédois, et vraisemblablement sous ses yeux,
j’ai vu, i° que sa cornéenne luisante (corneus nitens') contenait
principalement des phyllades à feuillets durs et épais, et des
schistes chloritiques ; 2° que sa cornéenne schisteuse dure (corneus
fissilis durior ) n’était que la diabase compacte et schisteuse
, et que la variété tendre ( mollior ) renfermait beaucoup
de phyllades et de schistes talqueux ; 3° que la cornéenne
spathique (corneus spatliosus) n’ était qu’une amphibole lamellaire
; 4° enfin que le corneus trapezius comprenait des apha-
nites , des dolérites , des basaltes et des lydiennes. Saussure,
après avoir pris le mot de cornéenne avec toute la latitude que
lui avait donnée Wallérius, avait fini par le restreindre aux roches
amphiboliques , soit schisteuses, soit compactes, qui étaient homogènes
en apparence et qui ne présentaient aucun indice de
cristallisation : et c’est la roche nommée très-convenablement,
sous tous les rapports , aphanite par M. Haüy. Certainement
on a fait faire à la science un pas vers sa perfection , en caractérisant
l’aphanite et en la séparant de la dolérite, qui porte
aussi le nom de griinstein en allemand : mais toutes les diffi