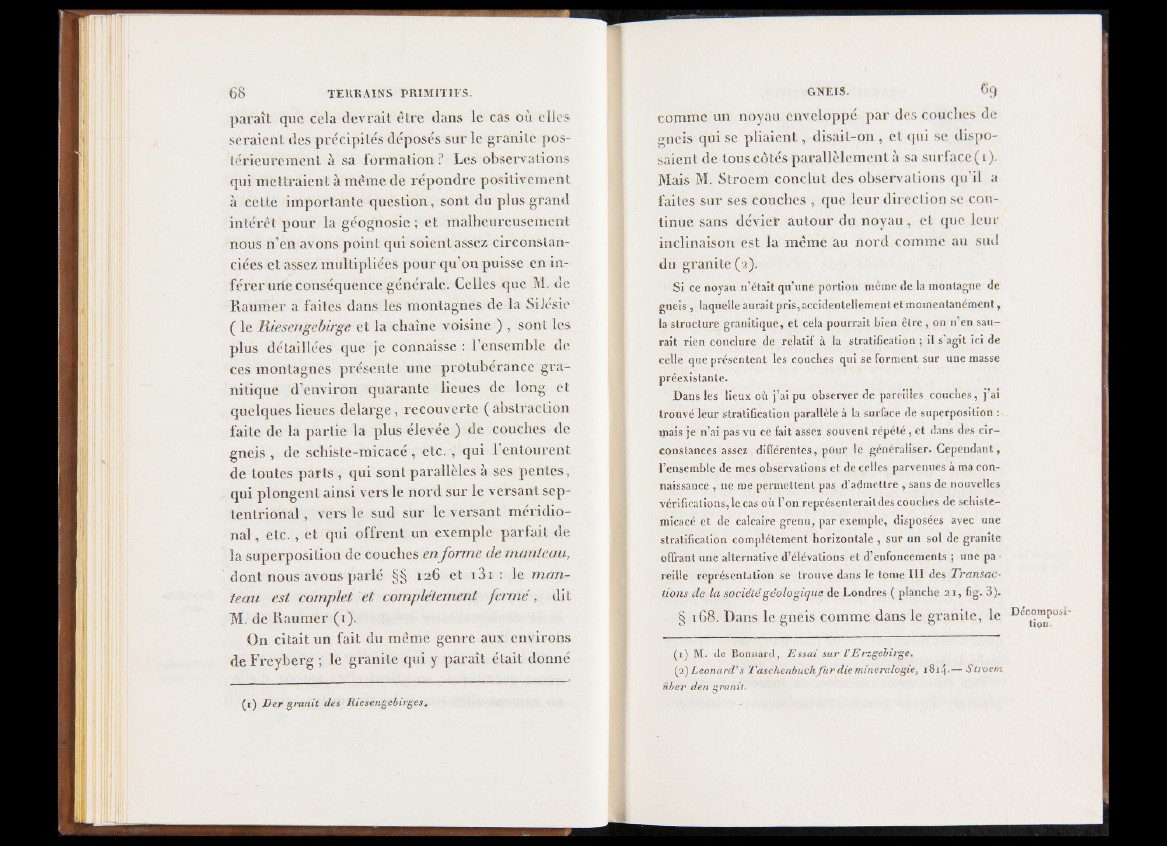
paraît que cela devrait être dans le cas où elles
seraient des précipités déposés sur le granile pos-
lérieuremenl à sa formation ? Les observations
qui mettraient à même de répondre positivement
à celte importante question, sont du plus grand
intérêt pour la géognosie ; et malheureusement
nous n’en avons point qui soient assez circonstanciées
et assez multipliées pour qu’on puisse en inférer
urie conséquence générale. Celles que M. de
Raumer a faites dans les montagnes de la Siiésie
( le Riesengebirge et la chaîne voisine ) , sont les
plus détaillées que je connaisse : l’ensemble de
ces montagnes présente une protubérance granitique
d’environ quarante lieues de long et
quelques lieues delarge, recouverte (abstraction
faite de la partie la plus élevée ) de couches de
gneis , de schiste-micacé , etc. , qui l’entourent
de toutes parts , qui sont parallèles à ses pentes,
qui plongent ainsi vers le nord sur le versant septentrional
, vers le sud sur le versant méridional,
etc., et qui offrent un exemple parfait de
la superposition de couches enforme de manteau,
dont nous avons parlé §§ 126 et i 3 i : le manteau
est complet et complètement ferm é, dit
M. de Raumer (1).
On citait un fait du même genre aux environs
deFreyberg ; le granité qui y paraît était donné (i)
(i) Der granit des Riesengebirges,
comme un noyau enveloppé par des couches de
gneis qui se pliaient, disait-on , et qui se disposaient
de tous côtés parallèlement à sa surface ( 1).
Mais M. Stroem conclut des observations qu’il a
faites sur ses couches , que leur direction se continue
sans dévier autour du noyau, et que leur
inclinaison est la même au nord comme au sud
du granité (2).
Si ce noyau n’était qu’une portion même de la montagne de
gneis, laquelle aurait pris, accidentellement et momentanément,
la structure granitique, et cela pourrait bien être, on 11’en saurait
rien conclure de relatif à la stratification ; il s’agit ici de
celle que présentent les couches qui se forment sur une masse
préexistante.
Dans les lieux où j’ai pu observer de pareilles couches, j’ai
trouvé leur stratification parallèle à la surface de superposition :
mais je n’ai pas vu ce fait assez souvent répété, et dans des circonstances
assez différentes, pour le généraliser. Cependant,
l’ensemble de mes observations et de celles parvenues à ma connaissance
, ne me permettent pas d’admettre , sans de nouvelles
vérifications, le cas où l’on représenterait des couches de schiste-
micacé et de calcaire grenu, par exemple, disposées avec une
stratification complètement horizontale , sur un sol de granile
offrant une alternative d’élévations et d’enfoncements ; une pa •
reille représentation se trouve dans le tome III des Transactions
de la société géologique de Londres ( planche 2 1 , fig. 3 ).
§ 168. Dans le gneis comme dans le granile, le 1 2
(1) M. de Bonnard, Essai sur l’Erzgebirge.
(2) Leonard’ s Taschenbuchjiir die minéralogie, i S14-,— Stroem
iiber den aranit.
Décomposition.