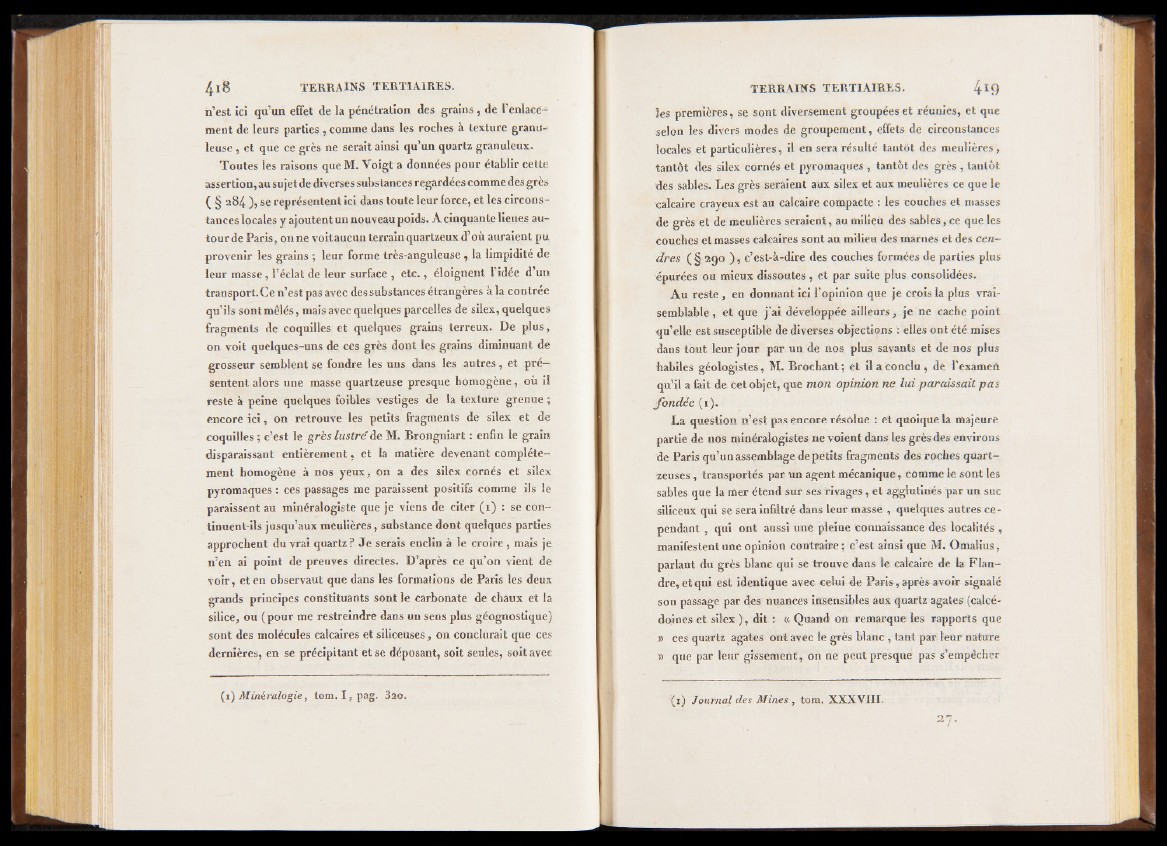
n’est ici qu’un effet de la pénétration des grains, de l’enlace^
ment de leurs parties , comme dans les roches à texture granuleuse
, et que ce grès ne serait ainsi qu’un quartz granuleux.
T outes les raisons que M. Y oigt a données pour établir cette
assertion, au sujet de diverses substances regardées comme des grès
( § 284 ), se représentent ici dans toute leur force, et les circonstances
locales y ajoutent un nouveau poids. A cinquante lieues autour
de Paris, on ne voit aucun terrain quartzeux d’où auraient pu
provenir les grains ; leur forme très-anguleuse , la limpidité de
leur m asse, l’éclat de leur surface , e tc ., éloignent l’idée d’un
transport. Ce n’est pas avec de-s substances étrangères à la contrée
qu’ils sont m êlés, mais avec quelques parcelles de silex, quelques
fragments de coquilles et quelques grains terreux. D e plus,
on voit quelques-uns de ces grès dont les grains diminuant de
grosseur semblent se fondre les uns dans les autres, et présentent
alors une masse quartzeuse presque h om ogèn e, où il
reste à peine quelques foibles vestiges de la texture grenue ;
encore ic i, on retrouve les petits fragments de silex et de
coquilles ; c’est le grès lustré de M. Brongniart : enfin le grain
disparaissant entièrem ent, et la matière devenant com plètement
homogène à nos yeu x, on a des silex cornés et silex
pyromaques : ces passages me paraissent positifs comme ils le
paraissent au minéralogiste que je viens de citer (1 ) : se continuent
ils jusqu’aux m eulières, substance dont quelques parties
approchent du vrai quartz ? Je serais enclin à le croire , mais je
n’en ai point de preuves directes. D ’après ce qu’on vient de
v oir, et en observaut que dans les formations de Paris les deux
grands principes constituants sont le carbonate de chaux et la
silice, ou (pour me restreindre dans un sens plus géognostique)
sont des molécules calcaires et siliceuses, on conclurait que ces
dernières, en se précipitant et se déposant, soit seules, soit avec
(1) Minéralogie, tom. I , pag. 320.
les prem ières, se sont diversement groupées et réunies, et que
selon les divers modes de groupem ent, effets de circonstances
locales et particulières, il en sera résulté tantôt des m eulières,
tantôt des silex cornés et pyromaques , tantôt des grès , tantôt
des sables. Les grès seraient aux silex et aux meulières ce que le
calcaire crayeux est au calcaire compacte : les couches et masses
de grès et de meulières seraient, au milieu des sables, ce que les
couches et masses calcaires sont au milieu des marnes et des cendres
( § 290 ) , c’est-à-dire des couches formées de parties plus
épurées ou mieux dissoutes , et par suite plus consolidées.
A u reste, en donnant ici l’opinion que je crois la plus vraisemblable
, et que j’ai développée ailleurs, je ne cache point
qu’elle est susceptible de diverses objections : elles ont été mises
dans tout leur jour par un de nos plus savants et de nos plus
habiles géologistes, M. Brochant; et il a con clu , de l’examen
qu’il a fait de cet objet, que mon opinion ne lui paraissait pas
fondée (1).
La question n’est pas encore résolue : et quoique la majeure
partie de uos minéralogistes ne voient dans les grès des environs
de Paris qu’un assemblage de petits fragments des roches quart-
zeuses, transportés par un agent mécanique, com me le sont les
sables que la mer étend sur ses rivages, et agglutinés par un suc
siliceux qui se sera infiltré dans leur masse , quelques autres ce pendant
, qui ont aussi une pleine connaissance des localités ,
manifestent une opinion contraire; c’est ainsique M. Omalius,
parlant du grès blanc qui se trouve dans le calcaire de la F landre,
et qui est identique avec celui de Paris, après avoir signalé
son passage par des nuances insensibles aux quartz agates (calcédoines
et silex ) , dit : « Quand on remarque les rapports que
» ces quartz agates ont avec le grès blanc , tant par leur nature
» que par leur gissem ent, on ne peut presque pas s’empêcher
(1) Journal des Mines , tom. XXXVIII.