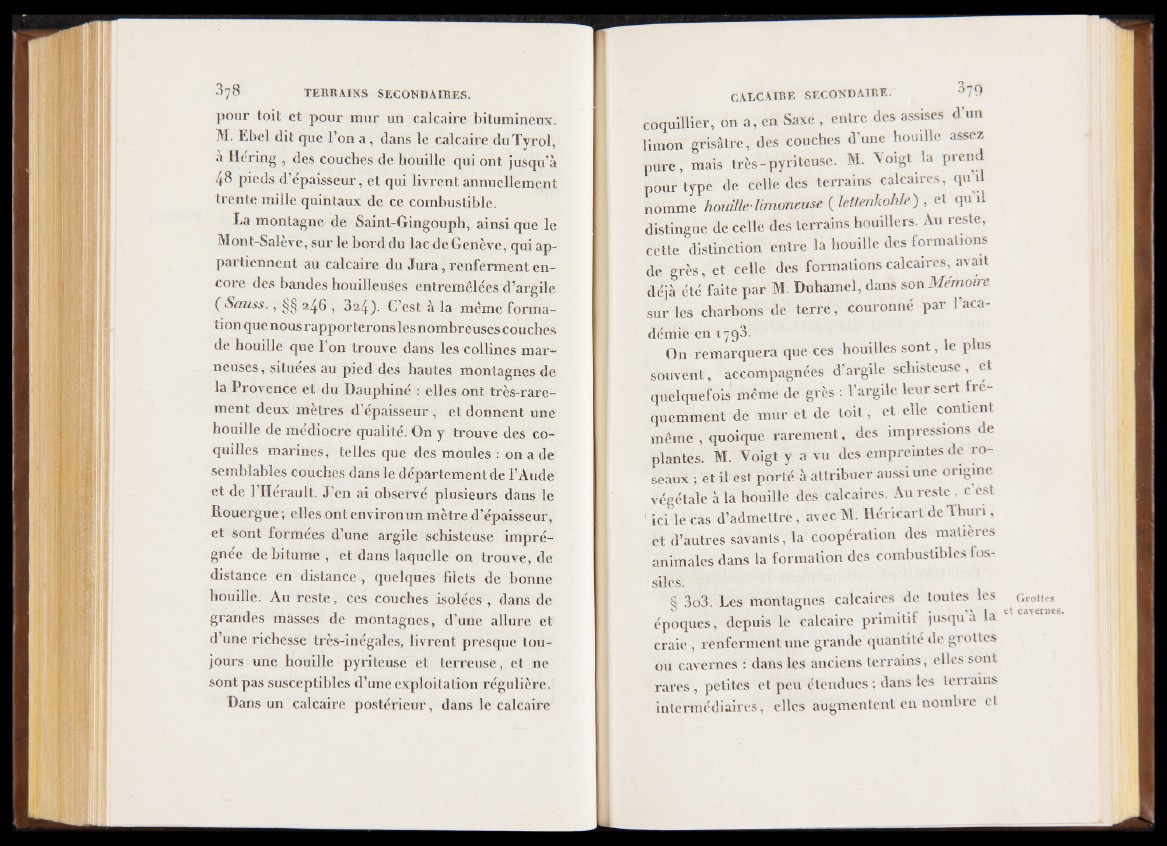
pour toit et pour mur un calcaire bitumineux.
M. Ebel dit que Ton a , dans le calcaire duTyrol,
à Héring , des couches de houille qui ont jusqu’à
48 pieds d’épaisseur, et qui livrent annuellement
trente mille quintaux de ce combustible.
La montagne de Saint-Gingouph, ainsi que le
Mont-Salève, sur le bord du lac de Genève, qui appartiennent
au calcaire du Jura, renferment encore
des bandes houilleuëes entremêlées d’argile
( Sauss., §§ 246 , 324). C’est à la même formation
que nous rapporterons les nombreuses couches
de houille que l’on trouve dans les collines marneuses
, situées au pied des hautes montagnes de
la Provence et du Dauphiné : elles ont très-rarement
deux mètres d’épaisseur, et donnent une
houille de médiocre qualité. On y trouve des coquilles
marines, telles que des moules : on a de
semblables couches dans le dépar tement de l’Aude
et de l ’Hérault. J ’en ai observé plusieurs dans le
Rouergue ; elles ont environun mètre d’épaisseur,
et sont formées d’une argile schisteuse imprégnée
de bitume , et dans laquelle on trouve, de
distance en distance , quelques fiiets de bonne
houille. Au reste, ces couches isolées , dans de
grandes masses de montagnes, d’une allure et
d’une richesse très-inégales, livrent presque toujours
une houille pyriteuse et terreuse, et ne
sont pas susceptibles d’une exploitation régulière.
Dans un calcaire postérieur, dans le calcaire
coquillier, on a, en Saxe , entre des assises d’un
limon grisâtre, des couches d’une houille assez
pure, mais très-pyriteuse. M. Voigt la prend
pour type de celle des terrains calcaires, qui
nomme houille-limoneuse ( lettenkohle) , et quil
distingue de celle des terrains houillers. Au reste,
cette distinction entre la houille des formations
de grès, et celle des formations calcaires, avait
déjà été faite par M. Duhamel, dans son Mémoire
sur les charbons de terre, couronné par l’académie
en 1793.
On remarquera que ces houilles sont, le p us
souvent, accompagnées d’argile schisteuse, et
quelquefois même de grès : l’argile leur sert fréquemment
de mur et de toit, et elle contient
même , quoique rarement, des impressions de
plantes. M. Voigt y a vu des empreintes de roseaux
; et il est porté à attribuer aussi une origine
végétale à la houille des calcaires. Au reste, c’est
' ici le cas d’admettre, avec M. Héricart deThuri,
et d’autres savants, la coopération des matières
animales dans la formation des combustibles fossiles.
§ 3o3. Les montagnes calcaires de toutes les
époques, depuis le calcaire primitif jusqu a la
craie , renferment une grande quantité de grottes
ou cavernes : dans les anciens terrains, elles sont
rares , petites et peu étendues ; dans les terrains
intermédiaires, elles augmentent en nombre et
Grottes
:t cavernes.