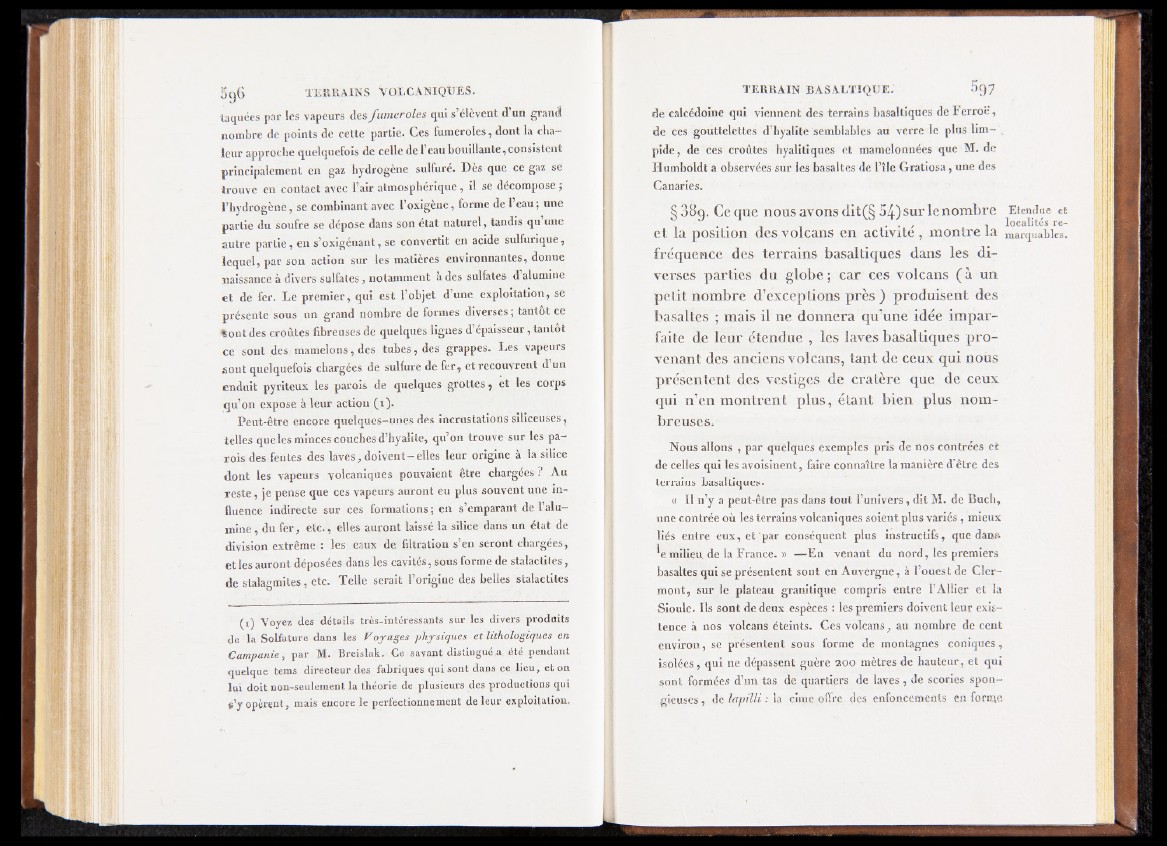
laquées par les vapeurs des fumeroles qui s’élèvent d un grand
nombre de points de cette partie. Ces fumeroles, dont la chaleur
approche quelquefois de celle de l’eau bouillante, consistent
principalement en gaz hydrogène sulfuré. D ès que ce gaz se
trouve en contact avec l’air atmosphérique , il se décomposé ;
l’hydrogène, se combinant avec l’oxigèn e, forme de 1 eau ; une
partie du soufre se dépose dans son état naturel, tandis qu une
autre partie, en s’oxigénant, se convertit en acide sulfurique,
lequel, par son action sur les matières environnantes, donne
naissance à divers sulfates, notamment à des sulfates d alumine
et de fer. Le prem ier, qui est l’objet d’une exploitation, se
présente sous un grand nombre de formes diverses ; tantôt ce
%ont des croûtes fibreuses de quelques lignes d épaisseur, tantôt
ce sont des mam elons, des tubes, des grappes. Les vapeurs
sont quelquefois chargées de sulfure de fer, et recouvrent d un
enduit pyriteux les parois de quelques gro ttes, et les corps
qu’on expose à leur action ( i) .
Peut-être encore quelques-unes des incrustations siliceuses,
telles que les m inces couches d’hyalite, qu’on trouve sur les parois
des fentes des laves, doivent - elles leur origine à la silice
dont les vapeurs volcaniques pouvaient être chargées ? A u
re ste, je pense que ces vapeurs auront eu plus souvent une influence
indirecte sur ces formations ; en s’emparant de l’alumine
, du fer, etc., elles auront laissé la silice dans un état de
division extrême : les eaux de filtration s’en seront chargées,
et les auront déposées dans les cavités, sous forme de stalactites,
de stalagmites, etc. T elle serait l’origine des belles stalactites
( i) Voyez des détails très-intéressants sur les divers produits
de la Solfature dans les Voyages physiques et lithologiques en
Camp unie y par !R. Breislak.. Ce savant distinguer ete pendant
quelque teins directeur des fabriques qui sont dans ce lieu, et on
lui doit non-seulement la théorie de plusieurs des productions qui
s ’y opèrent, mais encore le perfectionnement de leur exploitation.
TERRAIN BASALTIQUE. 5 g ?
de calcédoine qui viennent des terrains basaltiques de F erroë,
de ces gouttelettes d’hyalite semblables au verre le plus lim - „
pide, de ces croûtes hyalitiques et mamelonnées que M. de
Humboldt a observées sur les basaltes de l’île G ratiosa, une des
Canaries.
§ 38g. Ce que nous avons dit(§ 54) sur le nombre
et la position des volcans en activité , montre la
fréquence des terrains basaltiques dans les diverses
parties du globe ; car ces volcans ( à un
pelit nombre d’exceptions près ) produisent des
basaltes ; mais il ne donnera qu’une idée imparfaite
de leur étendue , les laves basaltiques provenant
des anciens volcans, tant de ceux qui nous
présentent des vestiges de cratère que de ceux
qui n’en montrent plus, étant bien plus nombreuses.
N ous allons , par quelques exemples pris de nos contrées et
de celles qui les avoisinent, faire connaître la manière d'être des
terrains basaltiques.
« Il n’y a peut-être pas dans tout l’univers, dit M. de B uch,
une contrée où les terrains volcaniques soient plus variés, mieux
liés entre eu x , et par conséquent plus instructifs, que dans
^e milieu de la France. « — E n venant du nord, les premiers
basaltes qui se présentent sont en A uvergne, à l’ouest de Clerm
on t, sur le plateau granitique compris entre l’A ilier et la
Sioule. Ils sont de deux espèces : les premiers doivent leur existence
à nos volcans éteints. Ces volcans, au nombre de cent
environ, se présentent sous forme de montagnes con iqu es,
iso lées, qui ne dépassent guère aoo mètres de hauteur , et qui
sont formées d’un tas de quartiers de laves , de scories spongieuses
, de lapilli : la cime offre des enfoncements en forme
Etendue et
localités remarquables.