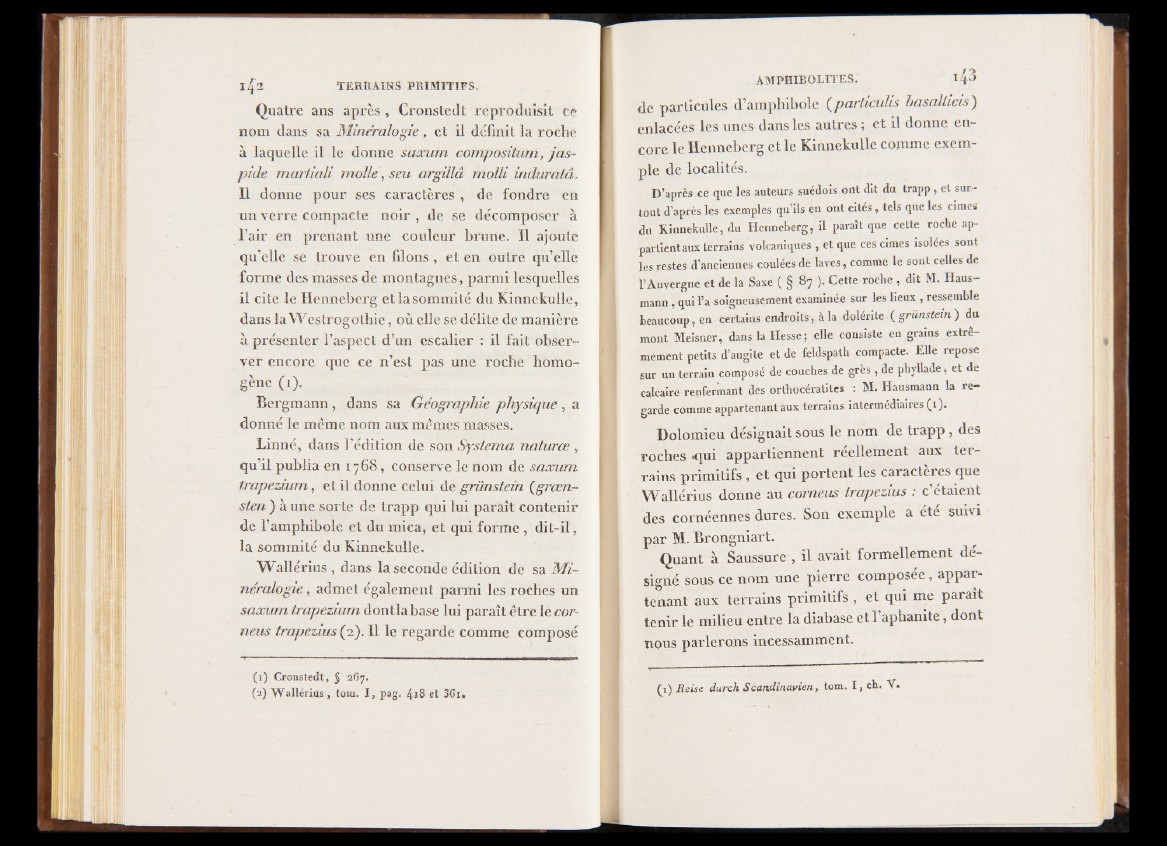
Quatre ans après, Cronstedt reproduisit ce
nom dans sa Minéralogie, et il définit la roche
à laquelle il le donne saxum composition, ja s-
pide martiali molle, seu argillâ molli induratâ.
Il donne pour ses caractères , de fondre en
un verre compacte noir , de se décomposer à
l ’air en prenant une couleur brune. Il ajoute
qu’elle se trouve en filons , et en outre qu’elle
forme des masses de montagnes, parmi lesquelles
il cite le Hcnneberg et la sommité du Kinnekulle,
dans la Westrogothie, où elle se délite de manière
à présenter l’aspect d’un escalier : il fait observer
encore que ce n’est pas une roche homogène
(i).
Bergmann, dans sa Géographie physique, a
donné le même nom aux mêmes masses.
Linné, dans l’édition de son Systema naturoe ,
qu’il publia en 1768, conserve le nom de saxum
trapezium, et il donne celui de grünstein (groen-
sten ) à une sorte de trapp qui lui paraît contenir
de l’amphibole et du mica, et qui forme , dit-il,
la sommité du Kinnekulle.
Wallérius , dans la seconde édition de sa Minéralogie
, admet également parmi les roches un
saxum trapezium dontlabase lui paraît être le cor-
neus trapezius (2). Il le regarde comme composé
(1) Cronstedt, § 267.
(2) Wallériiis, tom. I , pag. 4l8 et 36i.
de particules d’amphibole ( particulis basalhcis')
enlacées les unes dans les autres ; et il donne encore
le Henneberg et le Kinnekulle comme exemple
de localités.
D’après ce que les auteurs suédois ont dit du trapp , et surtout
d’après les exemples qu’ils en ont cités, tels que les cimes
du Kinnekulle, du Henneberg, il paraît que cette roche appartient
aux terrains volcaniques , et que ces cimes isolées sont
les restes d’anciennes coulées de laves, comme le sont celles de
l’Auvergne et de la Saxe ( § 87 ). Cette roche , dit M. Haus-
mann, qui l’a soigneusement examinée sur les lieux , ressemble
beaucoup, en certains endroits, à la dolérite ( grünstein ) du
mont Meisner, dans la Hesse; elle consiste en grains extrêmement
petits d’augite et de feldspath compacte. Elle repose
sur un terrain composé de couches de grès , de phyllade, et de
calcaire renfermant des orthocératites : M. Hausmann la regarde
comme appartenant aux terrains intermédiaires ( 1).
Dolomieu désignait sous le nom de trapp , des
roches «qui appartiennent réellement aux terrains
primitifs , et qui portent les caractères que
Wallérius donne au cornais trapezius . c étaient
des cornéennes dures. Son exemple a été suivi
par M. Brongniart.
Quant à Saussure , il avait formellement désigné
sous ce nom une pierre composée, appartenant
aux terrains primitifs , et qui me paraît
tenir le milieu entre la diabase et 1 aphanite, dont
nous parlerons incessamment.
(i) Reise durck Scandinavien, tom. I, ch. Y.