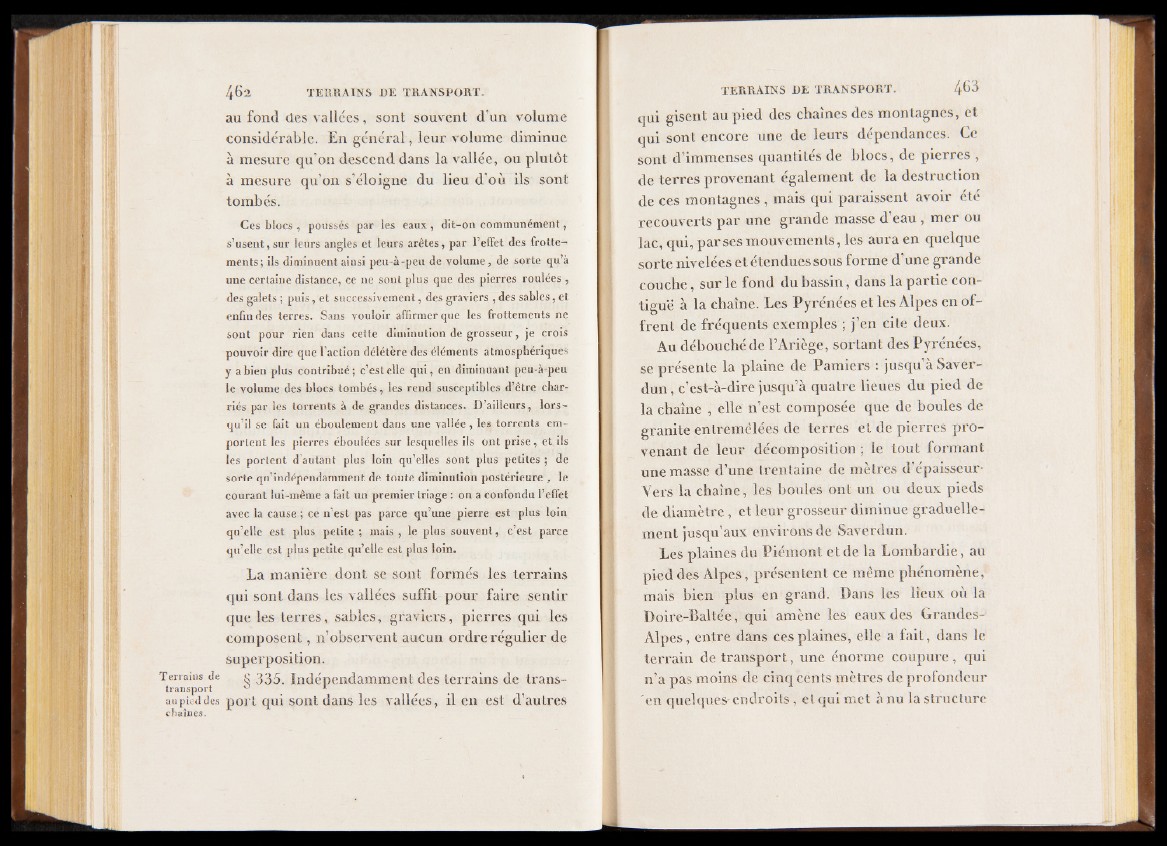
Tterrarnasipnos rtd e cahu apîineeds .des
au fond des vallées, sont souvent d’un volume
considérable. En général, leur volume diminue
à mesure qu’on descend dans la vallée, ou plutôt
à mesure qu’on s’éloigne du lieu d’où ils sont
tombés.
Ces blocs , poussés par les eaux, dit-on communément,
s’usent,sur leurs angles et leurs arêtes, par l’effet des frottements;
ils diminuent ainsi peu-à-peu de volume, de sorte qu’à
une certaine distance, ce ne sont plus que des pierres roulées ,
des galets ; puis, et successivement, des graviers , des sables, et
enfin des terres. Sans vouloir affirmer que les frottements ne
sont pour rien dans cette diminution de grosseur, je crois
pouvoir dire que l’action délétère des éléments atmosphériques
y a bien plus contribué ; c’est elle qui, en diminuant peu-à-peu
le volume des blocs tombés, les rend susceptibles d’être charriés
par les torrents à de grandes distances. D’ailleurs, lorsqu’il
se fait un éboulement dans une vallée, les torrents emportent
les pierres éboulées sur lesquelles ils ont prise, et ils
les portent d autant plus loin qu’elles sont plus petites ; de
sorte qu’indépendamment de toute diminution postérieure , le
courant lui-même a fait un premier triage : on a confondu l’effet
avec la cause ; ce n’est pas parce qu’une pierre est plus loin
qu’elle est plus petite ; mais , le plus souvent, c’est parce
qu’elle est plus petite qu’elle est plus loin.
La manière dont se sont formés les terrains
qui sont dans les vallées suffit pour faire sentir
que les terres, sables, graviers, pierres qui les
composent, n’observent aucun ordre régulier de
superposition.
§ 335. Indépendamment des terrains de transport
qui sont dans les vallées, il en est d’autres
463
qui gisent au pied des chaînes des montagnes, et
qui sont encore une de leurs dépendances. Ce
sont d’immenses quantités de blocs, de pierres ,
de terres provenant également de la destruction
de ces montagnes , mais qui paraissent avoir été
recouverts par une grande masse d’eau , mer ou
lac, qui, par ses mouvements, les aura en quelque
sorte nivelées et étendues sous forme d’une grande
couche, sur le fond du bassin, dans la partie contiguë
à la chaîne. Les Pyrénées et les Alpes en offrent
de fréquents exemples ; j’en cite deux.
Au débouché de l’Ariège, sortant des Pyrénées,
se présente la plaine de Pamiers : jusqu’à Saver-
dun, c’est-à-dire jusqu’à quatre lieues du pied de
la chaîne , elle n’est composée que de boules de
granité entremêlées de terres et de pierres provenant
de leur décomposition ; le tout formant
une masse d’une trentaine de mètres d’épaisseur-
Vers la chaîne, les boules ont un ou deux pieds
de diamètre, et leur grosseur diminue graduellement
jusqu’aux environs de Saverdun.
Les plaines du Piémont et de la Lombardie, au
pied des Alpes, présentent ce même phénomène,
mais bien plus en grand. Dans les lieux où la
Doire-Baltée, qui amène les eaux des Grandes-
Alpes, entre dans ces plaines, elle a fait, dans le
terrain de transport, une énorme coupure, qui
n’a pas moins de cinq cents mètres de profondeur
en quelques- endroits, et qui met à nu la structure