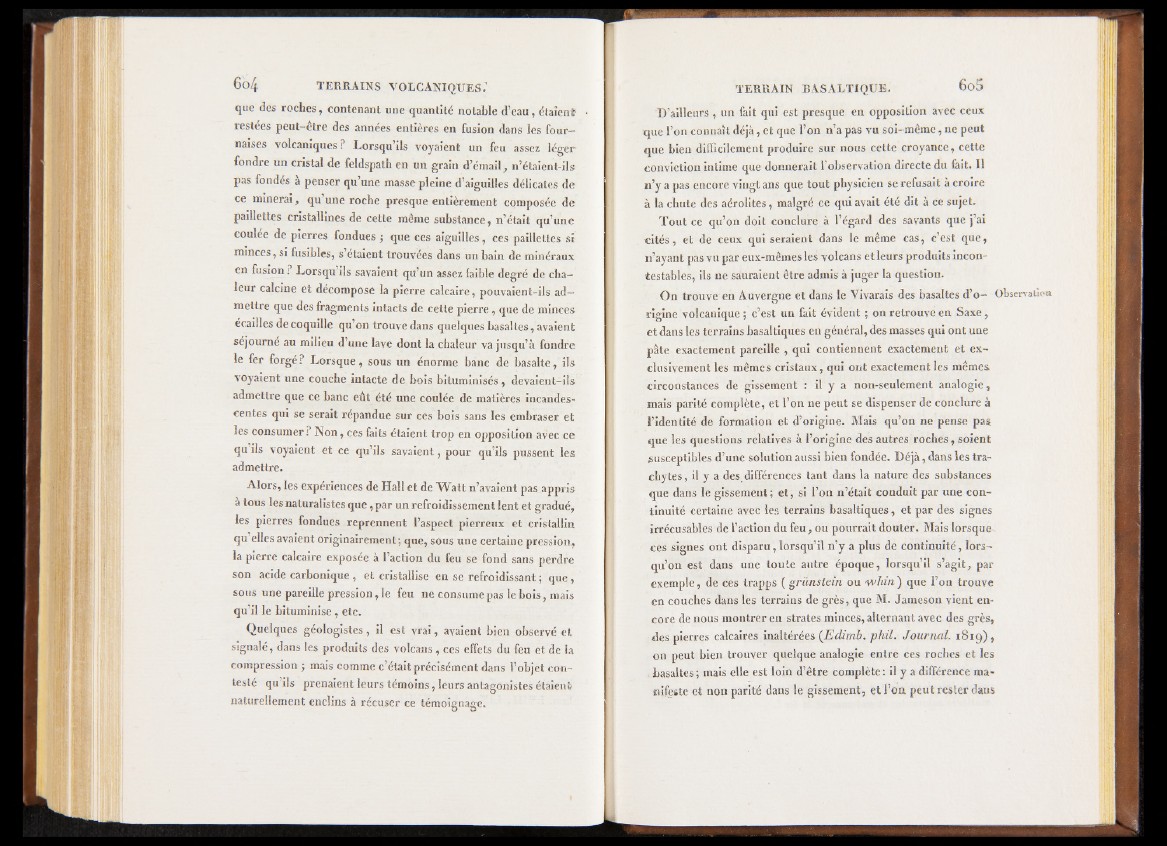
que des roches, contenant une quantité notable d’eau , étaient
restées peut-être des années entières en fusion dans les fournaises
volcaniques ? Lorsqu’ils voyaient un feu assez léger
fondre un cristal de feldspath en un grain d’ém ail, n’étaient-ils
pas fondés à penser qu’une masse pleine d’aiguilles délicates de
ce m inerai, qu’une roche presque entièrement composée de
paillettes cristallines de cette même substance, n’était qu’une
coulée de pierres fondues j que ces aiguilles, ces paillettes si
m inces, si fusibles, s’étaient trouvées dans un bain de minéraux
en fusion ? Lorsqu’ils savaient qu’un assez faible degré de chaleur
calcine et décompose la pierre calcaire, pouvaient-ils admettre
que des fragments intacts de cette pierre, que de minces
écailles de coquille qu’on trouve dans quelques basaltes, avaient
séjourne au milieu d’une lave dont la chaleur va jusqu’à fondre
le fer forgé? L orsq u e, sous un énorme banc de basalte, ils
voyaient une couche intacte de bois bituminisés , devaient-ils
admettre que ce banc eut été une coulée de matières incandescentes
qui se serait répandue sur ces bois sans les embraser et
les Consumer ? N o n , ces faits étaient trop en opposition avec ce
qu ils voyaient et ce qu’ils savaient, pour qu’ils pussent les
admettre.
A lors, les expériences de Hall et de W att n’avaient pas appris
a tous les naturalistes q u e, par un refroidissement lent et gradué,
les pierres fondues reprennent l’aspect pierreux et cristallin
qu’elles avaient originairement; que, sous une certaine pression,
la pierre calcaire exposée à l’action du feu se fond sans perdre
son acide carbonique, et cristallise en se refroidissant ; q u e,
sous une pareille pression, le feu ne consume pas le b ois, mais
qu’il le bitum inise, etc.
Quelques géologistes, il est vrai, avaient bien observé et
signalé, dans les produits des volcans , ces effets du feu et de la
compression ; mais comme c’était précisément dans l’objet contesté
qu’ils prenaient leurs tém oins, leurs antagonistes étaient
naturellement enclins à récuser ce témoignage.
T E R R A IN B A SA L T IQ U E . 6o5
D ’ailleurs , un fait qui est presque en opposition avec ceux
que l’on connaît déjà, et que l’on n’a pas vu soi- m êm e, ne peut
que bien difficilement produire sur nous cette croyance, cette
conviction intime que donnerait l’observation directe du fait. 11
n’y a pas encore vingt ans que tout physicien se refusait à croire
à la chute des aérolites, malgré ce qui avait été dit à ce sujet.
T out ce qu’on doit conclure à l’égard des savants que j’ai
c ité s , et de ceux qui seraient dans le même cas, c’est q u e,
n’ayant pas vu par eux-mêmes les volcans et leurs produits incontestables,
ils ne sauraient être admis à juger la question.
On trouve en Auvergne et dans le Vivarais des basaltes d’o - Observation
rigine volcanique ; c’est un fait évident ; on retrouve en S a x e,
et dans les terrains basaltiques en général, des masses qui ont une
pâte exactement pareille , qui contiennent exactement et exclusivement
les mêmes cristaux, qui ont exactement les mêmes
circonstances de gissement : il y a non-seulement analogie,
mais parité com plète, et l’on ne peut se dispenser de conclure à
l’identité de formation et d’origine. Mais qu’on ne pense pas.
que les questions relatives à l’origine des autres roches, soient
susceptibles d’une solution aussi bien fondée. D éjà, dans les tra-
cbytes, il y a desf différences tant dans la nature des substances
que dans le gissem ent; et, si l’on n ’était conduit par une continuité
certaine avec les terrains basaltiques, et par des signes
irrécusables de l’action du feu , ou pourrait douter. Mais lorsque
ces signes ont disparu, lorsqu’il n’y a plus de continuité, lorsqu’on
est dans une toute autre époque, lorsqu’il s’agit, par
exem ple, de ces trapps ( griinslein ou wliiri) que l’on trouve
en couches dans les terrains de grès, que M. Jameson vient encore
de nous montrer en strates minces, alternant avec des grès,
des pierres calcaires inaltérées (Edimb. phil. Journal. 1 8 1 9 ),
on peut bien trouver quelque analogie entre ces roches et les
basaltes; mais elle est loin d’être complète: il y a différence manifeste
et non parité dans le gissem ent, et l’on peut rester dans