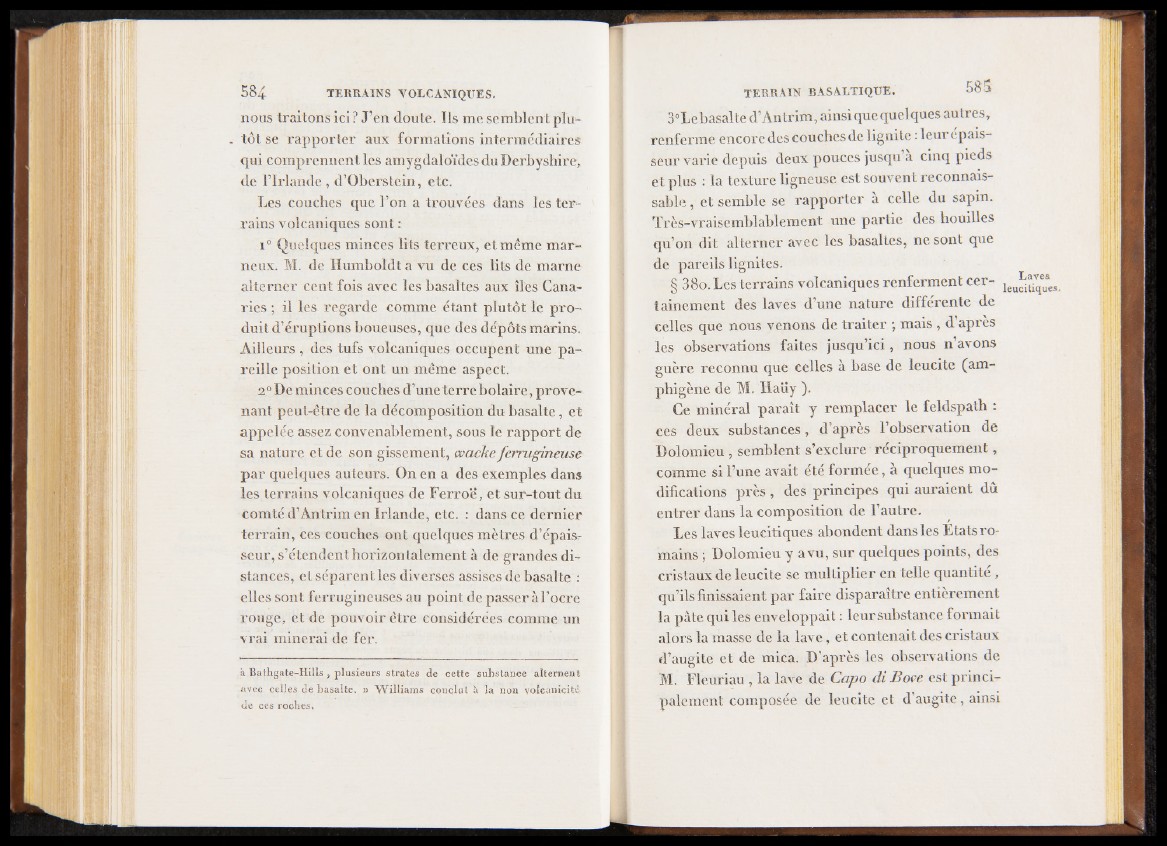
nous traitons ici ? J ’en doute. Ils me semblent plu-
. tôt se rapporter aux formations intermédiaires
qui comprennent les amygdaloïdesduDerbyshire,
de l’Irlande , d’Oberstcin, etc.
Les couches que l’on a trouvées dans les terrains
volcaniques sont :
i° Quelques minces lits terreux, et même marneux.
M. de Humboldt a vu de ces lits de marne
alterner cent fois avec les basaltes aux îles Canaries
; il les regarde comme étant plutôt le produit
d’éruplions boueuses, que des dépôts marins.
Ailleurs , des tufs volcaniques occupent une pareille
position et ont un même aspect.
2° De minces couches d’une terre bolaire, provenant
peut-être de la décomposition du basalte, et
appelée assez convenablement, sous le rapport de
sa nature et de son gissement, wacke ferrugineuse
par quelques auteurs. On en a des exemples dans
les terrains volcaniques de Ferroe, et sur-tout du
comté d’Antrim en Irlande, etc. : dans ce dernier
terrain, ces couches ont quelques mètres d’épais,-
seur, s’étendent horizontalement à de grandes distances,
et séparent les diverses assises de basalte :
elles sont ferrugineuses au point de passer à l’ocre
rouge, et de pouvoir être considérées comme un
vrai minerai de fer.
à Bathgate-Hills , plusieurs strates de cette substance alternent
avec celles de basalte. » Williams conclut à la non volcanicité
de ces roches.
3°Lebasalte d’Antrim, ainsi que quelques autres,
renferme encore des couches de lignite. leux épaisseur
varie depuis deux pouces jusqu’à cinq pieds
et plus : la texture ligneuse est souvent reconnaissable
, et semble se rapporter a celle du sapin.
Très-vraisemblablement une partie des houilles
qu’on dit alterner avec les basaltes, ne sont que
de pareils lignitcs.
§ 38o. Les terrains volcaniques renferment certainement
des laves d’une nature différente de
celles que nous venons de traiter ; mais , d’après
les observations faites jusqu’ic i , nous n’avons
guère reconnu que celles à base de leucite (am-
phigène de M. Iiaüy ).
Ce minéral paraît y remplacer le feldspath :
ces deux substances, d’après l’observation de
Dolomieu , semblent s’exclure réciproquement,
comme si l’une avait été formée, a quelques modifications
près , des principes qui auraient dû
entrer dans la composition de l’autre.
Les laves leucitiques abondent dans les États romains
; Dolomieu y avu, sur quelques points, des
cristaux de leucite se multiplier en telle quantité,
qu’ils finissaient par faire disparaître entièrement
la pâte qui les enveloppait : leursubstance formait
alors la masse de la lave, et contenait des cristaux
d’augite et de mica. D’après les observations de
M. Fleuri au , la lave de Capo di Bove est principalement
composée de leucite et d’augite, ainsi