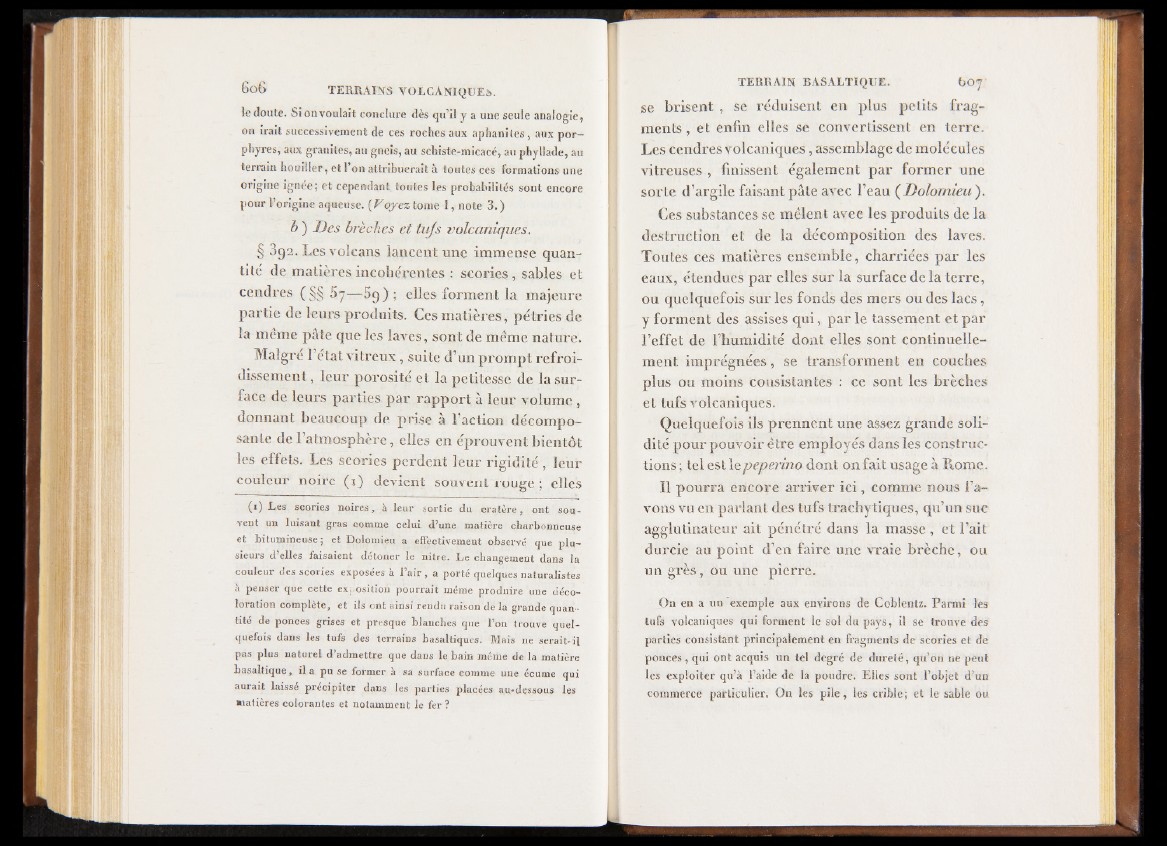
le doute. Sionvoulait conclure dès qu’il y a une seule analogie,
on irait successivement de ces roches aux aphanites, aux porphyres,
aux granités, au gneîs, au schiste-micacé, au phyllade, au
terrain houiller, et l’on attribuerait à toutes ces formations une
origine ignée ; et cependant toutes les probabilités sont encore
pour l’origine aqueuse. {Voyez tome I , note 3 .)
b ) Des brèches et tajs volcaniques.
§ 392. Les volcans lancent une immense quantité
de matières incohérentes : scories , sables et
cendres (§§ 5y—5g) ; elles forment la majeure
partie de leurs produits. Ces matières, pétries de
la meme pâte que les laves, sont de même nature.
Maigre 1 état vitreux, suite d’un prompt refroidissement
, leur porosité et la petitesse de la surface
de leurs parties par rapport à leur volume ,
donnant beaucoup de prise à l’action décomposante
de l ’atmosphère, elles en éprouvent bientôt
les effets. Les scories perdent leur rigidité , leur
couleur noire (1) devient souvent rouge ; elles
( 0 Les scories noires, a leur sortie du cratère, ont souvent
un luisant gras comme celui d’une matière charbonneuse
et bitumineuse ; et Dolomieu a effectivement observé que plusieurs
d’elles faisaient détoner le nitre. Le changement dans la
couleur des scories exposées à l ’a ir , a porté quelques naturalistes
à penser que cette exposition pourrait même produire une décoloration
complète, et ils ont ainsi rendu raison de la grande quantité
de ponces grises et presque blanches que l ’on trouve quelquefois
dans les tufs des terrains basaltiques. Mais ne serait-il
pas plus naturel d’admettre que dans le bain même de la matière
basaltique, il a pu se former à sa surface comme une écume qui
aurait laisse précipiter dans les parties placées au-dessous les
matières colorantes et notamment le fer ?
se brisent , se réduisent en plus petits fragments
, et enfin elles se convertissent en terre.
Les cendres volcaniques, assemblage de molécules
vitreuses , finissent également par former une
sorte d’argile faisant pâte avec l’eau {Dolomieu).
Ces substances se mêlent avec les produits de la
destruction et de la décomposition des laves.
Toutes ces matières ensemble, charriées par les
eaux, étendues par elles sur la surface de la terre,
ou quelquefois sur les fonds des mers ou des lacs,
y forment des assises qui, par le tassement et par
l ’effet de l’humidité dont elles sont continuellement
imprégnées, se transforment en couches
plus ou moins consistantes : ce sont les brèches
et tufs volcaniques.
Quelquefois ils prennent une assez grande solidité
pour pouvoir être employés dans les constructions
; tel est lepeperino dont on fait usage à Home.
Il pourra encore arriver ic i, comme nous l’avons
vu en parlant des tufs trachytiques, qu’un suc
agglutinateur ait pénétré dans la masse, et l’ait
durcie au point d’en faire une vraie brèche, ou
un grès, ou une pierre.
O n en a un exemple aux environs de Coblentz. Parmi les
tufs volcaniques qui forment le sol du pays, il se trouve des
parties consistant principalement en fragments de scories et de
p on ces, qui ont acquis un tel degré de dureté, qu’on ne peut
les exploiter qu’à l’aide de la poudre. E lles sont l’objet d’un
commerce particulier. O n les p ile, les crible; et le sable ou