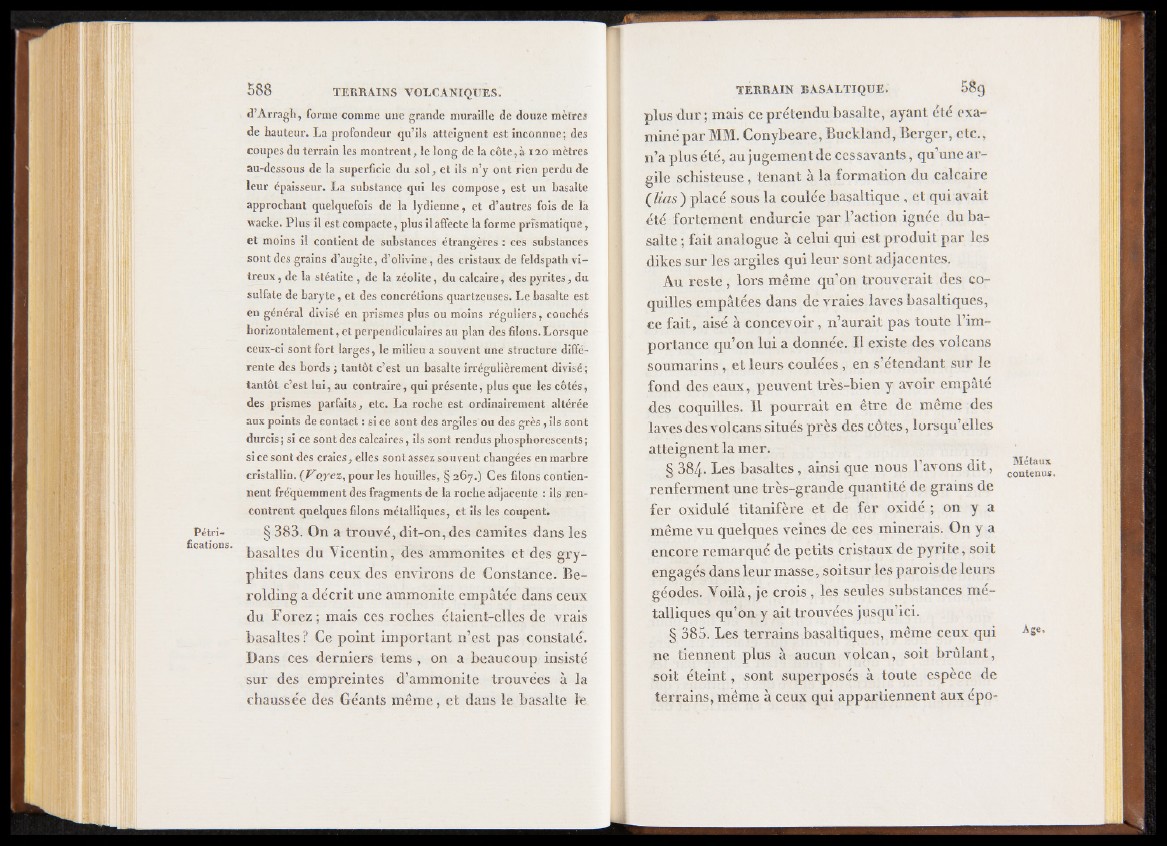
d’Arragh, forme comme une grande muraille de douze mètres
de hauteur. La profondeur qu’ils atteignent est inconnue; des
coupes du terrain les montrent, le long de la côte, à 120 mètres
au-dessous de la superficie du sol, et ils n’y ont rien perdu de
leur épaisseur. La substance qui les compose, est un basalte
approchant quelquefois de la lydienne, et d’autres fois de la
wacke. Plus il est compacte, plus il affecte la forme prismatique,
et moins il contient de substances étrangères : ces substances
sont des grains d’augite, d’olivine, des cristaux de feldspath vitreux,
de la stéatite , de la zéolite, du calcaire, des pyrites, du
sulfate de baryte, et des concrétions quartzeuses. Le basalte est
en général divisé en prismes plus ou moins réguliers, couchés
horizontalement, et perpendiculaires au plan des filons.Lorsque
ceux-ci sont fort larges, le milieu a souvent une structure différente
des bords ; tantôt c’est un basalte irrégulièrement divisé ;
tantôt c’est lui, au contraire, qui présente, plus que les côtés,
des prismes parfaits, etc. La roche est ordinairement altérée
aux points de contact : si ce sont des argiles ou des grès, ils sont
durcis ; si ce sont des calcaires, ils sont rend us phosphorescents ;
si ce sont des craies, elles sont assez souvent changées en marbre
cristallin. (Voyez, pour les houilles, § 267.) Ces filons contiennent
fréquemment des fragments de la roche adjacente : ils rencontrent
quelques filons métalliques, et ils les coupent.
§ 383. On a trouvé, dit-on, des eamites dans les
basaltes du Yicentin, des ammonites et des gry-
phites dans ceux des environs de Constance. Be-
rolding a décrit une ammonite empâtée dans ceux
du Forez; mais ces roches étaient-elles de vrais
basaltes ? Ce point important n’est pas constaté.
Dans ces derniers tems , on a beaucoup insisté
sur des empreintes d’ammonite trouvées à la
chaussée des Géants même, et dans le basalte le
plus dur ; mais ce prétendu basalte, ayant été examiné
par MM. Conybeare, Buckland, Berger, etc.,
n’a plus été, au jugementde cessavants, qu’une argile
schisteuse, tenant à la formation du calcaire
(lias) placé sous la coulée basaltique , et qui avait
été fortement endurcie par l’action ignée du basalte
; fait analogue à celui qui est produit par les
dikes sur les argiles qui leur sont adjacentes.
Au reste , lors même qu’on trouverait des coquilles
empâtées dans de vraies laves basaltiques,
ce fait, aisé à concevoir, n’aurait pas toute l’im-
portance qu’on lui a donnée. Il existe des volcans
soumarins , et leurs coulées, en s’étendant sur le
fond des eaux, peuvent très-bien y avoir empâté
des coquilles. Il pourrait en être de même des
laves des volcans situés près des côtes, lorsqu’elles
atteignent la mer.
§ 384. Les basaltes, ainsi que nous l’avons dit,
renferment une très-grande quantité de grains de
fer oxidulé titanifère et de fer oxidé ; on y a
même vu quelques veines de ces minerais. On y a
encore remarqué de petits cristaux de pyrite, soit
engagés dans leur masse, soitsur les parois de leurs
géodes. Voilà, je crois, les seules substances métalliques
qu’on y ait trouvées jusqu’ici.
§ 385. Les terrains basaltiques, même ceux qui Ase’
ne tiennent plus à aucun volcan, soit brûlant,
soit éteint, sont superposés à toute espèce de
terrains, même à ceux qui appartiennent aux épo