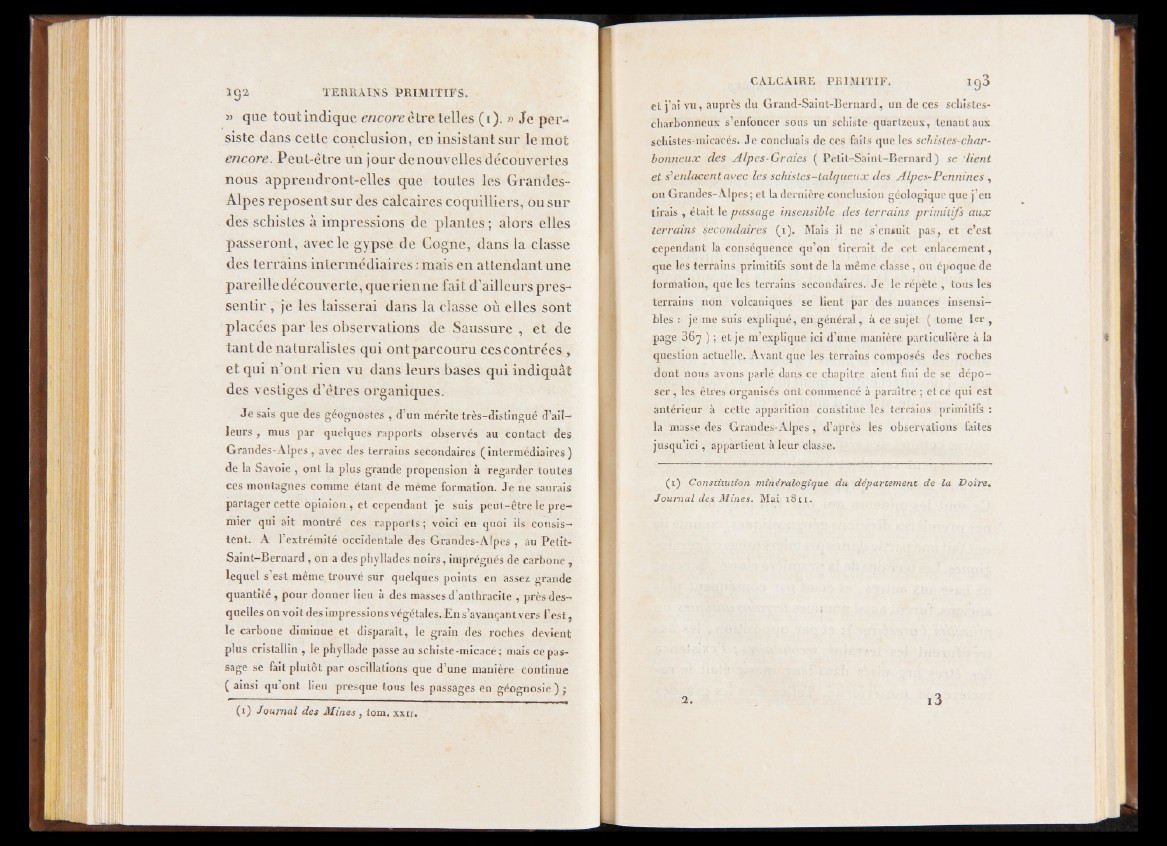
» que tout indique encore être telles (i). » Je persiste
dans cette conclusion, en insistant sur le mot
encore. Peut-être un jour de nouvelles découvertes
nous apprendront-elles que toutes les Grandes-
Alpes reposent sur des calcaires coquilliers, ou sur
des schistes à impressions de plantes ; alors elles
passeront, avec le gypse de Cogne, dans la classe
des terrains intermédiaires : mais en attendant une
pareille découverte, querienne fait d’ailleurs pressentir
, je les laisserai dans la classe où elles sont
placées par les observations de Saussure , et de
tant de naturalistes qui ontparcouru cescontrées,
et qui n’ont rien vu dans leurs bases qui indiquât
des vestiges d’êtres organiques.
Je sais que des géognostes , d’un mérite très-distingué d’ailleurs
, mus par quelques rapports observés au contact des
Grandes-Alpes, avec des terrains secondaires (intermédiaires)
de la Savoie , ont la plus grande propension à regarder toutes
ces montagnes comme étant de même formation. Je ne saurais
partager cette opinion , et cependant je suis peut-être le premier
qui ait montré ces rapports ; voici en quoi ils consistent.
A l’extrémité occidentale des Grandes-Alpes , au Petit-
Saint—Bernard , on a des phyllades noirs, imprégnés de carbone ,
lequel s’est même trouvé sur quelques points en assez grande
quantité, pour donner lieu à des masses d'anthracite , près desquelles
on voit des impressions végétales. En s’avançant vers l’est
le carbone diminue et disparaît, le grain des roches devient
plus cristallin , le phyllade passe au schiste-micacé; mais ce passage
se fait plutôt par oscillations que d’une manière continue
( ainsi qu ont lieu presque tous les passages en géognosie ) j
CALCAIRE PRIMITIF. i g 3
et j’ai vu, auprès du Grand-Saint-Bernard, un de ces schistes-
cliarbonneux s’enfoncer sous un schiste - quartzeux, tenant aux
schistes-micacés. Je concluais de ces faits que les schistes-char-
bonneux des Alpes-Graies ( Petit-Saint-Bernard) se 'lient
et s'enlacent avec les schistes-talqlieux des Alpes-Pennines ,
ou Grandes-Alpes; et la dernière conclusion géologique que j’en
tirais , était le passage insensible des terrains primitifs aux
terrains secondaires (i). Mais il ne s’ensuit pas, et c’est
cependant la conséquence qu’on tirerait de cet enlacement,
que les terrains primitifs sont de la même classe, ou époque de
formation, que les terrains secondaires. Je le répète , tous les
terrains non volcaniques se lient par des nuances insensibles
: je me suis expliqué, en général, à ce sujet ( tome 1er ,
page 367 ) ; et je m’explique ici d’une manière particulière à la
question actuelle. Avant que les terrains composés des roches
dont nous avons parlé dans ce chapitre aient fini de se déposer
, les êtres organisés ont commencé à paraître ; et ce qui est
antérieur à cette apparition constitue les terrains primitifs :
la masse des Grandes-Alpes , d’après les observations faites
jusqu’ic i, appartient à leur classe.
(1) Constitution minéralogique du département de la Do ire.
Journal des Mines. Mai i 8 i i .