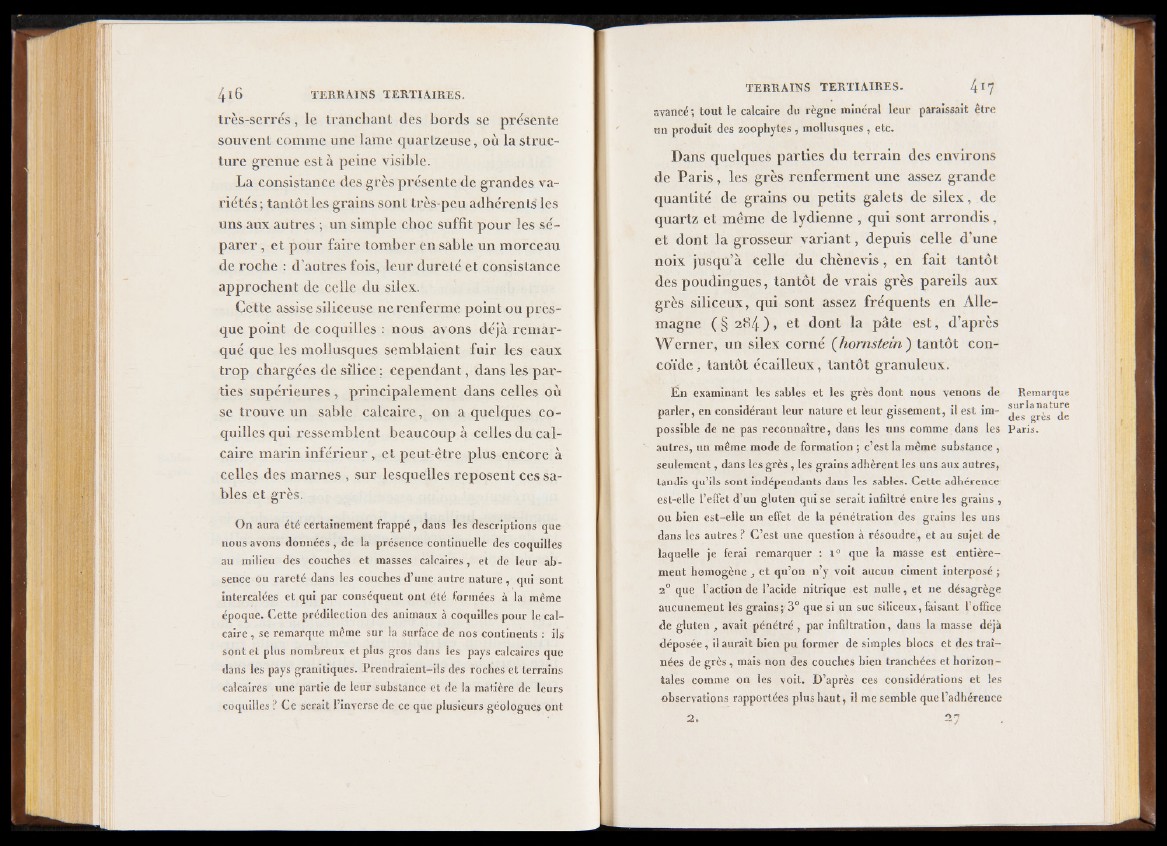
très-serrés, le tranchant des bords se présente
souv ent comme une lame quartzeuse, où la structure
grenue est à peine visible.
La consistance des grès présente de grandes variétés
; tantôt les grains sont très-peu adhérents* les
uns aux autres ; un simple choc suffit pour les séparer
, et pour faire tomber en sable un morceau
de roche : d’autres fois, leur dureté et consistance
approchent de celle du silex.
Cette assise siliceuse nerenferme point ou presque
point de coquilles : nous avons déjà remarqué
que les mollusques semblaient fuir les eaux
trop chargées de silice ; cependant, dans les parties
supérieures , principalement dans celles où
se trouve un sable calcaire, on a quelques coquilles
qui ressemblent beaucoup à celles du calcaire
marin inférieur, et peut-être plus encore à
celles des marnes , sur lesquelles reposent ces sables
et grès.
O n aura été certainement frappé , dans les descriptions que
nous avons données , de la présence continuelle des coquilles
au milieu des couches et masses calcaires, et de leur absence
ou rareté dans les couches d’une autre nature , qui sont
intercalées et qui par conséquent ont été formées à la même
époque. Cette prédilection des animaux à coquilles pour le calcaire
, se remarque même sur la surface de nos continents : ils
sont et plus nombreux et plus gros dans les pays calcaires que
dans les pays granitiques. Prendraient-ils des roches et terrains
calcaires une partie de leur substance et de la matière de leurs
coquilles ? Ce serait l’inverse de ce que plusieurs géologues ont
avancé; tout le calcaire du règne minéral leur paraissait être
un produit des zoophytes , mollusques , etc.
Dans quelques parties du terrain des environs
de Paris, les grès renferment une assez grande
quantité de grains ou petits galets de silex, de
quartz et même de lydienne , qui sont arrondis,
et dont la grosseur variant, depuis celle d’une
noix jusqu’à celle du chènevis, en fait tantôt
des poudingues, tantôt de vrais grès pareils aux
grès siliceux, qui sont assez fréquents en Allemagne
(§ 284), et dont la pâte est, d’après
Werner, un silex corné (homstein ) tantôt con-
coïde | tantôt écailleux, tantôt granuleux.
E n examinant les sables et les grès dont nous venons de
parler, en considérant leur nature et leur gissem ent, il est impossible
de ne pas reconnaître, dans les uns comme dans les
autres, un même mode de formation ; c’est la même substance ,
seu lem en t, dans les grès , les grains adhèrent les uns aux autres,
tandis qu’ils sont indépendants dans les sables. C ette adhérence
est-elle l’effet d’un gluten qui se serait infiltré entre les grains ,
ou bien est-elle un effet de la pénétration des grains les uns
dans les autres P C ’est une question à résoudre, et au sujet de
laquelle je ferai remarquer : i° que la masse est entièrement
hom ogène , et qu’on n’y voit aucun ciment interposé ;
2 0 que l’action de l’acide nitrique est n u lle, et ne désagrège
aucunement les grains; 3° que si un suc siliceux, faisant l’office
de g lu ten , avait pén étré, par infiltration, dans la masse déjà
déposée, il aurait bien pu former de simples blocs et des traînées
de g rès, mais non des couches bien tranchées et horizontales
comme on les voit. D ’après ces considérations et les
observations rapportées plus haut, i! me semble que l’adhérence
Remarque
sur la nature
des grès de
Paris.