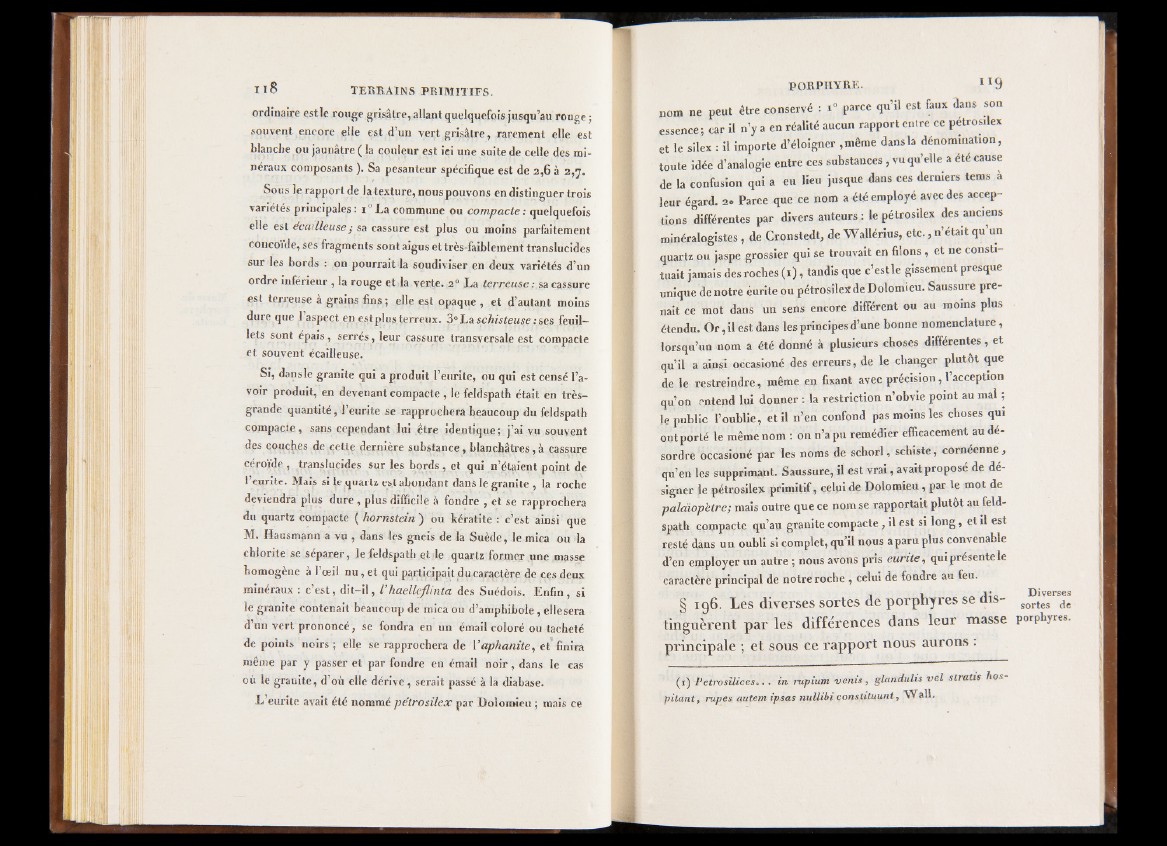
ordinaire est le rouge grisâtre, allant quelquefois jusqu’au rouge ;
souvent encore elle est d’un vert grisâtre, rarement elle est
blanche ou jaunâtre ( la couleur est ici une suite de celle des minéraux
composants ). Sa pesanteur spécifique est de 2,6 à 2,7.
Sous le rapport de la texture, nouspouvons en distinguer trois
variétés principales: i°L a commune ou compacte: quelquefois
elle est écailleuse j sa cassure est plus ou moins parfaitement
conco'ide, ses fragments sont aigus et très-faiblement translucides
sur les bords : on pourrait la soudiviser en deux variétés d’un
ordre inférieur , la rouge et la verte. 2° La terreuse : sa cassure
est terreuse à grains fins ; elle est opaque , et d’autant moins
dure que 1 aspect en est plus terreux. 3° La schisteuse : ses feuillets
sont épais, serrés, leur cassure transversale est compacte
et souvent écailleuse.
Si, dans le granité qui a produit l’eurite, ou qui est censé l’avoir
produit, en devenant compacte , le feldspath était en très-
grande quantité, l’eurite se rapprochera beaucoup du feldspath
compacte, sans cependant lui être identique ; j’ai vu souvent
des couches de cette dernière substance, blanchâtres, à cassure
céroïde , translucides sur les bords , et qui n’étaient pojnt de
reurite. Mais si le quartz est abondant dans le granité , la roche
deviendra plus dure , plus difficile à fondre , et se rapprochera
du quartz compacte ( hornstein ) ou kératite : c’est ainsi que
M. Hausmann a vu , dans les gneis de la Suède, le mica ou la
chjorite se séparer, le .feldspath et le quartz former une masse
homogène à l’oeil nu, et qui participait du caractère de ces deux
minéraux : c’est, dit-il, l ’haelleflinta des Suédois. Enfin , si
le granité contenait beaucoup de mica ou d’amphibole , ellesera
d’un vert prononcé, se fondra en un émail coloré ou tacheté
de points noirs; elle se rapprochera de Vaphanite, et*finira
même par y passer et par fondre en émail noir, dans le cas
où le granité, d’où elle dérive , serait passé à la diabase.
L ’eurite avait été nommé pétrosilex par Bolomieu ; mais ce
nom ne peut être conservé : 1° parce qu’il est faux dans son
essence; car il n’y a en réalité aucun rapport entre ce pétrosilex
et le silex : il importe d’éloigner ,même dans la dénomination,
toute idée d’analogie entre ces substances , vu qu’elle a été cause
de la confusion qui a eu lieu jusque dans ces derniers tems à
leur égard. 2 . Parce que ce nom a été employé avec des acceptions
différentes par divers auteurs : le pétrosilex des anciens
minéralogistes, de Cronstedt, de Wallérius, etc., n’était qu’un
quartz pu jaspe grossier qui se trouvait en filons , et ne constituait
jamais des roches ( 1 ) , tandis que c’ est le gissement presque
unique de notre êurite ou pétrosilex de Dolomieu. Saussure prenait
ce mot dans un sens encore différent ou au moins plus
étendu. Or, il est dans les principes d’une bonne nomenclature,
lorsqu’un nom a été donné à plusieurs choses différentes, et
qu’il a ainsi occasioné des erreurs, de le changer plutôt que
de le restreindre, même en fixant avec précision, l’acception
qu’on entend lui donner : la restriction n’obvie point au mal ;
le public l’oublie, et il n’en confond pas moins les choses qui
ont porté le même nom : on n’a pu remédier efficacement au désordre
occasioné par les noms de schorl, schiste , corneenne,
qu’en les supprimant. Saussure, il est vrai, avait proposé de désigner
le pétrosilex primitif, celui de Dolomieu, par le mot de
palaiopètre; mais outre que ce nomse rapportait plutôt au feldspath
compacte qu’au granité compacte, il est si long, et il est
resté dans un oubli si complet, qu’il nous aparu plus convenable
d’en employer un autre ; nous avons pris eurite, qui présente le
caractère principal de notre roche , celui de fondre au feu.
§ 196. Les diverses sortes de porphy res se dis-
tinguèrent par les différences dans leur masse porphyres,
principale ; et sous ce rapport nous aurons .
(1) Petrosiliees. . . in rupium veius, glandulis vel stratis hos
pitant, rupes autem ipsas nullibi constituant, Wall.