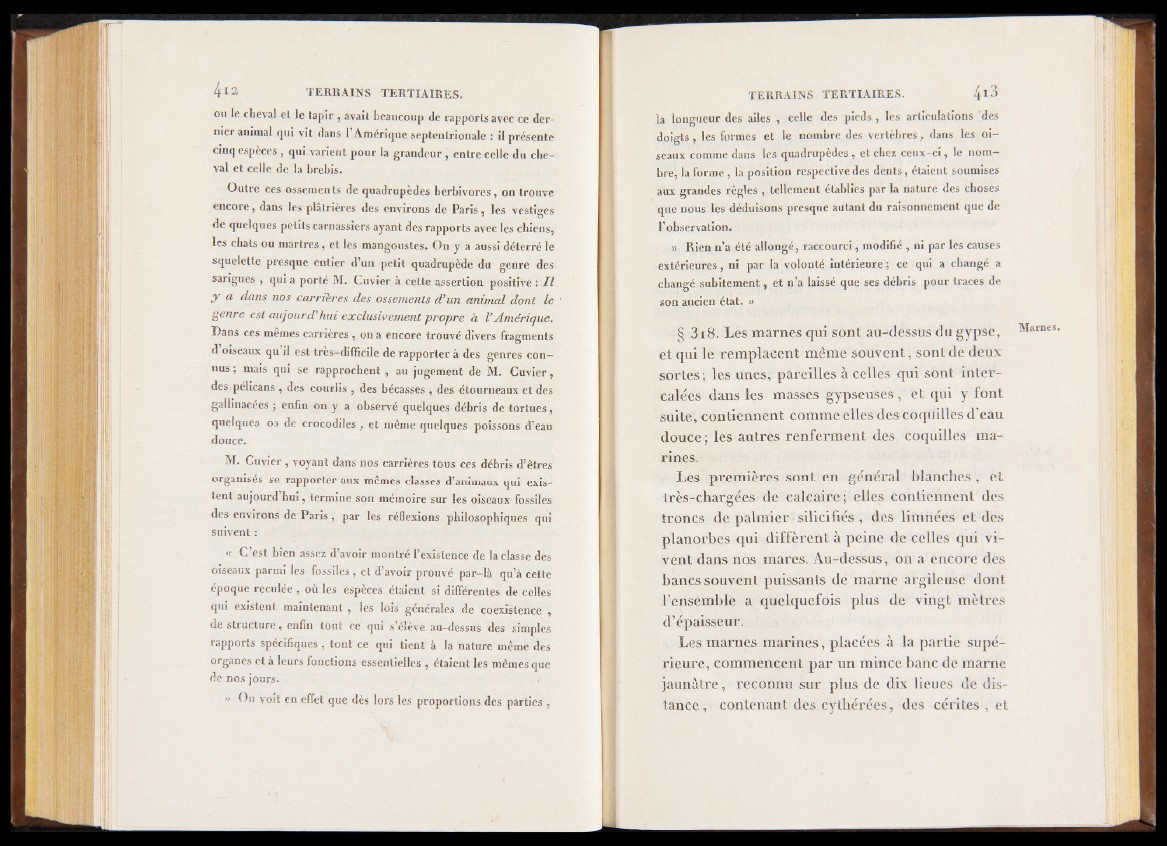
ou le cheval et le tapir , avait beaucoup de rapports avec ce dernier
animal qui vit dans l’Amérique septentrionale : il présente
cinq espèces , qui.varient pour la grandeur , entre celle du cheval
et celle de la brebis.
Outre ces ossements de quadrupèdes herbivores, on trouve
en core, dans les plâtrières des environs de Paris, les vestiges
de quelques petits carnassiers ayant des rapports avec les chiens,
les chats ou martres, et les mangoustes. On y a aussi déterré le
squelette presque entier d’un petit quadrupède du genre des
sarigues , qui a porté M. Cuvier à celte assertion positive : I l
y a dans nos carrières des ossements d ’un animal dont le
genre est aujourd hui exclusivement propre a l’ ydmériaue.
Dans ces memes carrières , Qn a encore trouvé divers fragments
d oiseaux qu il est très-difficile de rapporter à des genres connus
; mais qui se rapprochent, au jugement de M. C uvier,
des pélicans , des courlis , des bécasses , des étourneaux et des
gallinacées ; enfin on y a observé quelques débris de tortu es,
quelques os de crocodiles, et même quelques poissons d’eau
douce.
M. Cuvier , voyant dans nos carrières tous ces débris d’êtres
organisés se rapporter aux mêmes classes d’animaux qui existent
aujourd h u i, termine son mémoire sur les oiseaux fossiles
des environs de P aris, par les réflexions philosophiques qui
suivent :
« C ’est bien assez d’avoir montré l’existence de la classe des
oiseaux parmi les fossiles , et d’avoir prouvé par—là qu’à cette
époque reculée , où les espèces étaient si différentes de celles
qui existent maintenant , les lois générales de coexistence ,
de structure, enfin tout ce qui s’élève au-dessus des simples
rapports spécifiques, tout ce qui tient à la nature même des
organes et à leurs fonctions essentielles , étaient les mêmes que
de nos jours. /
» On voit en effet que dès lors les proportions des parties ,
la longueur des ailes , celle des pieds , les articulations des
d o ig ts, les formes et le nombre des vertèbres, dans les oiseaux
comme dans les quadrupèdes, et chez ceu x -ci, le nombre,
la forme , la position respective des dents, étaient soumises
aux grandes règles , tellement établies par la nature des choses
que nous les déduisons presque autant du raisonnement que de
l’observation.
» R ien n’a été allongé, raccourci, modifié , ni par les causes
extérieures, ni par la volonté intérieure ; ce qui a changé a
changé subitem ent, et n ’a laissé que ses débris pour traces de
son ancien état. »
§ 3i 8. Les marnes qui sont au-dessus du gypse,
et qui le remplacent même souvent, sont de deux
sortes; les unes, pareilles à celles qui sont intercalées
dans les masses gypseuses, et qui y font
suite, contiennent comme elles des coquilles d’eau
douce ; les autres renferment des coquilles marines.
Les premières sont en général blanches , et
très-chargées de calcaire ; elles contiennent des
troncs de palmier silicifiés , des limnées et des
planorbes qui diffèrent à peine de celles qui vivent
dans nos mares. Au-dessus, on a encore des
bancs souvent puissants de marne argileuse dont
l’ensemble a quelquefois plus de vingt mètres
d’épaisseur.
Les marnes marines, placées à la partie supérieure,
commencent par un mince banc de marne
jaunâtre | reconnu sur plus de dix lieues de distance,
contenant des cythérées, des cérites , et
Marnes.