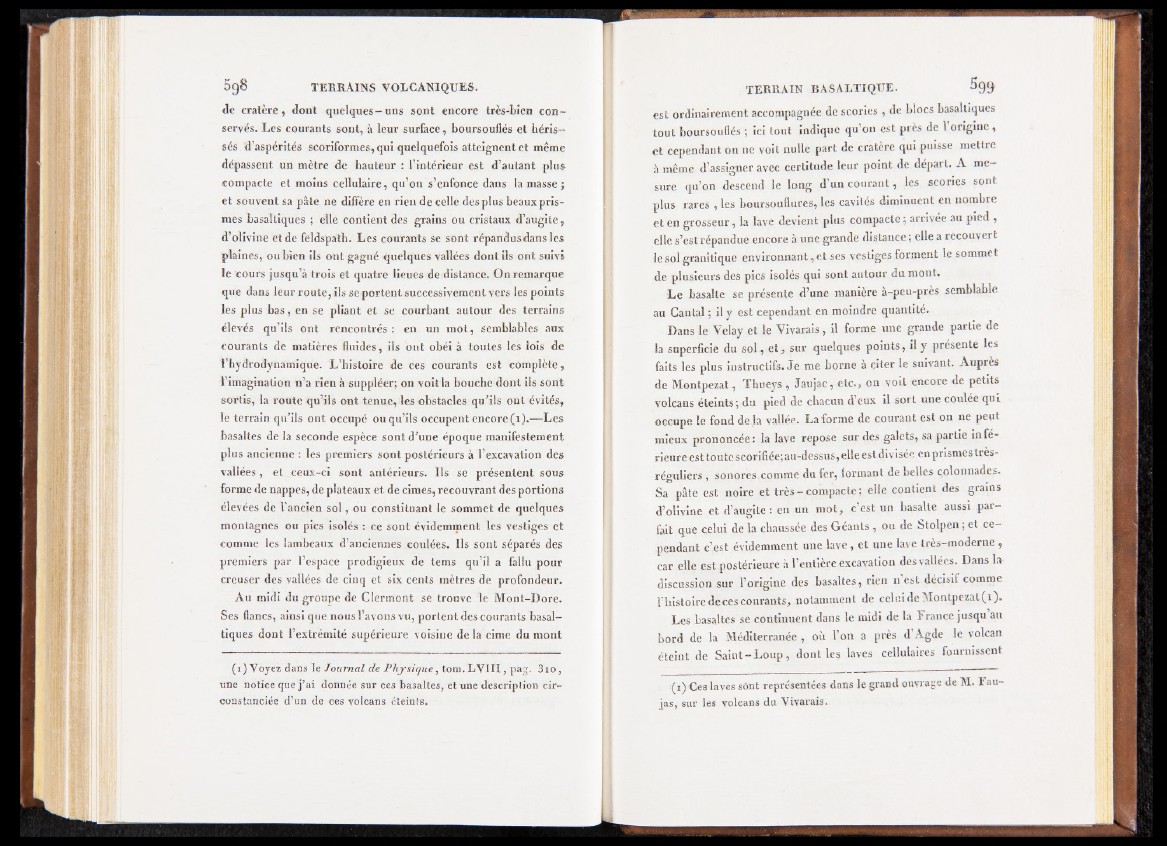
de cratère, dont q u elq ues-u n s sont encore très-bien con servés.
Les courants sont, à leur surface, boursouflés et hérissés
d’aspérités scoriformes, qui quelquefois atteignent et même
dépassent un mètre de hauteur : l’intérieur est d’autant plus
compacte et moins cellulaire, qu’on s’enfonce dans la masse ;
et souvent sa pâte ne diffère en rien de celle desplus beaux prismes
basaltiques ; elle contient des grains ou cristaux d’augite,
d’d ivin e et de feldspath. L es courants se sont répandus dans les
plaines, ou bien ils ont gagné quelques vallées dont ils ont suivi
le cours jusqu’à trois et quatre lieues de distance. O n remarque
que dans leur route, ils se portent successivement vers les points
les plus b a s, en se pliant et se courbant autour des terrains
élevés qu’ils ont rencontrés : en un m o t, semblables aux
courants de matières fluides, ils ont obéi à toutes les lois de
l’hydrodynamique. L ’histoire de ces courants est com plète,
l’imagination n ’a rien à suppléer; on voit la bouche dont ils sont
sortis, la route qu’ils ont tenue, les obstacles qu’ils ont évités,
le terrain qu’ils ont occupé ou qu’ils occupent encore ( i) .— L es
basaltes de la seconde espèce sont d’une époque manifestement
plus ancienne : les premiers sont postérieurs à l’excavation des
vallées, et ceux-ci sont antérieurs. Ils se présentent sous
forme de nappes, de plateaux et de cimes, recouvrant des portions
élevées de l’ancien s o l, ou constituant le sommet de quelques
montagnes ou pics isolés : ce sont évidemment les vestiges et
comme les lambeaux d’anciennes coulées. Ils sont séparés des
premiers par l’espace prodigieux de tems qu’il a fallu pour
creuser des vallées de cinq et six cents mètres de profondeur.
A u midi du groupe de Clermont se trouve le M ont-D ore.
Ses flancs, ainsi que nous l’avons vu, portent des courants basaltiques
dont l’extrémité supérieure voisine de la cime du mont
( i) Voyez dans le Journal de P h y s iqu e , tom. L V 1 I I , pag. 3 io ,
une notice que j ’ ai donnée sur ces basaltes, et une descriplion circonstanciée
d’ un de ces volcans éteints.
est ordinairement accompagnée de scories , de blocs basaltiques
tout boursouflés ; ici tout indique qu’on est près de 1 origine ,
et cependant on ne voit nulle part de cratère qui puisse mettre
à même d’assigner avec certitude leur point de départ. A mesure
qu’on descend le long d’un cou ran t, les scories sont
plus rares , les boursouflures, les cavités diminuent en nombre
et en grosseur, la lave devient plus compacte ; arrivée au pied ,
elle s’est répandue encore à une grande distance ; elle a recouvert
le sol granitique environnant, et ses vestiges forment le sommet
de plusieurs des pics isolés qui sont autour du mont.
L e basalte se présente d’une manière à-peu-pres semblable
au Cantal ; il y est cependant en moindre quantité.
Dans le Velay et le V ivarais, il forme une grande partie de
la superficie du s o l, e t , sur quelques poin ts, il y présente les
faits les plus instructifs. Je me borne a citer le suivant. Auprès
de M ontpezat, Thueys , Jaujac, etc., on voit encore de petits
volcans éteints; du pied de chacun d’eux il sort une coulée qui
occupe le fond d eNla vallée. La forme de courant est on ne peut
mieux prononcée: la lave repose sur des galets, sa partie in ferieure
est toute scorifiée; au-dessus, elle est divisée en prismes tres-
réguliers, sonores.com me du fer, formant de belles colonnades.
Sa pâte est noire et très - compacte ; elle contient des grains
d’d ivin e et d’augite : en un m o t, c’est un basalte aussi parfait
que celui de la chaussée des Géants , ou de Stolpen ; et cependant
c’est évidemment une lave , et une lave très-moderne ,
car elle est postérieure à l’entière excavation des vallées. Dans la
discussion sur l’origine des basaltes, rien n est décisif comme
l’histoire de ces courants, notamment de celui de M on tp ezat(i).
Les basaltes se continuent dans le midi de la France jusqu au
bord de la Méditerranée , où l’on a près d’À gde le volcan
éteint de S a in t-L o u p , dont les laves cellulaires fournissent
(i) Ces laves sont représentées dans le grand ouvrage de M. F au -
jas, sur les volcans du Vivarais.