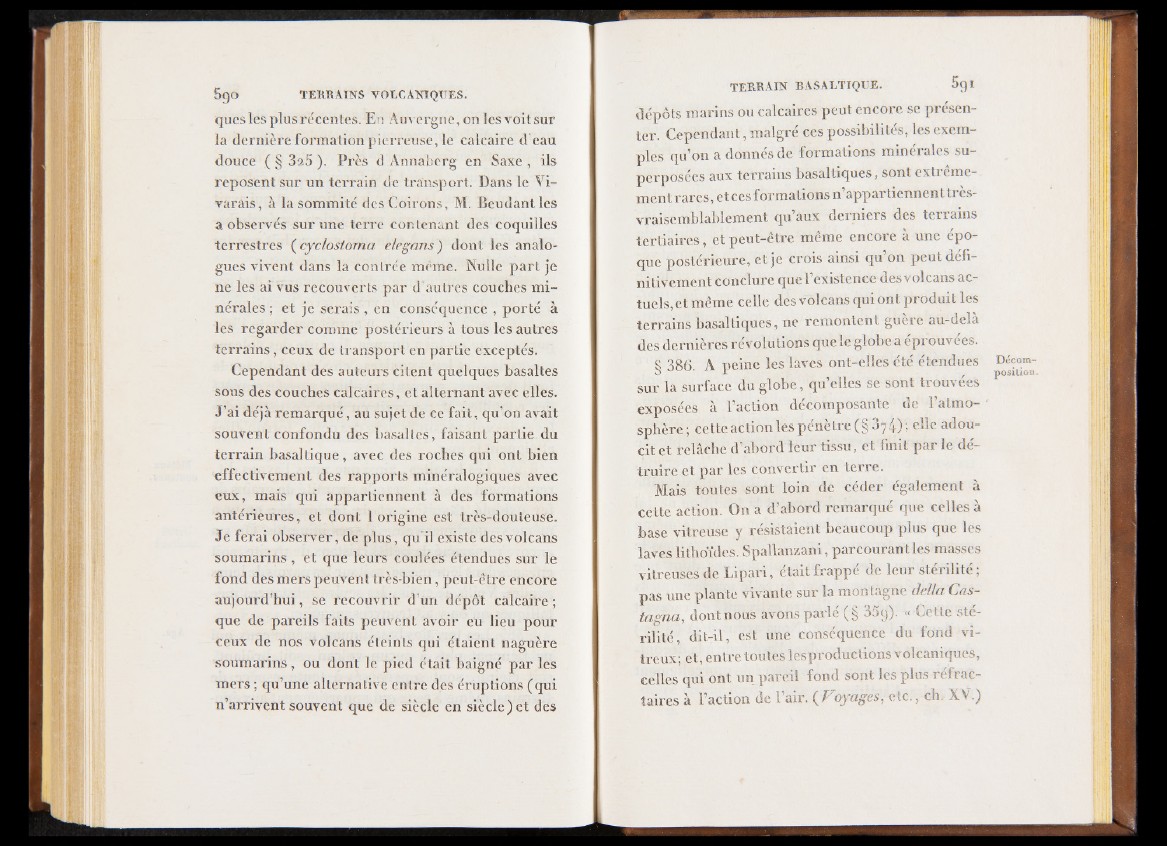
ques les plus récen tes. Eo Auvergne, on les voit sur
la dernière formation pierreuse, le calcaire d'eau
douce (§ 325 ). Près d Annaberg en Saxe, ils
reposent sur un terrain de transport. Dans le Vi-
varais, à la sommité desCoirons, M. Beudant les
a observés sur une terre contenant des coquilles
terrestres ( cyclostorna elegans) dont les analogues
vivent dans la contrée meme. Nulle part je
ne les ai vus recouverts par d autres couches minérales
; et je serais , en conséquence , porté à
les regarder comme postérieurs à tous les autres
terrains, ceux de transport en partie exceptés.
Cependant des auteurs citent quelques basaltes
sous des couches calcaires, et alternant avec elles.
J ’ai déjà remarqué, au sujet de ce fait, qu’on avait
souvent confondu des basaltes, faisant partie du
terrain basaltique, avec des roches qui ont bien
effectivement des rapports minéralogiques avec
eux, mais qui appartiennent à des formations
antérieures, et dont 1 origine est très-douteuse.
Je ferai observer, de plus, qu'il existe des volcans
soumarins , et que leurs coulées étendues sur le
fond des mers peuvent très-bien, peut-être encore
aujourd’hui, se recouvrir d’un dépôt calcaire ;
que de pareils faits peuvent avoir eu lieu pour
ceux de nos volcans éteints qui étaient naguère
soumarins, ou dont le pied était baigné par les
mers ; qu’une alternative entre des éruptions (qui
n’arrivent souvent que de siècle en siècle) et des
dépôts marins ou calcaires peut encore se présenter.
Cependant, malgré ces possibilités, les exemples
qu’on a donnés de formations minérales superposées
aux terrains basaltiques, sont extrêmement
rares, et ces formations n appar tiennent tres-
vraisemblablement qu’aux derniers des terrains
tertiaires, et peut-être même encore à une époque
postérieure, et je crois ainsi qu on peut definitivement
conclure que l’existence des volcans actuels,
et même celle des volcans qui ont produit les
terrains basaltiques, ne remontent guère au-delà
des dernières révolutions que le globe a epi ouvces.
§ 386. A p>eine les laves ont-elles ete etendues
sur la surface du globe, qu’elles se sont trouvées
exposées à l’action décomposante de l’atmosphère;
cette action les pénètre (§ 3y4) ; elle adoucit
et relâche d’abord leur tissu, et finit par le détruire
et par les convertir en terre.
Mais toutes sont loin de céder également à
cette action. On a d’abord remarqué que celles à
base vitreuse y résistaient beaucoup plus que les
laves lithoïdes. Spallanzani, parcourant les masses
vitreuses de Lipan, était frappe de leur stenlite,
pas une plante vivante sur la montagne délia Cas-
tagna, dont nous avons parle (§ 35q). « Cette stérilité
, dit-il, est une conséquence du fond vitreux;
et, entre toutes lesproductions volcaniques,
celles qui ont un pareil fond sont les plus réfractaires
à l’action de 1 air. ( ^ oyciges, etc., ch. XV.)
Déconvposition.