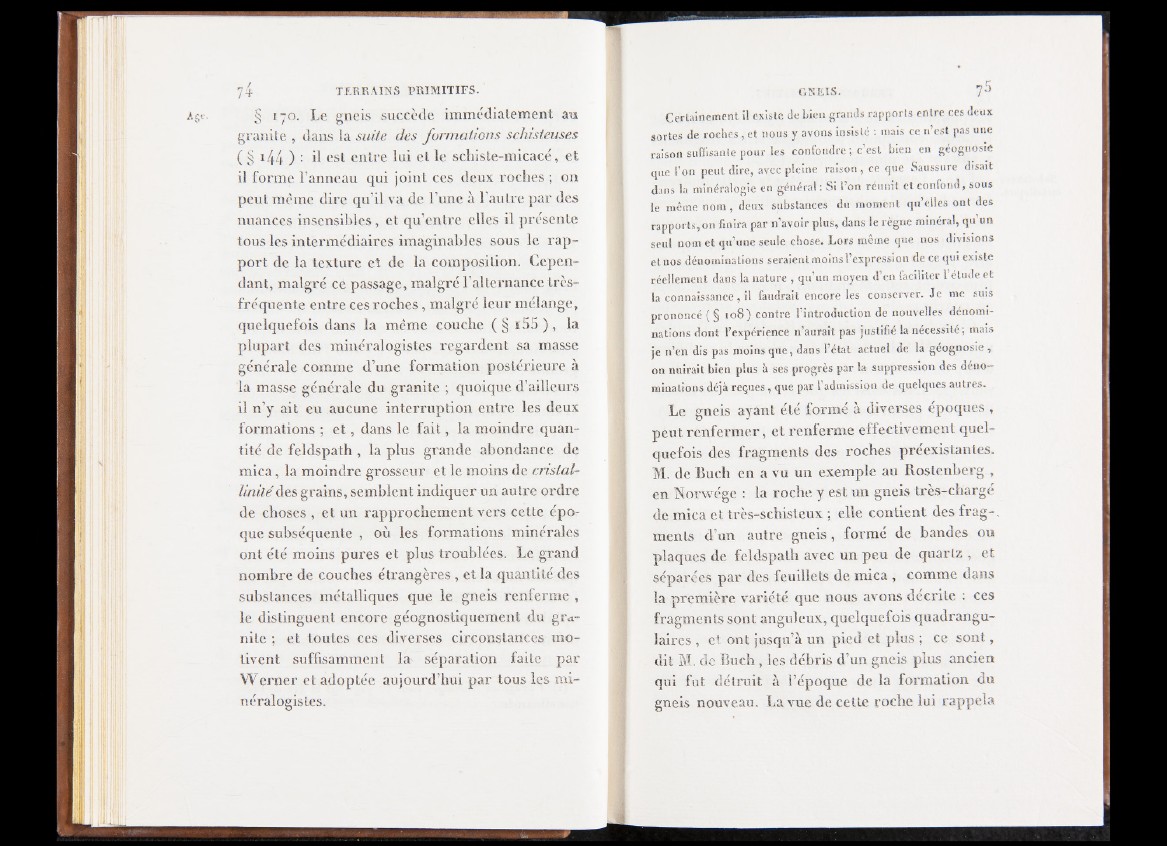
7« 4/
§ 170. Le gneis succède immédiatement au
granité , dans la suite des formations schisteuses
( § i44 ) : d est entre lui et le schiste-micacé, et
il forme l’anneau qui joint ces deux roches ; on
peut même dire qu’il va de l’une à l’autre par des
nuances insensibles, et qu’entre elles il présente
tous les intermédiaires imaginables sous le rapport
de la texture et de la composition. Cependant,
malgré ce passage, malgré l’alternance très-
fréquente entre ces roches, malgré leur mélange,
quelquefois dans la même couche (§ i 55) , la
plupart des minéralogistes regardent sa masse
générale comme d’une formation postérieure à
la masse générale du granité ; quoique d’ailleurs
il n’y ait eu aucune interruption entre les deux
formations ; e t , dans le fa it, la moindre quantité
de feldspath , la plus grande abondance de
mica, la moindre grosseur et le moins de cristal-
Unité des grains, semblent indiquer un autre ordre
de choses , et un rapprochement vers cette époque
subséquente , où les formations minérales
ont été moins pures et plus troublées. Le grand
nombre de couches étrangères, et la quantité des
substances métalliques que le gneis renferme ,
le distinguent encore géognostiquement du granité
; et toutes ces diverses circonstances motivent
suffisamment la séparation faite par
Werner et adoptée aujourd’hui par tous les minéralogistes.
Certainement il existe de Lieu grands rapports entre ces deux
sortes de roches, et nous y avons insisté : mais ce n est pas une
raison suffisante pour les confondre ; c’est bien en géognosie
que l’on peut dire, avec pleine raison, ce que Saussure disait
dans la minéralogie en général : Si l’on réunit et confond, sous
le même nom , deux substances du moment qu’elles ont des
rapports, on finira par n’avoir plus, dans le règne minéral, qu’un
seul nom et qu’une seule chose. Lors même que nos divisions
et nos dénominations seraient moins l’expression de ce qui existe
réellement dans la nature , qu’un moyen d’ en faciliter 1 étude et
la connaissance, il faudrait encore les conserver. Je me suis
prononcé (§ 108) contre l’introduction de nouvelles dénominations
dont l’expérience n’aurait pas justifié la nécessité; mais
je n’en dis pas moins que, dans l’état actuel de la géognosie ,
on nuirait bien plus à ses progrès par la suppression des dénominations
déjà reçues, que par l’admission de quelques autres.
Le gneis ayant été formé à diverses époques ,
peu t renfermer, et renferme effectivement quelquefois
des fragments des roches préexistantes.
M. de Buch en a vu un exemple au Rostenberg ,
en Norwége : la roche y est un gneis très-chargé
de mica et très-schisteux ; elle contient des frag-,
ments d’un autre gneis , forme de bandes on
plaques de feldspath avec un peu de quartz , et
séparées par des feuillets de mica , comme dans
la première variété que nous avons décrite : ces
fragments sont anguleux, quelquefois quadrangu-
laires , et ont jusqu’à un pied et plus ; ce sont,
dit M. de Buch, les débris d’un gneis plus ancien
qui fut détruit à l’époque de la formation du
gneis nouveau. La vue de cette roche lui rappela